LISTE DES CHRONIQUES PUBLIEES SUR CETTE PAGE
Populaire - L'Homme Qui Rit - Ernest Et Célestine - Mes Héros - The Hobbit - Télé Gaucho - More than honey - 3 Mondes - Tango Libre - Au-Delà des Collines - Despues de Lucia - War Witch - Thérèse Desqueyroux - No 89 Shimen Road - Après Mai - Le Capital - La Chasse - The Impossible - Nous-York - La Pirogue - Argo - Les enfants loups - Frankenwennie - J'enrage de son absence - Un plan parfait - Skyfall - Asterix 4 - Le Magasin Des Suicides - Hope Springs - Do Not Disturb - Savages - Taken 2 - Les Seigneurs - Les Saveurs Du Palais - Lawless - Camille Redouble - Hit And Run - Wrong - Turn Me On - L'Etrange Pourvoir de Norman - Un Amor - A Coeur Ouvert - Expandables II - Atmen - The Cabin In The Wood - To Rome With Love - L'Age de Glace IV - 7 Jours à la Havane - The Dictator - Hasta La Vista - Adieu Berthe - Journal de France - Salmon fishing in the Yémen - Snow White - The Best Exotic Marigold Hotel - Margin Call - Sans Issue - Detachmant - Barbara - The Substance Albert hofmann LSD - Tyrannosaur - Les Mécréants - L'Enfance Volée - Les Adieux à la Reine - Un Eté Brulant - Mirror Mirror - Twixt - Radiostar - Balkan Mélodie - L'Enfant d'en Haut - Sur la Piste du Marsupilami - Avé - UFO In Her Eyes - Mince Alors - 2 Days In New York - Hunger Games - Oslo 31 August - Oncle Charles - Cloclo - 38 Témoins - Possessions - Un Cuneto Chino - Eléna - Comme un Chef - A L'Aveugle - Les Infidèles - Extremly Loud - Chronicle - Albert Nobbs - Iron Lady - Big Miracle - Dos Au Mur - Zarafa - La Taupe - Monsieur Lazhar - Take shelter - Mandela's Miracle - Corpo Celeste - La Vérité si je mens3 - Sherlock Holmes II - Café de Flore - Bottled Life Nestlé - Summer Games - Et si on Vivait tous Ensemble - Hors Satan - Deep end - J.Edgar - Sleeping Beauty - Le Moulin et la Croix -
POPULAIRE
Une Comédie Romantoc

Populaire, le premier film d’un mec venu de la pub et du clip, qui a jusque là officié dans le court métrage, un certain Régis Roinsard. Populaire met en scène Romain Duris et Deborah François dans les rôles titres. Et oui. Il s’agit bien d’une comédie romantoc de plus pour le beau gosse du cinéma français et l’actrice belge sortie de l’anoymat par les frangins Dardennes via L’Enfant. Ici, exit le cinéma réaliste et vive le film qui pue la naphtaline, hommage en quelque sorte, à une période d’après guerre ou plus exactement, relecture un peu moderne des comédies romantiques d’antant chères à Billy Wilder en moins drôle ! Après un générique en animation, l’image se fige sur des pieds de filles qui marchent dans la rue avant de devenir bien réels. Ces pieds arrivent à la ville et rêve de fouler le parquet ciré d’un bureau. Oui, ces pieds sont ceux de Rose qui veut devenir secrétaire le métier à la mode qui fait fantasmer toutes les femmes en cette année 1958. A l’aube des sixtees, la jeune femme moderne rêve d’émancipation. Elle refuse le mariage arrangé par papa avec le meilleur parti de son village. Elle préfère monter à la grand ville, à Lisieux là où une opportunité de carrière se présente. Pour rose, ce sera la cabinet comptable de Louis. Après un entretien d’embauche qui vire au fiasco total, Louis remarque la dextérité de la jeune femme. Elle a beau taper à deux doigts et non 10, elle est le TGV incarné, une tapeuse à grande voitesse. Biensur, le jeune freluquet en patron dynamique qui ne pense qu’à remporter le 11ème concours de vitesse dactylographique, va immédiatement faire une proposition d’embauche é la demoiselle. Elle aura le travail si elle décide de s’entrainer dur pour atteindre le sommet. Au rythme de la chanson de la Dactylo rock, voilà que la pouliche triomphe sur sa Triumph. Bientôt ce sera le concours national à Paris et pourquoi pas, New York pour une rencontre mondiale. A moins que l’amour ne perturbe ces plans tirés à la va vite sur la comète. POPULAIRE, un premier film pétri de défauts. Pour amener un semblant de comédie, Régis Roinsard imagine une Rose maladroite. La maladresse de cette godiche, rebelle, mais un peu nunuche tout de même, se gamelle à vélo, crame une déchiqueteuse et j’en passe. Seulement, le trait est tellement appuyé que toutes les tentatives de gags tombent à plat, parce qu’on le sent venir 15 minutes avant au moins ! en règle général, on anticpe toutes les situations. Tel est le gros défaut de cette comédie romantoc standard. Le scénario ne laisse aucune place à la surprise.
L'HOMME QUI RIT :
A Pleurer !

L’Homme Qui Rit, un film pour ados, à cent lieues des Twilight et autre blockbuster… on dira un film pour ados qui ne connaît pas encore très bien Victor Hugo et qui pourrait, ceci dit, s’y intéresser. En effet, L’homme Qui Rit est un texte écrit il y a près de 150 ans et qui possède une résonnance assez hallucinante avec l’époque dans laquelle on vit. Avec ce récit, Hugo a voulu raconter comment un enfant différent a dû supporter sa différence, la surmonter, pour mener un combat en faveur des plus démunis. Fils d’un notable qui a tenté de renverser le Roi, Gwynplain est arraché à sa famille et expédié sur une terre glacée. Là, on lui taillade le visage. On lui dessine un sourire au scalpel. Il neige. Il vente. Il fait froid. Gwynplain abandonné à son triste sort marche seul quand soudain, au milieu de cette étendue désertique balayée par cette tempête, il croise une morte qui tient dans ses bras un bébé encore en vie. Gwynplain recueille cet enfant et parvient à rejoindre un village. Seulement, personne ne lui ouvre la porte. Soudain, son regard se pose sur une roulotte, un peu à l’écart. Le cri d’un loup résonne. Un homme, gouailleur, à forte corpulence sort de cette caravane, hurle pour faire taire le loup. L’homme, de son nom Ursus, refuse tout d’abord l’hospitalité à Gwynplain. Puis, pris de pitié, il décide de lui offrir le gite et le couvert. Très vite, Ursus remarque le visage scarifié de Gwynplain. Il remarque aussi que le bébé est aveugle. Ursus, devient le père d’adoption de ces deux orphelins, un père aimant, prévenant, inquiet et protecteur. Ensemble désormais, cette petite famille recomposée sillonne les campagnes. Ursus, vendeur d’herbe miracle, plus bonimenteur que pharmacien, se sert de ces deux enfants pour augmenter la courbe de ses ventes. Les années passent. Le commerce est fleurissant. Désormais, Ursus vend des mèches de cheveux de Gwynplain pour éloigner le diable…. Partout dans les villages, la foule se presse pour voir, toucher et moquer celui que l’on appelle désormais L’Homme Qui Rit… . Oh la vache ! Le succès est devenu tel que Ursus décide de conduire sa petite troupe à la grande ville. Il installe la roulotte au champ de foire. Là encore, le succès est immédiat. Chaque soir, la duchesse vient ici. Elle est amoureuse de ce jeune homme car jamais on ne la regarde avec des yeux pareils.
Attirée par sa laideur, la Duchesse va tenter de mettre dans son lit l’Homme qui rit, au grand désespoir de Déa. Si Gwyplain la considère comme sa sœur, Déa elle, est amoureuse de Gwynplain. Ils n’ont aucun lien de sang. Ils pourraient vivre heureux. Déa, l’aveugle qui voit tout, l’avenir et l’âme bonne de Gwynplain aura beau mettre en garde son amoureux, ce dernier, attiré par la lumière, tourneboulé par la gloire, va quitter la champ de foire pour un autre carnaval, un autre théâtre, celui des faux culs, des mesquins et des conventions. Au château, dans sa nouvelle demeure, Gwynplain est trahi sans même s’en rendre compte. Bien décidé à changer le monde, comme tout adolescent qui se respecte, il comprendra trop tard que son pouvoir n’est pas aussi grand qu’il ne le pensait. Il découvrira surtout que la célébrité n’est rien en comparaison de l’amour véritable que lui portaient ses vrais amis, sa vraie famille, Déa et Ursus.

L’HOMME QUI RIT une fable tragique réalisée par Jean Pierre Améris, celui qui connu le succès tardivement avec Les Emotifs Anonymes. Et pourtant, voilà maintenant bien 30 ans qu’ il réalise des films, des métrages qui ont tous en commun de s’intéresser aux éclopés de la vie, abimés, solitaires. Comment est-ce que l’on peut surmonter sa différence, son handicap pour tenter de vivre le plus normalement du monde ? Voilà ce qui taraude ce géant de plus de 2 mètres qu’est Améris. L’Homme Qui Rit était donc fait pour lui. Voilà bien des années en effet qu’il caressait le rêve de porter à l’écran ce roman méconnu de Victor Hugo
ERNEST & CELESTINE
Elégant et Charmant Animé de Fin d'Année
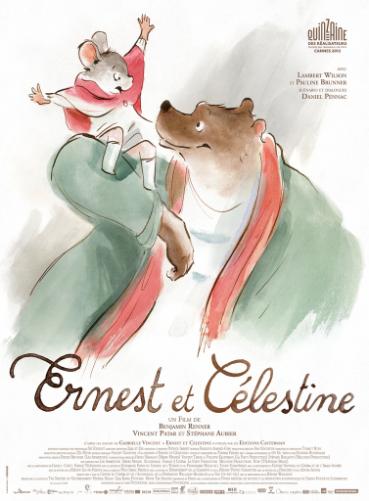
Peut-être avez-vous été bercé par les aventures de Ernest et Célestine, cette souris rebelle intrépide et de cet ours bourru et mal léché ? Enfin, si vous faites partie de la frange la plus jeune de notre auditoire. Parce que ces albums illustrés sont nés de l’imagination de Gabrielle Vincent dans les années 80. Très vite, le succès est au Rendez-vous. On aime se délecter avec ces histoires simples, sans méchanceté… jamais… oui, dans le monde merveilleux d’Ernest et Célestine, il n’y a point de place pour la noirceur et le cynisme. La tendresse, la douceur sont ses moteurs, même si elle aime à se moquer parfois des conventions qui régissent notre vie quotidienne. Le dessin est à l’image des textes, d’une sobriété absolue avec un trait fin. On est proche du croquis…
Gabrielle Vincent a toujours refusé une adaptation pour le petit comme pour le grand écran parce qu’elle a toujours été effrayée justement, peur qu’on trahisse son coup de crayon. Ceci dit, à son décès, Casterman, détenteur des droits a immédiatement lancé un appel à projet et voilà comment l’aventure a débuté.Didier Brunner le producteur remporte le marché. Il contacte l’écrivain Daniel Pennac et lui soumet l’idée farfelue à priori, de mettre un peu de noirceur dans un récit inspiré d’une des 20 aventures.
A la surprise de Brenner, Pennac est emballé. Il adore ces personnages… Je les aime bien, oui, je suis d’accord d’écrire un scénario original. Je vais enfin pouvoir répondre à une question qui me tarabuste depuis des lustres et que Gabrielle Vincent a laissée en suspens : comment cet ours et cette souris se sont-ils rencontrés ? Dès lors l’imagination de Pennac s’emballe. Il invente deux mondes, celui du dessous avec des souris dentistes et celui du dessus avec des ours qui ont des carries. Dans chacun des deux mondes, on battit des légendes urbaines et on fait bien attention à ne jamais se croiser. Les souris ont par exemple peur du grand méchant ours… Bref, il reprend l’esprit des albums et invente une histoire nouvelle. On confie la réalisation de ce film à un benjamin, Benjamin Renner. Il s’agit de son 1er long métrage. Pas très sûr de lui, il demande de l’appui. Brenner qui connait Patard et Aubier, les réalisateurs du film punk Panique au Village, avec cowboy, Indien, cheval et toute la clique, lui dit : J’ai ce qu’il te faut. On va en plus apporter la Belgium Touch, autant dire un petit grain de folie supplémentaire. Les deux pic pic et André sont aux anges. Ils découvrent un univers complètement nouveau et s’éclatent sur le découpage, le story board… plaçent une course poursuite ici, un petit gag par là. Attention, il n’est pas question de céder à l’hystérie de Panique Au Village, non plus…. Il faut respecter le désir de Renner d’aller dans la direction de Miyasaki. C’est vrai que Ernest et Célestine ressemble à du Miyasaki. C’est Totorro mais c’est aussi Kitano pour L’été de Kikoujiro, l’histoire d’un enfant recueilli par un homme un peu puéril qui ne sait s’y prendre avec les gamins. Y a évidemment de ça dans Ernest et Célestine.

Ernest est un ours bourru, solitaire, clown musicien vivant en marge sans fric. Il a l’estomac qui crie famine. Ernest va faire la connaissance de Célestine, alors qu’elle s’est assoupie dans une poubelle. C’est pile au moment où il s’apprête à la croquer que Célestine se réveille. Cette souris, paria à sa manière, rebelle a déserté sa communauté de souris dentiste. Et voilà comment, le monde d’en dessous, celui de Célestine, et le monde d’en haut, celui d’Ernest se rencontrent enfin. Ensemble, les deux parias, rejetés de leur société respective, vont faire un bout de chemin. Amitié, Amour peut-être, les deux vont vivre sous le même toit, loin de la ville, apprendre à se connaître et tenter de tordre le coup aux clichés et idées reçues qui prévalent dans leur monde respectif.

Ernest Et Célestine, un chouette animé avec de l’humour, de l’action, des courses poursuites, des dialogues savoureux, une souris pipelette choue comme tout qui ne se démonte pas devant ce gros pataud d’ours qui n’a pas une voix de nounours. En l’occurrence, il s’agit de Lambert Wilson qui avoue s’être bien éclaté sur ce doublage. A voir avec vos enfants….
MES HEROS
Un Téléfilm, Pas Un Film !

Oh punaise! Un téléfilm d’accès prime time. Voilà à quoi ressemble MES HEROS de Eric Besnard scénariste de A L’AVEUGLE, L’ITALIEN, BABYLONE AD… on lui doit des réalisations comme 600 KG D’OR PUR ou CASH qui est sans doute le moins pire de tous. Eric Besnard poursuit dans la médiocrité grâce à ce téléfilm MES HEROS qui met en scène Gérard Jugnot et Josiane Balasko, en couple de retraités et Clovis Cornillac leur fils. Ici tout est beau, lumineux, merveilleux, alors que le sujet est grave au demeurant, la clandestinité en France n’a en effet rien de merveilleux. Ils ont réussi à pondre un machin où même des gendarmes qui alpaguent des français tendant la main à des clandestins, ont du cœur. Les képis ouvrent les yeux, ou plutôt les fermes au bon moment! Normalement aider un clandestin en France, c’est 5 ans de gniouf et une grosse amende mais là, on va rien dire parce qu’on a du cœur… Dans un téléfilm, il ne faut pas donner une mauvaise image des autorités. C’est une des règles, même si en France, les flics ont des objectifs chiffrés à atteindre. Et ce n’est pas l’arrivée au pouvoir des socialistes qui a changé la donne!

Donc, dans cette fable, Mes Héros, sous ces faux air de Crime au paradis mêlé à du Michou d’Aubert, Clovis Cornillac ambulancier à Paris doit récupérer sa mère au poste de police de Bordeaux. Elle s’est mêlée de ce qui ne la regardait pas dans un hôtel, prenant la défense d’une femme battue. Mais si elle était à Bordeaux, c’était pour récupérer au sein de son groupe, le fils d’une immigrée clandestine arrêtée. Elle a choisi de recueillir secrètement cet enfant. Car, sans son enfant, la clandestine ne peut pas être renvoyée. Et voilà comment, bon gré mal gré, Cornillac joue les chauffeurs de Taxi pour sa mère et ce gamin qui ne dit jamais rien et garde toujours sa cagoule sur le crane. Arrivée au bercail, Jugnot accueille moyennement bien la nouvelle. Mais rassurez-vous, il finira par s’y faire. Peut-être même qu’une relation complice naitra entre ce gamin inquiet et ces pépé et mémé de substitution temporaire.

Rien à dire de plus sur cette chose anecdotique, si ce n’est qu’en dehors de cette thématique, le film développe sur la complicité au sein du couple. Quand on est deux vieux mariés, on peut ronchonner, se balancer des saloperies à la gueule, au fond, on s’aime et c’est l’essentiel. On flippe même de voir sa moitié partir un jour sans prévenir, à cause de la grande faucheuse. Bien sûr, quand on a la quarantaine, qu’on est témoin de cet amour, on réfléchit à deux fois avant de larguer sa tendre moitié, même si elle est allée voir ailleurs. MES HEROS, un film avec plein de bons sentiments dégoulinant, un Gérard Jugnot sympathique, une Balasko pas mieux et un Cornillac qui assiste en spectateur au show des deux bronzés à la retraite. Ajouter quelques apparitions de Pierre Richard, le papy rebelle qui ne suit aucune des recommandations qu’on lui fait, croque sa fin de vie à pleines dents et vous obtenez un gentil film comme Jugnot les affectionne tant. A éviter.
THE HOBBIT
Après Lord of the rings, Voici : Lord of the Fric !
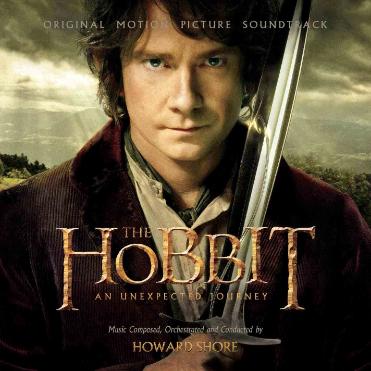
Ah Ben on est quand même réparti pour une trilogie dont on sait déjà que le roman de Tolkien qui l'a inspiré est nettement moins épais que celui qui a nourrit les 3 films du Seigneur des anneaux. Y aura-t-il matière à fournir 3 films de 3 heures ? Pas sûr….Coup de fric? Bien sûr et même hold-up conjointement organisé par Peter Jackson et les fournisseurs de projecteurs numériques qui équipent désormais les salles de cinéma. Une petite mise à jour s'impose! Souvenez-vous au moment de la sortie d’Avatar, tout le monde s'est emballé. C'est le renouveau du cinéma! La 3 D va garantir la pérennité du 7ème Art. On était alors peu nombreux à pouffer de rire en rappelant que 3D ou pas, un film réussi devait avant tout s'appuyer sur une bonnes histoire et des personnages un peu épais. Du côté des exploitants, on les a obligé à remiser leurs projo 35mm au grenier. Vous voulez de la 3D à la mode? Endettez-vous avec nos projos numériques. De toute façon, vous aurez pas le choix à part celui de crever car on ne vous refilera plus de Bobine mais des DCP des discs durs! Et pas uniquement pour les films en 3D. Pour les 2D aussi.

Les années ont passé et aujourd'hui tout le monde le dit. Le numérique c'est certes plus net mais moins chaud que la pellicule et La 3D c'est nul. Donc pour relancer ce marcher voilà-t-y pas que Peter Jackson propose un film en 3D tourné et diffusé selon la nouvelle norme HFR. Un truc qui remise le standard du 24 images par seconde a l'aire préhistorique. Aujourd'hui on est passé à 48 voire 60 images par secondes, de quoi améliorer sensiblement la fluidité des mouvements et le réalisme. C'est super. Si on fait le test de filmer une éolienne en marche et de faire une projection simultanée des deux captations en 24 et en 48, la différence saute aux yeux. Pour un Hobbit qui accueille une armée de nains affamés chez lui, la fluidité on s'en fout un peu. Par contre des détails qui jusqu'alors pouvaient apparaître flous seront désormais nets. Tout ça c'est génial. Mais une fois encore. Si cette nouvelle technologie ne se met pas au service d'une chouette histoire et de personnages un peu touffus qui font des trucs de dingues, c'est pas la peine. C'est exactement ce qui se passe avec ce voyage inattendu qui vite très vite, vire au voyage on ne peut plus attendu. Qu’est-ce que vous voulez…. Il faut toujours se méfier d'un film qui débute dans un cul de sac. Le village de cul de sac qui sort du village des schtroumpfs abrite dans sa verte prairie des Hobbit pas bleus juste des demi hommes aux grands pieds poilus et aux oreilles pointues. Là le bidon bilbot écrit ses mémoires et se souvient du jour où tout a commencé pour lui, 60 ans plus tôt.
Le grand magicien Gandaalf toque à sa porte et le voilà enrôlé dans une aventure. Très vite ça tourne au comte façon Blanche Hobbit et les 13 nains. C'est quand même Peter Jackson qui est aux commandes. Il voit grand, bien plus que Disney et sa célèbre Blanche Neige. Et quitte à piquer les nains de Mickey, pourquoi ne pas faucher une pomme aussi!!!! L'Hobbit en a une de pomme, pas empoisonnée mais tout de même, un fruit qu'il donnera discrètement à son poney. Malheureusement le scénario n’est autre qu’une quête, sorte de déambulation dans des forêts pour se rendre d'un royaume à l'autre. Les nains veulent récupérer leur montagne. Ils ont une clé et une carte qu'ils ne savent pas déchiffrer. Bien sûr que le magicien sait qui pourra les aider! On se croirait dans un jeu vidéo plus stupide encore qu'une aventure de Super Mario. Franchement, le scénario prend l’eau de toute part…. On assiste à une succession de tableaux tous conçus sur le même mode. Des nains tombent sur des bestioles numériques. Ils bataillent, braillent, virevoltent, et gagnent le combat contre la plus balaise des créatures. Attention ce n'est jamais leur force qu'il leur permet de vaincre mais la crétinerie de leurs ennemis qu'ils exploitent au maximum. Et quand ça ne suffit pas, le magicien a toujours une bonne formule pour les tirer d'affaire. Un magicien, ça aide à couper des gros cailloux en deux ou à enflammer des pommes de pins, ou à appeler des aigles géants. Bref, on se prend à trouver le temps long, trop long. Le film avoisine les 2h45. Une chance que sur l'avant dernier chapitre, le Gollum skyzo rigolo soit présent pour nous extirper de l'ennui dans lequel on était englué depuis le début. On retiendra de ce gâchis la première scène qui montre la prise du royaume des nains par le dragon. Elle n'est pas mal. On retiendra aussi mais pour son ridicule le Combat de montagne qu'on dirait des transformer de l'âge de pierre. Pour le reste circulez y à rien à voir. Et le pire, c’est qu’on va encore en bouffer pendant 2 épisodes ! LE HOBBIT, UN VOYAGE INATENDU, un film aussi chiant que le jeu Hobbit sorti en 82 et injouable sur Commodore 64 et Amstrad CPC 664.
TELE GAUCHO
Détonnant et Délirant
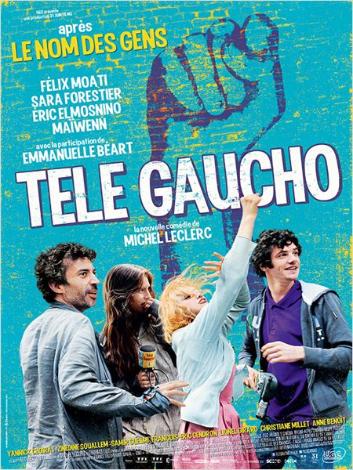
Souvenez-vous, le Nom des Gens avec Sara Forestier en traqueuse de facho et Jacques Gamblin en socialiste déçu de la défaite de Jospin, c’était lui donc, c’était du Michel Leclerc. Cette fois, il revient pour son 3ème long métrage avec une histoire tout aussi personnelle que Le Nom des Gens. Michel Leclerc a participé de très près entre 1995 et 2000 à une télé locale tenue par des gauchistes : Télé Bocal qu’elle s’appelait. Et paraît-il qu’elle émet toujours. Il nous raconte donc, par le biais de Victor, un jeune garçon un peu naïf, cette télé, ces personnages qui la composaient. Tout commence lors d’une manifestation de féministes alors que l’on assiste à une battle au mégaphone où Elmosnino fini par traiter une de ces femmes de mal baisée… Ca commence très fort et laissez -moi vous dire que sur les 50 première minutes, Michel Leclerc ne nous laisse pas une seconde de répit. Les vannes fusent de partout, les gags aussi ou l’on se rend compte que Elmosnino est le patron emblématique de Télé Gaucho. Il est aussi un escroc notoire qui va vendre une caméra pourrie à un gamin pour 600 balles. Elmosnino en propose au départ 1000. Le môme ne négocie pas. Elmosnino s’emporte.. .enfin voyons et lui demande de faire baisser le prix… je te la laisse à 800… Non 700 répond le gamin… voilà c’est bien, vendu pour 600 !
Ce qui est intéressant avec ce film, c’est que Leclerc filme parfaitement le bordel, car Télé Gaucho, c’est un gros bordel permanent. Il alterne les images de ce chaos, une véritable chorégraphie du bordel avec des choses qui se passent en 1er, mais aussi au 2ème voire parfois au 3ème plan, avec celles des vraies chroniques tournées par les amateurs, notamment, celle intitulée CES OBJETS QUI VOUS FONT CHIER… chronique remarquable qui selon Maiwen éminence grise de Télé Gaucho, dénonce, malgré son aspect divertissant, la société de consommation… Les robinets poussoirs des lavabos, les points ‘vous êtes ici’ sur les plans de rue toujours mal placés, bref, et j’en passe… Cette chronique est donc l’œuvre de Victor, ce jeune mec de Bure Sur Yvette, cinéphile qui se rêve cinéaste et va donc trouver un petit boulot dans la télé commerciale, l’ennemie de Télé Gaucho… La télé commerciale, c’est coca, c’est Pepsi, c’est la droite, c’est Goebles. N’empêche que Victor va trouver un stage rémunéré dans cette chaine, sur une émission façon Delarue en plus débile et présentée par Emmanuelle Béart qui écorne son image et se retrouve à incarner un personnage à cent lieues de ses propres convictions… Dans la vie, elle est engagée en faveur des sans papier, alors qu’ici, elle s’en cogne. Les sans papier, il en est question dans ce film, mais aussi le Sida, l’avortement et tout un tas d’autres sujets majeurs. C’est la griffe Michel Leclerc, ne jamais oublier le fond politique dans une comédie. Et pour le coup, c’est encore plus réussi qu’avec le Nom des Gens…

Puisque je cite Le Nom des Gens, on retrouve au passage deux rescapés de ce film : Sara Forestier qui incarne ici la copine de Victor, celle qui est belle mais gauche… mon dieu qu’elle est gauche… Elle est gauche et se demande ce qui est de droite ou pas, comme Maiwen. Pour elle, par exemple, le porno c’est de droite. Alors quand il s’agit de tourner un porno sur le toit de l’immeuble qui abrite Télé Gaucho, elle s’interroge, pas comme Zindedine Soualem, qui lui, acteur de porno à la retraite, ne pense qu’à montrer sa bite… Excellent Zinedine Soualem dans Télé Gaucho… Excellent Télé Gaucho… Franchement un film où l’on dit que le journal Le Monde est un torchon, où des personnages confondent Truffaut avec un fleuriste et Pasolini avec une marque de pâtes, où l’on se fout de la gueule de Télé Povéra qui donne la parole aux pauvres mais qui emmerde tout le monde quand on la regarde plus de 5 minutes, c’est forcément un très bon film !
MORE THAN HONEY
Un Film Qui Va Buzzzzzer

Bien sûr, vous le savez, les abeilles ont tendance à disparaître de la surface du globe. C’est un véritable fléau. Evidemment, la disparation des abeilles, tout le monde s’en fout… C’est pour cette raison que Markus Imhoof a réalisé un film documentaire la dessus.
Pour que l’homme prenne conscience qu’une menace plane sur la qualité des hamburgers qu’il mange avec délectations! Et oui, sans abeille, dans votre burger, y aurait pas de salade, pas de tomate, par de cornichon, pas de ketchup et peut-être même que la viande serait dégueulasse à cause des bœufs qui ne pourraient plus brouter des trèfles… Dit comme ça, il me semble qu’on commence à tendre l’oreille. On s’interroge: « mais enfin voyons, les abeilles chient du miel et pis c’est tout… à la limite de la gelée royale, mais pas des tomates et des cornichons! » C’est exact. Je le confirme. Mais je confirme aussi que ce sont les abeilles qui pollinisent les fleurs de tomates, ou de cornichons ou de 30% à peu près des fleurs qui donnent naissances ensuite à des fruits ou des légumes que nous mangeons! Il est donc là le problème de la disparition des abeilles. Sans ces petites bestioles, on se retrouverait comme dans certaines régions de Chine à être obligé de remplacer ces travailleuses par l’homme. Oui, on le voit bien dans ce documentaire. L’homme pollinies à la main des arbres fruitiers. C’est un travail harassant, pénible et dont le résultat est moins efficace que lorsque les abeilles s’en occupent. Sans doute parce qu’il n’y a plus d’amour dans ces gestes mécaniques. Et oui, les abeilles sont les messagères de l’amour, et fidèles avec ça. Elles papillonnent de plantes en plantes sans jamais les trahir.

More Than Honey de Markus Himoof est absolument remarquable et c’est un type qui a une phobie de ces bestioles qui vous le dit. En effet, il débute sur la naissance d’une reine en gros plan, des images macroscopiques comme on dit. Au passage, il n’y a pas d’effets spéciaux dans le film. Markus Imhoof s’est donné les moyens de filmer les abeilles pour de vrai. Il a commencé par faire construire un studio abritant 15 ruches avec 15 colonies différentes. Un type, dresseur d’abeilles, ou tout du moins, capable de les diriger et surtout d’anticiper des évènements importants dans la vie d’une colonie, comme la naissance d’une reine, ou une danse de l’abdomen pour ne pas dire une danse du ventre, était présent sur le plateau. On filmait à 70 images par seconde avec le genre de caméra qu’on vous enfonce dans le colon quand on vous fait une coloscopie. Résultat, des gros plans hallucinant au cœur des ruches où on pourrait presque caresser le petit duvet qui recouvre leur pate. L’image est extrêmement précise et détaillée. Le clou du clou, ce sont les images en plein vol. Là encore, en disposant des caméras miniatures sur des drones pilotés à distance, on a pu suivre, filmer des abeilles en plein vol. On a pu du coup mettre des scènes de sexe entre les faux bourdons et les reines. Et oui, la reine se fait engrosser en plein vol par de faux bourdons d’autres colonies d’abeilles. Une fois fécondée, elle rentre à la ruche et fait son travail de reine. Au passage, un faux bourdon qui ne s’accouple pas avec une reine sera tué par les abeilles travailleuses de la colonie à l’approche de l’hiver parce qu’il deviendra une bouche inutile à nourrir.

Ça se passe comme ça avec les abeilles dont on apprend avec stupéfaction qu’elles sont capables de choisir entre deux situations données et que si elles s’aperçoivent que le premier choix était faux, elles peuvent d’elles mêmes décider de rectifier le tir et de prendre une autre option. Bien des hommes n’ont pas cette intelligence! Les abeilles sont intelligentes. La preuve en est donnée dans ce film More Than Honey. Marcus Imhoof fait surtout la démonstration que la domestication de ces insectes a conduite à leur perte. L’homme en a fait des bestioles qui ne piquent plus ou presque. Il les a bourrées de médicaments pour les rendre plus résistantes aux virus qui les terrassaient… Bref, il les a customisées pour produire à très grande échelle toujours plus de miel. Dans le film, Markus Imhoof part donc de cette problématique de la domestication et l’exploitation à trop grande échelle des abeilles pour élargir le débat sur le bienfondé du capitalisme. Comment ne pas réagir face à un apiculteur industriel lorsqu’il s’esclaffe dans son champ d’amandies qui s’étire à perte de vue devant le bourdonnement incessant de millions d’abeilles. Vous entendez ça, dit-il, « ce bourdonnement, c’est le bruit du pognon… » Bien sûr que le film montre à quel point il vaut mieux prévoir une apiculture résonnée à petite échelle comme dans les alpages suisses par exemple, si l’on veut éviter la catastrophe chinoise. En voyageant aux 4 coins du globe, de la Suisse à l’Amérique du Nord ou du sud en passant par la Chine ou l’Australie, il a ramené des images d’abeilles, inoffensives ou tueuses, les tueuses qui en Amérique latine sont capables désormais d’aller se nicher dans des endroits que même les ours ne peuvent pas atteindre. C’est la revanche des insectes sur l’être humain. More Than Honey, un super film pour finalement montrer que le vrai parasite sur cette planète, ce n’est pas les insectes comme les abeilles, mais c’est l’homme. Reste à espérer que le buzzz marchera autour de ce doc à voir à tout prix en salles !
3 MONDES
Un Film de Suspens Intérieur
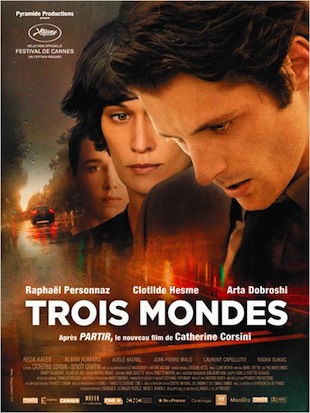
Dans la vie, à trop vouloir faire le bien, on finit par faire du mal, beaucoup de mal. Voilà en gros la morale de 3 Mondes, le nouveau film de Catherine Corsini. 3 Mondes, un drame avec Clotilde Hesme, Arta Dobroschi et Raphael Personnaz entre autre. Tout commence par une scène de rodéo automobile sur un parking alors que 3 potes bien imbibés jouent avec un gros bolide. Ils viennent d’enterrer la vie de garçon de Al, sur le point de se marier avec la fille qu’il aime. De condition modeste, Al va grimper l’échelle sociale avec ce mariage puisque sa promise est la fille du patron d’une concession de voitures pour laquelle il travaille. Avec cette entame, on a comme qui dirait un pressentiment. Il va se passer quelque chose, de grave… si ce n’est sur ce parking, ce sera plus tard, plus loin. En effet, en centre-ville, Al renverse un inconnu avec sa grosse bagnole. Poussé par ses amis, Al prend la fuite, au lieu d’aider le blessé. Le lendemain, rongé par la culpabilité, il se rend à l’hôpital pour prendre des nouvelles de l’accidenté. Mais ce qu’il ignore, c’est que la nuit de l’accident, Juliette, une jeune femme enceinte, a tout vu depuis son balcon. Descendue porter secours à la victime de l’accident, Juliette va se mettre en tête d’aider à tout prix la femme de l’accidenté, future veuve. Elle s’appelle Véra. Elle est d’origine moldave et vit en France dans la clandestinité. Véra va trouver une épaule sur laquelle se reposer en la personne de Juliette pour surmonter cette terrible épreuve. Seulement Juliette est tiraillée. En effet, alors qu’Al venait à l’hôpital s’inquiéte du sort de ce type qu’il a renversé, Juliette reconnaît ce chauffard. Mais au lieu de le dénoncer à la police, ou à Véra, Juliette va garder le silence et essayer de comprendre pourquoi ce jeune homme, à priori bien sous tous rapports n’a pas pris ses responsabilités et à préféré fuir lâchement le soir de la tragédie.

3 Mondes, un film émouvant qui interroge. Il faut savoir assumer ses conneries, sinon, la vie bascule et c’est l’enfer. On est bouffé par le remord. On devient obsessionnel. On ne pense qu’à une chose, racheter sa faute. L’argent est d’ailleurs le véritable personnage principal de ce récit. En effet, l’argent est omniprésent, l’argent utilisé comme dessous de table dans la concession auto, l’argent que l’on détourne pour dédommager une veuve, l’argent que l’on essaye d’obtenir en échange d’organes d’un mari mort. Mais est-ce possible de monnayer un foie, un cœur ? Est-ce possible de se payer une bonne conduite en achetant le silence d’une victime? Et si, oui, combien pour le meurtre accidentel d’un innocent ? Voilà le genre de questionnements auxquels se coltine le spectateur de ce drame psychologique particulièrement émouvant.
TANGO LIBRE
Danse Avec Les Taulards !
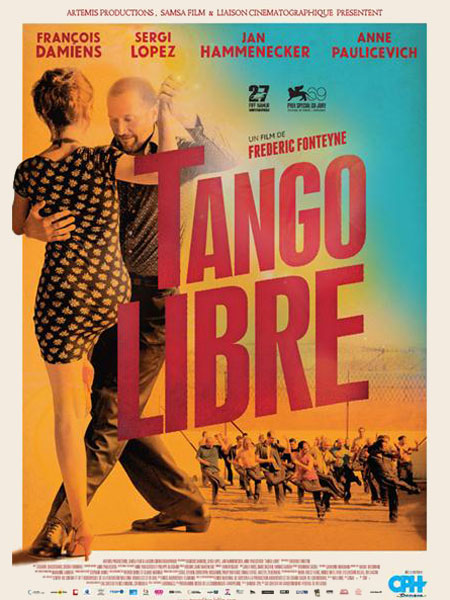
Frédéric Fonteyne, voilà un type qui prend son temps. Il a réalisé 4 films en 13 ans. On peut citer Une Liason Pornographique avec Sergi Lopez et Nathalie Baye qui s’encanaillent dans des chambres d’hôtel. On peut aussi rappeler à votre bon souvenir, La Femme de Gilles avec Clovis Cornillac en mauvais mari qui confondait sa femme avec un punchin ball… un drame poignant avec Laura Smet et Emmanuelle Devos. Pour son nouveau long métrage, Frédéric Fonteyne imagine une histoire d’amour à 4 avec des secrets, des failles, des blessures jamais refermées, un enfant qui trinque, un gardien de prison prêt à foutre en l’air sa petite vie bien réglée, un film avec aussi du Tango.
Tango Libre commence par un coup de foudre. JC, gardien de prison, s’ennuie dans sa petite vie sans histoire. Il n’a aucun vice, tout juste une petite manie. Il s’évade un soir par semaine en suivant des cours de tango. C’est justement là qu’il rencontre une nouvelle venue, Alice. Au premier échange de regard, c’est le coup de foudre pour JC. Mais le lendemain, JC se désillusionne en croisant Alice au parloir de la prison où il travaille. Elle rend visite à deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant… Étrangement attiré par cette femme qui se fout complètement des règles, JC finit par transgresser tous les principes qui gouvernaient sa vie jusqu’alors… Et le tango me direz-vous dans tout ça ? Et bien il s’invite dans cette prison. Dès lors que le secret se brise, que Sergi Lopez apprend que sa femme danse le tango avec le gardien de prison, il veut suivre des cours. Rien de mieux que de s’adresser à caïd argentin enfermé lui aussi dans cette prison… Et voilà comment, progressivement, tous les prisonniers se mettent à danser… Tango Libre, un film avec des hommes et des femmes en souffrance. C’est un peu le dénominateur commun des films de Frédéric Fonteyne. Mais à cela, il répond que là où il y a de l’amour il y a de la souffrance. Les deux sont indissociables.
Tango Libre, un film moins captivant que ces précédentes réalisations mais qui mérite tout de même le détour.
AU-DELA DES COLLINES
Au-Delà des Coliques, C'Est La Chiasse Garantie
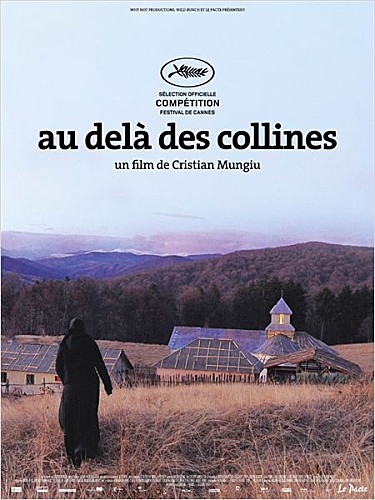
Souvenez-vous de Cristian Mungiu. Le roumain est sorti de l’ombre un jour de mai 2007 après avoir reçu une palme d’or au festival de Cannes pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, film éminemment poignant sur une jeune femme dans la Roumanie de Ceausescu qui cherchait à se faire avorter clandestinement. Un film rude sans rebondissement mais avec néanmoins plusieurs surprises à commencer par la faiseuse d’ange qui était un homme, par le personnage principale surtout, qui n’était finalement pas la femme enceinte, mais sa copine… Tourné presque tout le temps caméra à l’épaule, il nous peignait son pays et surtout 24 heures de la vie difficile d’une femme! A l’époque, le cinéma roumain est en pleine bourre. 5 ans après, tout ce que l’on peut dire, c’est que Cristian Mungiu vit sur ses acquis, sur sa réputation et ne parvient plus à surprendre personne. D’ailleurs, même à Cannes où le film fut dévoilé cette année en 1ère mondiale, le jury ne lui a pas remis une palme, tout juste deux prix de consolation, celui du scénario et celui de l’interprétation féminine que les actrices principales ont dû se partager.

Au-Delà Des Collines n’est donc même pas un film de festival comme on dit vulgairement, quand on sait que le grand public ne se bousculera pas à la caisse des cinémas pour aller le voir… D’aucuns pourraient même dire que Au-Delà des Collines n’est pas le meilleur titre qui soit, le plus approprié… Au-Delà des Coliques, c’est mieux… Au-delà des coliques, c’est la chiasse d’enfer ! Mais oui, mais oui, le film se termine sur une explosion de caca sur un pare-brise de bagnole ! Avant d’assister à ce moment de soulagement, il faut se faire douleur pour supporter cet Exorciste du pauvre, avec pour seul effet spécial, la réalité nue et brute d’une situation infernale pour une jeune femme qu’on juge envoutée alors qu’elle ne l’est pas, si ce n’est par le démon de l’amour. Il est là, le nœud de l’intrigue. Alina aime Voichita. Seulement, Voichita s’est laissé endoctriner par un prêtre Orthodoxe radical. Elle vit donc avec ce prêtre, à ses côtés, au sein d’une communauté, à l’écart de la ville, dans des bâtisses sans électricité ni eau courante. Ici, même en plein hiver, on se lave au puits et à l’eau froide. Ici, on passe son temps à prier, à épauler ce père Orthodoxe qui a des idées très arrêtées sur l'Occident qui a perdu sa foi. Ah l’occident, le règne du mariage homo et de la drogue. L’occident s’est égaré et si Voichita avait le malheur de réclamer à ce Père sa bénédiction pour qu’elle accompagne sa copine Alina en Allemagne, il refuserait. Rien à fiche pour Voichita, qui en cachette, se rend dans un commissariat de la ville pour réclamer un visa pour l’Allemagne. Et là, on nous parle d’un certain Pfaff, un photographe qui prenait des photos de toute sorte à l'orphelinat où vivait Voichita avant de devenir soeur. On lui demande si elle veut porter plainte. Elle refuse. Mais pourquoi cette scène ? Pourquoi parler de ce photographe, si on n’y revient pas plus tard, si cette information ne sert pas la narration? Elle est inutile. Et elles sont nombreuses ces scènes à rien faire, à rien dire qui auraient mérité de rester dans le chutier du banc de montage. Plus loin dans le film, alors que Voichita est exclue des messes de pénitences que l’on fait subir à son amie soit disant possédée par le Malin, le prêtre lui demande d’aller faire le guet, dehors de l’Eglise, des fois que quelqu’un d’étranger à la communauté se pointe et remarque ce spectacle affligeant. Voichita s’exécute. Debout, devant le portail de la communauté, elle remarque au loin une voiture qui arrive. Voichita court prévenir le Père, puis rebrousse chemin. Elle ne le prévient pas. La voiture s'arrête devant le portail. Un homme demande à Voichita s’il y a un terrain à vendre. Elle répond oui ; fin de la scène. La voiture s’en va. Alors Pourquoi cette séquence? Pour marquer son hésitation, son dévouement au père qui s'effrite? Peut-être! Peut-être que cette scène n'est pas si superflue que cela. Peut-être qu'il fallait prendre 155 minutes pour retranscrire ce fait divers, cette histoire vraie. Peut-être qu'il fallait effectivement faire confiance à Cristian Mungiu pour écrire un film sans ellipse où la narration se déroule sans aucune espèce de surprise. Lentement, logiquement, suivant un parcours fléché, il nous conduit jusqu'à l'issue que l'on sait fatale pour Alina.

Au-Delà Des Collines, une histoire d’amour impossible entre deux filles doublée d’une attaque au bazooka de la religion et du prosélytisme aveugle, bête et déconnecté de la réalité, qui conduit à la mort. Au-Delà Des Collines, un film sur lequel on hésite. On est pareil à l'héroïne Voichita. On part confiant. On se dit qu'un type qui a reçu une palme d'or une fois dans sa vie ne peut pas complètement nous décevoir. Et plus on avance, plus la confiance aveugle s'effrite. On ne remet pas en question son talent de metteur en scène, mais tout de même. L'on se demande pourquoi prendre autant de temps pour dérouler un bon dieu de film si académique gangrené par des récits de prières et des bondieuseries sans fin. Forcément, que l’athée qui sommeille en vous, à l’instar de Alina, va finir par péter un plomb. Sauf que vous, vous aurez le choix de quitter la salle, alors que Alina, non. Elle est condamnée à l’enfermement, à la privation d’eau et de nourriture, à trouver la mort mais pas l’amour. Au-Delà Des Collines de Cristian Mungiu, pour public averti!
DESPUES DE LUCIA
Choquant & Violent

Pour son deuxième long métrage, Michel Franco signe un nouveau film choc, cette fois sur la violence et le harcèlement à l’école: Despues De Lucia. Ce cinéaste qui a bourlingué un peu dans la pub, est sorti de l’anonymat en 2010 avec un premier long métrage choc, inspiré d’un fait réel, le kidnapping d’un frère et d’une sœur obligés par leurs ravisseurs de faire l’amour devant une caméra. Avec cet inceste ainsi filmé, les ravisseurs avaient un moyen de pression sans égal pour faire chanter leurs victimes. Daniel Y Ana, c’est le titre de ce film qui avait été dévoilé à la 15zaine des réalisateurs. Bénéficiant du soutien de la Cinéfondation de Cannes, Despuès De Lucia est né sur la Croisette. Dévoilé en première mondiale en mai dernier dans la section Un Certain Regard, il s’est vu remettre par Tim Roth et son jury le Prix du meilleur film. Il faut dire que Despues de Lucia a de quoi taper dans l’œil.

Michel Franco réalise, pour tout dire, le genre de film qu’on se prend en pleine poire et dont on a bien de la peine à se remettre. Il commence pourtant simplement sur un deuil. Un père Roberto et sa fille Alejandra déménagent après la mort de Lucia, la femme de Roberto, la mère d’Alejandra. Ils ont décidé de repartir à 0 à Mexico. Il faut dire que Roberto est bouffé de l’intérieur par une grosse dépression. Il se mure dans le silence et la douleur. Alejandra l’accompagne comme elle peut. Elle le soutient. Cette jeune adolescente découvre son nouveau lycée, un établissement fréquenté essentiellement par des fils et filles de très bonnes familles. L’intégration se passe très bien pour Alejandra jusqu’à ce que le film bascule, comme ça, sans prévenir. Du deuil impossible à faire, on s’oriente vers la violence, le harcèlement, l’humiliation, la souffrance silencieuse et la résignation. En effet, au cours d’une soirée bien arrosée, Alejandra accepte de faire l’amour avec un des mecs de sa classe. Il filme cette relation sur son téléphone portable et s’empresse de mettre les images sur le Net. Alejandra devient dès le lendemain matin la cible, le souffre-douleur du lycée, une trainée selon ses camarades de classe. Ses bourreaux vont alors multiplier les actes de cruauté à son égard. Mais au lieu de se révolter, ou même d’en parler à son père, Alejandra va subir en silence cette violence. Pourquoi ? Pourquoi cette résignation ? Pourquoi ce sacrifice ? Pour ne pas accabler un père déjà en dessous de tout ? Pour ne pas lui créer plus de peine ? Sans doute. En tout cas, l’acceptation de ce traitement de choc va aiguiser encore d’avantage la cruauté des élèves de sa classe.

Despuès De Lucia, un film où le comportement de ces ados va en révulser plus d’un. Il est impossible de rester de marbre, pas tant à cause de la représentation de la violence à l’écran. Il n’y a rien de gore, mais plutôt parce que Michel Franco décrit à merveille la cruauté et la solitude de cette pauvre Alejandra. En subissant brimades, insultes, gifles, elle s’isole, s’enferme dans cette position de paria. Si les adultes qui ne remarquent absolument rien sont terrifiant, y compris son père, les ados rigolards sont encore plus flippants car dénués de tout sens moral, de toute empathie. Le regard posé sur cette jeunesse structurée par la vanne et animée par une volonté d’humilier l’autre, juste comme ça, pour rire, est implacable, sans concession. Et pour parfaire le tableau, Despues De Lucia repose sur un casting impeccable. Ces jeunes acteurs non professionnels sont d’un naturel désarmant. Amis dans la vraie vie de Tessa La, l’interprète d’Alejandra, ils avouent s’être bien marrés sur le plateau parfois, mais pas toujours. Il y a par exemple cette scène où Alejandra se fait couper les cheveux par ses pseudos copines, scène qui les a bien plus terrorisées que n’importe quelle autre humiliation comme l’ingestion forcée d’un gâteau à la merde ! Despues De Lucia, à voir à tout prix.
WAR WITCH
Un Film de Guerre Poétique

Oui, vous ne rêvez pas, Kim NGuyen amène de la poésie là où en principe, on n’en trouve pas. War Witch, un film à la première personne où une jeune fille parle à son futur bébé. Elle raconte son passé d'enfant soldat dans un pays d’Afrique Subsaharienne. Elle vivait paisiblement dans son village retiré lorsqu’un jour, des rebelles ont fait irruption et dézingué tous les adultes. Ils kidnappent une douzaines d’enfants afin de les enrôler de force dans leur bataillon. Ceci dit, Komona, c’est son nom, aura droit à un traitement de faveur. On l’oblige à tuer ses parents avec une kalachnikov. Son père l’implore d’appuyer sur la gâchette. Il sait que si elle ne tire pas, elle mourra aussi. Dès lors, après avoir assassinés ses géniteurs, Komona aura pour nouvelle famille, celle dirigée par Le Grand Tigre Royal, un type à la tête d’une armée anti gouvernementale. Vivant dans la jungle, dans l’ex cité perdue de Mobuto, laissée à l’abandon, Komona ne doit pas pleurer, jamais. Et tant pis si des fantômes viennent la hanter. Oui, elle voit les morts, elle voit leur âme, surtout celle de ses parents. Parce qu’ils n’ont pas été enterrés, ils viennent lui rendre régulièrement visite. Assez paradoxalement, ces visions vont faire de Komona une guerrière d’exception, à tel point qu’elle va devenir la sorcière de prédilection du grand chef. Au milieu de cet infernal chaos, Komona va croiser un jour le regard du magicien, un gamin à peine plus vieux qu’elle. Ensemble, ils tenteront de tourner le dos à cette guerre qui les dépasse, mais pourront-il échapper aux Tigres, à leur destin. Pourront-ils se marier et vivre pleinement leur amour, en paix ? Rien n’est moins sûr.

War Witch, un film de Kim Nguyen avec Rachel MWanda récompensée au Festival de Berlin. Elle joue la jeune femme qui raconte son calvaire. Evidemment que pour elle, ce film est une première expérience de cinéma. Récompensée d’un Ours d’Argent à Berlin, elle est devenue ainsi la première africaine à remporter une telle distinction au Festival de Berlin. Il faut dire que son interprétation est magistrale. Kim Nguyen a trouvé en cette jeune fille une perle rare pour raconter cette histoire d’enfants soldats où visiblement Kim Nguyen a choisi de ne pas tout montrer. Pour se coltiner à la violence du quotidien de ces gamins devenus des machines de guerre, machines à tuer, dépecer, violer, humilier, se droguer, picoler, rigoler, il faut plutôt voir Johnny Mad Dog de Jean Stéphane Sauvère. Les chants, la drogues, la mise en condition, les pillages, les viols, la bande son assourdissante, tout ce qui fait la force de Mad Dog n’est pas dans War Witch. Et c’est justement ce qui est intéressant. War Witch est un parfait complément. La violence est là, mais elle est atténuée par le regard que pose le cinéaste sur cette violence, un regard surréaliste avec ces fantômes omni présents, avec l’amour aussi qui peut surgir n’importe où, y compris au cœur de cette jungle. Il y a donc de l’espoir pour Kim Nguyen, espoir qu’un jour, ces gamins s’en sortent. Ce qu’il n’y avait pas dans Johnny Mad Dog.

War Witch, un métrage pour mieux appréhender une thématique qui semble revenir dans les TJ, celle des enfants soldats. Cette semaine, on a vu des images à la tv de la République démocratique du Congo, un pays en proie à une guerre civile dévastatrice où chaque jour, des dizaines d’enfants meurent. Si jamais, War witch a justement été tourné dans ce pays, le Congo, qui n’a de démocratique que le nom, un tournage sous haute surveillance, encadré par des milices privées pour assurer la protection de l’équipe technique et surtout, de Rachelle. Pour l’anecdote, le palais dans lequel sont réfugiés les rebelles du film n’est autre que celui de la cité perdue construite par le mégalo
Mobutu. Ce décor grandiose à l’abandon était le théâtre idéal pour planter des caméras de cinéma et ainsi enrichir un film aussi éblouissant visuellement parlant que bouleversant émotionnellement parlant.
THERESE DESQUEYROUX
La Meilleure Façon d'Emprisonner

Il s’agit de la 2ème adaptation cinématographique pour ce classique de la littérature française de François Mauriac. En 62, George Franju s’était déjà attelé à la réalisation de Thérèse Desqueyroux avec Mauriac en personne pour signer les dialogues. La version de 62 mettait en scène Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, Samy Frei. C’était vachement bien à tel point qu’on se demande pourquoi Claude Miller, un demi-siècle plus tard, a souhaité proposer sa version, sa vision, au passage, sa dernière. Et pour cause, Claude Miller est décédé en avril 2012. Il n’a même pas pu découvrir son ultime film en clôture du festival de Cannes en mai dernier. N’empêche qu’à la réflexion, au vu de la filmographie de Claude Miller, on se dit qu’effectivement, Thérèse Desqueyroux était pour lui et personne d’autre. Le réalisateur de L’Effrontée, La Petite Voleuse, Betty Fischer, La Chambre des Magiciennes ou encore de La Meilleur Façon de Marcher a trouvé en cette héroïne de roman, la possibilité de dresser le portrait d’une femme au caractère bien trempé, indépendante et empoisonneuse, bref, une femme énigmatique par bien des égards. Claude Miller a toujours aimé se pencher au chevet de ces femmes fortes. Il n’était donc pas question que cette Thérèse lui échappe, une madame Desqueyroux qui a toutes les qualités d’une héroïne Millerienne, pourrait-on dire !
 |
En effet, Thérèse Desqueyroux est prisonnière de son époque, de son milieu, des conventions, de son ennui. Elle trimballe son spleen depuis toujours, fume comme un sapeur, pense beaucoup trop et se réfugie dans la littérature pour oublier sa morne existence de petite bourgeoise provinciale qui ne songe qu’à quitter sa forêt de pins pour aller vivre dans la capitale. Mais Paris pour Thérèse ne restera qu’un songe, un leurre, un rêve inaccessible. Sa vie, c’est ici, dans ce Sud-Ouest de la France qu’elle doit la mener aux côtés de Bernard. Elle est obligée de se marier avec cet homme, certes bon, mais dont la médiocrité intellectuelle finira par l’achever. Il ne pense qu’à son nom, qu’à ses terres, qu’à sa mère, qu’à sa sœur qu’au qu’en dira-t-on. En effet, Anne est amoureuse d’un israélite, un jeune garçon qui n’est pas de leur rang. Anne se fiche des menaces de son frère Bernard. Elle aime son jeune amant et est prête à tout pour vivre pleinement cet amour. Mais Bernard est lui aussi bien décidé à tuer dans l’œuf cette relation. Entre ses frères et sœurs qui se déchirent, Thérèse Desqueyroux sert d’arbitre. Mais Thérèse est jalouse d’Anne, de cet amour si pur, si sincère qu’elle éprouve pour son israélite. Thérèse qui en pince depuis toujours pour Anne ne sera pas à la hauteur de la confiance aveugle que lui porte son amie.

Therese Desqueyroux, un portrait de femme, un film porté par Audrey Tautou et Gilles Lelouche, tous deux convainquants, mais sans plus. Cette version de Claude Miller à moins de puissance, de force que celle de Franju. Il faut dire qu’il avait la bonne idée de commencer cette histoire par l’épilogue, sur le perron du Palais de Justice. Franju installait immédiatement le trouble le temps d’une conversation entre le père de Thérèse et son avocat pour trouver le moyen d’étouffer l’affaire après que la justice ait décrété un non-lieu à la suite de la tentative de meurtre contre son mari. Ainsi, en ouvrant son film sur le verdict, Franju manipulait insidieusement le spectateur, l’obligeant à porter un jugement négatif sur cette meurtrière en sommeil. A grand renfort de flash-back, il allait ensuite s’ingénier à montrer les travers de cette femme qui emprunta la voix du crime pour s’affranchir, se libérer du poids d’une vie dont elle se sentait si prisonnière. En 2012, les femmes se sont émancipées depuis belle lurette. Claude Miller le sait bien et du coup, il choisit de suivre une autre logique, sans flash-back. Il met directement l’accent sur la complexité du personnage de Thérèse, sur cette période de l’adolescence où tout déjà semble s’être joué pour elle. Tout commence donc en cet été 1922. Deux gamines se baladent à bicyclette. On les sent complices, amies, sœurs de cœur mais pas de sang. Cet été-ci, Thérèse comprend qu’elle a un penchant certain pour son amie Anne interprétée par Anaïs Demoustier. Mais Anne ne se rend compte de rien. En avril 1928, les adolescentes ont poussé. Thérèse est sur le point de se marier avec le frère d’Anne. En ce temps-là, les mariages d’amour, surtout dans ces familles bourgeoises, n’avaient pas souvent court. Thérèse et Bernard s’unissent donc par intérêt. Les deux familles vont ainsi régner sur des centaines d’hectares de forêts de pins au cœur des Landes. Autant dire que leur avenir sera assuré et pour bien des générations. Ainsi va la vie pour Thérèse qui s’emmerde toujours un peu plus. Elle s’ennuie jusque pendant son voyage de noce. Alors quand Bernard lui propose de rentrer au bercail afin de venir en aide à Anne, tourmentée par un garçon dont elle s’est amourachée et qui n’est pas de leur condition, elle acquiesce. Loin d’être l’homme parfait imaginé par sa famille, Anne va s’en remettre à Thérèse pour l’aider à ouvrir les yeux de sa mère et de son frère, …. En vain, puisque Thérèse va lui planter un couteau dans le dos….la tentative d’assassinat de son mari viendra ensuite. Thérèse Desqueyroux, un destin bouleversant pour un film qui ne l’est jamais. Dommage !
NO 89 SHIMEN ROAD
Toujours sur plus ou moins la même thématique, à savoir la quête initiatique d’un jeune garçon en passe de devenir un jeune adulte, sortira prochainement le premier long métrage de Haolum Shu. No 89 Shimen Road. Il s’agit d’un film chinois qui nous catapulte à la fin des années 80 à Shanghai. Un ado de 16 ans, élevé par son grand-père, est fou amoureux de sa voisine un peu plus âgée que lui. La mère du jeune homme est partie vivre aux Etats Unis. Lui, il ne veut pas trop y aller. Il est bien dans son pays la Chine, alors que elle, elle boit du coca. Elle rêve de se tirer. Et pour ça, tous les moyens seront bons. D’ailleurs, sans s’en rendre complètement compte, en tout cas au début, elle va devenir call girl pour de riches hommes d’affaires chinois. Evidement que l’ado va vivre très mal cette situation. Mais il restera silencieux. D’autant qu’il a fort à faire avec une copine de classe, très engagée politiquement parlant. Et oui, l’action se situe aux environs du 4 juin 1989 qui coïncide avec le massacre de la place Tienanmen.

No 89 Shimen Road, un film sur cette jeunesse troublée, qui a besoin de pouvoir s’exprimer librement mais qui en est empêchée par l’Etat. Si sur le fond, le film est vraiment bien, sur la forme aussi, il est brillant. Au début, cela commence avec des photos en noir blanc qui se succèdent. Le réalisateur parle en voix off et nous explique comment il a choppé le virus de la photo. Il se voyait en Bresson chinois. Ces images fixes alternent avec des images qui bougent pour de bon…. Plus tard dans le récit, des images d’archives sont judicieusement intercalées, des images de ces manifestations étudiantes. On voit réellement la répression et surtout, comment est-ce qu’est vécue loin de cette agitation, cette révolution écrasée dans le sang. A dire vrai, les gens loin de la ville s’en foutent un peu… No 89, Shimen Road, un film réellement passionnant et très prenant.
APRES MAI

Dès demain, sortira en salle le nouveau film d’ Olivier Assayas. Le réalisateur BIOPIC sur le terroriste Carlos revient à quelque chose de plus intimiste et personnel surtout. Parce qu’il n’avait toujours pas vu LE film sur les années 70 qu’il rêvait de voir, il l’a fait… Mais alors, attention, ce sont CES années 70 à lui, une période où la politique était partout, dans la littérature, le cinéma, au lycée, au troquet du coin. On ne pouvait pas y échapper… une époque où la jeunesse semblait pleine d’espoir. Elle rêvait d’un avenir brillant. Faut dire qu’eu début des années 70, après le tumulte causé par mai 68, on y croit encore. Mais on croit à quoi ? Pas au parti communiste, aveugle et engoncés dans ces conceptions, incapables de remettre en question quelques évidences comme la possible dérive de l’URSS vers le totalitarisme. On ferme sa gueule su MAO. On ne critique pas MAO et encore moins Pompidou quand celui-ci annonce la visite de Brejnev à l’Elysée…

Pour coller au plus près de sa vision des années 70, Olivier Assayas a pioché dans des éléments de sa propre vie pour nourrir son scénario. On est en fait en 1971. Olivier Assayas doit avoir une quinzaine d’année. C’est le personnage de Gilles qui se rapproche le plus de lui. Issu d’une famille cultivée, Gilles va traverser la décennie comme il le peut. Il va expérimenter le chagrin amoureux, puis le flirt, chercher sa voix et surtout, ne jamais oublier de conserver son esprit critique à l’égard du gauchisme, du militantisme, contrairement à ses camarades de lycée. L’engagement oui, mais jusqu’à un certain point.
Gilles, aime la littérature autant que le cinéma. Gilles va surtout trouver sa voix en poussant la porte des Studio Pinewood. Il sera sur le tournage d’un film étrange, avec des nazis chasseurs de dinosaures, du pur divertissement dans une époque révolutionnaire où normalement, on ne devrait pas en produire.

Après mai un film qui invite à toutes sortes de réflexions, sur le 7ème art, sur la syntaxe révolutionnaire, sur cette époque où les révolutionnaires étaient tout de même de beaux spécimen de machos…
LE CAPITAL

Le nouveau Costa Gavras qui ne fera pas que des émules surtout en Suisse, puisqu’il épingle le système bancaire, un système devenu fou, laissé entre les mains de grands enfants qui sont en train de casser leurs jouets. Alors dans ce cas, soit on répare le joujou, soit on le jette pour en acheter un neuf. Mais dans Le Capital, Gavras ne donne aucune solution. Le cinéma ne sert pas à ça. Il sert juste à aider le spectateur à se poser des questions. Et on s’en pose, une en tout cas : pourquoi Gad Elmaleh dans le rôle du banquier sans scrupule, qui ne pense qu’au fric et au pouvoir ? Réponse, parce que Costa Gavras a toujours adoré les contre emplois. C’est un spécialiste en ce domaine. Il l’a prouvé de par le passé avec José Garcia en chômeur sereal killer dans le Couperet, avec Jack Lemon dans Missing, film sur le coup d’Etat de Pinochet au Chilli alors que Jack Lemon était essentiellement étiqueté acteur de comédie pour Billy Wylder entre autre… Même Yves Montand, avec qui il a bossé au début de sa carrière, il lui a proposé des rôles à contre-emploi…

C’est parce que Costa Gavras adore les acteurs. Il adore leur proposer de nouveaux personnages qu’ils n’ont jamais joué pour ensuite justement expérimenter des choses, les modeler.. .Le problème c’est que Gad Elmaleh est un peu limité en tant que comédien. Il manque encore bien des ficèles à son arc pour être convainquant. Ici, il se retrouve au début du film à prendre la direction d’une grande banque, un mastodonte européen. Le jeune requin va devoir montrer les dents pour conserver son poste et ses avantages, le yacht, le jet, les gonzesses, les voyages…enfin bref.. .Ca va pas être simple car dans ce panier de crabes, tous les coups sont permis, à commencer par les coups venus d’outre atlantique. Parmi les actionnaires de cette banque européenne, il y a en effet Gabriel Byrne qui représente les actionnaires américains et qui met une pression du tonnerre sur ce jeune président qu’est Gad Elmaleh. Voilà comment, Gad se retrouve à proposer un plan social, 15000 licenciements dans son groupe afin que l’action monte de 15 à 20 pour cents. Les banquiers sont contents… C’est tout ce mécanisme-là, complexe, et bien d’autres encore que Costa Gavars tente de décrypter dans LE CAPITAL.

D’aucuns diront qu’ils enfoncent des portes ouvertes, que le film est truffé de phrases toutes faites, que sa vision des choses est beaucoup trop manichéenne.. .peut-être un peu, mais il n’est quand même pas loin de la vérité. Costa Gavras a toujours tapé là où ça faisait mal et il le fait, avec pas beaucoup de finesse, mais il le fait tout de même et rien que ça mérite d’être souligné.
LA CHASSE
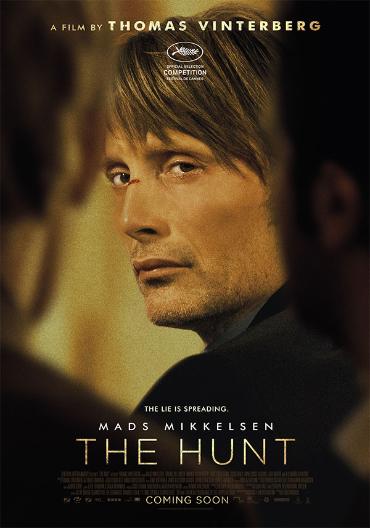
LA CHASSE, s’appuie sur un sujet fort et une réalisation brute de décoffrage. Au début, ça rigole, ça picole, ça parle fort, ça se réchauffe. Lors de cette soirée entre potes, on s'arrête sur l'un des gars du groupe, Lucas, séparé de sa femme et qui cherche à récupérer la garde de son fils adolescent. Lucas travaille dans un jardin d'enfants. Il est complice et joueur avec tous les mômes de cette crèche. Un jour Klara qui est amoureuse de lui, lui offre un cœur en plastique et lui déclare qu'elle l'aime en lui faisant un bisou amical sur la bouche. Lucas explique à cette enfant en très bas âge qu'elle doit donner son cœur à un autre garçon de son âge mais pas à lui. Un petit mensonge plus tard, raconté innocemment comme ça, pour se venger, à la directrice de ce jardin d’enfants et c’est la rumeur qui grandi. Elle se répend dans ce petit village, une rumeur qui aura de très lourdes conséquences sur la vie de Lucas, mais aussi de tous les habitants du village.
Si vous pensez que la vérité sort toujours de la bouche des enfants, LA CHASSE devrait vous faire réfléchir. Parce que tout le monde ment, y compris les enfants, Lucas va devenir le gibier que l'on chasse, que l’on moleste, que l’on tabasse, à qui l’on interdit de venir faire ses commissions à la supérette, et j’en passe. Devenu la bête ignoble, celui que l'on ne veut plus voir, Lucas va résister mais jusqu’à quand tiendra-t-il le coup?

LA CHASSE, un film avec une tension absolue. Thomas Vinterberg, qui depuis Festen s’était égaré en signant des films anecdotiques, revient en force avec un film coup de poing, une belle grosse tarte. La Chasse est porté par un casting exceptionnel, à commencer par Mads Mikkelsen, le chassé, le chiffre de Casino Royale, le Viking silencieux dans Valhalla Rising accessoirement aussi le Igor Stravinski amant de Coco dans le film de Jan Kounen Un type hallucinant en tout cas récompensé d’un prix d’interprétation au dernier festival de Cannes pour son rôle dans LA CHASSE…
THE IMPOSSIBLE

The IMPOSSIBLE de Juan Antonio Bayouna, réalisateur il y a 4 ans de L’Orphelinat, film de maison hantée par le fantôme d’enfants morts et martyrisés… du sous Shyamallan mais tout de même efficace… dans le registre film de genre.
Ca pouvait être intéressant de voir comment il allait se dépatouiller avec une histoire vraie adaptée au cinéma. Ce nouveau film s’appelle THE IMPOSSIBLE et laissez-moi vous dire qu’il a torché un tire larmes insipide, insupportable, lamentable, bref un film lacrymal qui donne réellement envie de pleurer mais pas pour les raisons recherchées par le cinéaste !
THE IMPOSSIBLE est sans aucun doute sponsorisé par kleenex, un film jetable comme un mouchoir en papier, Inspiré du Tsunami Thaïlandais de 2004.
Ça commence plutôt mal avec un écran noir et une Bande son super angoissante. Dans cette 1ère image, un plan fixe, on découvre une mer calme vue du ciel. On est dans un avion le temps d'une scène d'exposition de personnages où papa Mc Gregore flippe face à la flegmatique Naomi Watts sa femme, la mère de leurs 3 enfants. Il ne sait plus s’ils ont enclenché l'alarme de la maison. Super mal mis en scène.

Ils arrivent au paradis sur terre et prennent leurs quartiers a KAHO Lak, un endroit paradisiaque avec piscine et paillotes face à la mer. Ici les gens s'aiment sur la plage, ils se roulent des pelles. Et d'un seul coup, ce que le spectateur attend arrive enfin. Si vous avez vu le piètre AU DELÀ de Clint Eastwood, ben c'est la même scène mais qui s'étend sur au moins 20 minutes. Cette scène est super bien fichue avec deux vagues successives. La mère et l'un de ses fils sont emportés par les courants. Ils échappent à la noyades, se blessent. D'un réalisme confondant.

Aux blessures profondes physiques s'ajoutent le choc psychologique et puis surtout la peur. Ils ne savent pas où est le reste de la famille ! Morts ou vivants? Blessés ou pas ? Il faut quand même survivre dans ce décorum ravagé, peut-être se percher sur un arbre en attendant les secours. La tu sens l'influence de Vynian avec Emmanuel Beart en mieux. C'était aussi sur le Tsunami avec un couple qui recherche le corps de leur fils dans des territoires désolés, 1 an après le tsunami. C'était chiant Vynian au bout d'un moment, on se demandait même s’il était possible de faire pire.... ben oui avec Naomi Watts qui lutte, Naomi et sa scène à demi gore a l'hôpital où maman gerbe de la ficelle ensanglantée, un hôpital désorganisé forcément.
THE IMPOSSIBLE, un film truffé de passages too much pour qu'on s'apitoie encore plus sur le triste sort de pauvres gens. C'est dégoulinant au possible. Y a un faux suspens avec des perdus de vue qui se croisent sans se voir et multiplie le procédé. C'est naze. Et encore j'ai passé sous silence ces envolées de violon insupportables pour surligner la tristesse, pour finalement amener un surplus d'émotion. C’est finalement gerbant. T’a qu’une hâte, qu’à la fin le prévisible arrive. Avec un peu de chance, tu auras droit à un petit coup de tsunami en flash back… Ce sera super tu verras…
The Impossible, de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts et Ewan Mc Gregore et leurs lentilles rouges !
NOUS YORK :
Nul York !
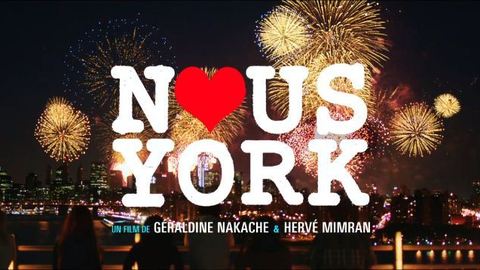
Un film sans personnages, sans histoire, sans gags, sans dialogues percutants, sans rebondissements, sans musique originale, sans direction d’acteurs, sans acteurs, sans réalisateur, sans directeur de la photo, sans scripte, ça vous fait envie? Non ? Et pourtant, Géraldine Nakache et Hervé Mimran l’ont fait. Il s’appelle NOUS YORK, avec nous écrit N O U S. Rien que ça, c’est un indice suffisant pour fuir la chose en question. Ce jeux de mot foireux dans le titre laisse craindre le pire. Et bien non. Ce n’est pas le pire. Mais bel et bien le meilleur….

En fait, NOUS YORK est le plus parfait exemple de non film de l’histoire du 7ème art. Oui, un truc inutile où l’on rempli l’espace avec du vide, du rien. Dans bien des films, on relève souvent des problèmes de rythme, certaines longueurs dommageables. C’est d’autant plus vrai avec Nous York. il dure 1h38. C’est 1h38 de trop! C’est tellement du foutage de gueule, que l’on suspecte que le directeur de la photo a démissionné au beau milieu du tournage. Imaginez une scène d’intérieur, dans un salon baignée par la lumière d’un lever de soleil éblouissant. La caméra est face au soleil. Sur l’écran, l’image est blanche. On ne distingue même plus les pantins qui gesticulent sur l’écran. Effet de style pensez-vous ? Même pas. Je dirais plutôt clin d’œil lourdingue au précédent film de Nakache intitulé TOUT CE QUI BRILLE….Non mais y a de quoi rester aveuglé par tant de médiocrité. Et l’on en vient alors à se demander : A qui profite ce crime? Parce que produire un film pareil et le sortir en salles ensuite est un crime. Qui et pourquoi dépenser de l’argent dans une production telle que celle-ci en sachant que l’on ne récupérera jamais l’investissement de départ… A part une mafia quelconque qui a voulu blanchir du fric en noircissant à ce point le cinéma, je vois pas…

Donc y a rien dans NOUS YORK, et dès la première ligne de dialogue, tu te dis que ça va puer l’escroquerie. Un film qui débute sur de la pub comparative entre deux grandes surfaces qui vendent du saumon… Géraldine Nakache, Leila Bekti. Les deux nanas de tout Ce qui brille se sont expatriées à New York . A Paris, les amis, la famille s’imaginent qu’elles ont réussi. Pourtant, c’est pas le Pérou, l’une d’elle fait des ménages dans un EMS réservé aux juifs et l’autre est esclave de star, un Ipad sur patte, un Ipate en quelque sorte qui gère l’agenda d’une vedette de cinéma colérique, capricieuse et égocentrique. Le seul intérêt de ce job est de profiter de l’appartement de la star en son absence. Ce qu’elle fait. Et ses copains parisiens d’enfance venus fêter son anniversaire aussi. Manu Payet et deux autres mecs déboulent donc à New York en ne connaissant qu’un seul mot : Obama, qu’ils utilisent comme un cri de ralliement. Et voilà que ces 5 personnages vont vivre une semaine à New York, voir un peu plus, un séjour au cours duquel il ne leur arrive rien et où tout le monde va faire son petit bilan. Voilà à quoi se résume Nous York. De toute façon, un film avec Marthe Villalonga créditée au générique, on ne pouvait pas s’attendre à un chef d’œuvre. Il est loin le temps où la mère de Bouli dans Un Eléphant ça Trompe Enormément ou NOUS IRONS TOUS AU PARADIS faisait les beaux jours du cinéma français. Yves Robert n’est plus. Aujourd’hui, le cinéma français doit se fader une génération montante de médiocres qui se prennent pour des cinéastes alors qu’ils ne sont même pas d’honnêtes vidéastes amateurs et dont la meilleure ambassadrice est indubitablement Géraldine Nakache.
La Pirogue
Un boat movie palpitant

La Pirogue, le nouveau long métrage du sénégalais Moussa Touré, son 3ème film de fiction en presque 20 ans pour vivre, il a été contraint de faire des documentaires. Son précédent film, TGV avec Bernard Giraudeau était vachement bien, un road-movie entre Dakar et Conacrie à bord d’un taxi brosse, l’occasion de pointer les failles du gouvernement de son pays, et aussi d’alpaguer les européens et leur bonne volonté, leur bonne conscience à la con qui fait parfois plus de dégâts qu’autre chose. Si vous avez l’occasion, regardez TGV de Moussa Touré.

Si vous avez l’occasion aussi, allez au cinéma voir LA PIROGUE, un film adapté du roman "Mbëkë mi. A l'assaut des vagues de l'Atlantique", d'Abasse Ndione, Editions Gallimard, Collection: "Continents Noirs". Vous l’avez sans doute deviné, La Pirogue relate donc une traversée à haut risque pour 30 passagers clandestins, réfugiés à bord d’une embarcation en partance pour les îles Canaries en territoire espagnol. Pour la plupart des passagers, ils sont issus d’un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar. Il y a 29 hommes et une seule femme attifée en homme pour faire diversion. Ils sont conduits par Baye Laye, un capitaine de pirogue expérimenté, sans doute le seul à savoir réellement ce qui les attend. A tel point d’ailleurs qu’il n’est pas très chaud. Ceci dit, Baye Laye a besoin d’argent pour nourrir sa famille, alors, il y va malgré tout, il prend la mer avec ces personnes dont certains n'ont jamais vu l’océan. Guidés par l’espoir de vivre une vie meilleure en Europe, ils sont prêts à tout quitter, femme, enfant, famille, amis pour tenter leur chance. De toute façon, comme il est dit dans le film, s’ils restent au Sénégal, ils ont 9 chances sur 10 de rater leur vie… Alors autant partir.

La Pirogue, un boat Movie, qui a fait sensation dans différents festival, de Cannes à Locarno, en passant par Lausanne à la fin août lors du festival Cinémas d'Afrique. Moussa Touré qui est un super directeur d’acteurs et qui surtout, est le meilleur cinéaste qui soit pour filmer un huis clos. Parce qu’il a fait 3 longs métrages, 3 huis clos… ici, c’est encore le cas. Pratiquement tout le film a été tourné sur cette embarcation. Il est né au milieu d’une famille de 35 enfants, donc forcément, quand tu deviens cinéaste, ça aide pour savoir où se placer et observer du mieux possible, sans déranger, sans se faire remarquer. Et puis, il n’a pas son pareil pour diriger ses comédiens… il a su les déstabiliser pour obtenir ce qu’il voulait. C’est à dire que ce margoulin les a mis en confiance. Il leur a fait regarder Master And Commander de Peter Weir pour qu’ils apprennent à se déplacer sur un bateau… il a fait des répétitions dans une pirogue dans un port. Il leur a demandé d’apprendre par cœur leurs dialogues. Et le premier jour de tournage. Il a tout changé. Il les a emmenés loin des côtes en pirogue. Certains n’avaient jamais pris le bateau et là, il a tourné au moment où il leur disait de se lever. Panique à bord pour certains. Il a choppé de vraies réactions de pétoche qu’il a inséré ensuite dans son film quand il en avait besoin… C’est un très bon faiseur Moussa Touré, qui a réalisé un très bon film, émouvant, juste, LA PIROGUE, en salles, sur ces voyages de la mort.
ARGO
Une très cool supercherie

Le 3ème long métrage de Ben Affleck, acteur de renom qui a su alterner les comics façon Daredevil, les comédies insignifiantes comme Famille à louer, les comédies plus réussies comme Dogma où il était un ange exterminateur, les thrillers sous tension comme Paycheck de John Woo…. Mais Ben Affleck n’est jamais autant meilleur que quand il s’écrit ses propres rôles. Souvenez-vous de ce détective dans son premier film en tant que réalisateur, Gone Baby Gone, un privé torturé, qui part sur les traces d’une gamine de 4 ans qui a disparu mystérieusement. Gone Baby Gone, un film à l’atmosphère parfaitement poisseuse. Toujours à Boston, la capitale mondiale des braquages, il a réalisé The Town où là encore il jouait un chef de gang de braqueurs. Il était très bon ce film. Ben figurez-vous que pour son 3ème long métrage Ben Affleck prend de l’ampleur et s’octroie une fois de plus un rôle à sa mesure, celui d’un agent de la CIA ex-filtreur professionnel dans Argo.

Argo retrace la crise des otages américains en Iran entre le 4 novembre 1979 et le 20 janvier 1981. Ben Aflfleck a la très bonne idée de débuter ARGO par un cours d’histoire iranienne en accéléré. On est en 1951, Mohammad Mossadegh le premier ministre nationalise le pétrole. Evidemment les américains tirent la gueule, donc ils fomentent un coup d’état avec l’aide des anglais et confient les reines du pouvoir à un pantin, en l’occurrence le fils du président en place qui dilapide le pognon, se fait livrer ses repas en concorde tous les jours, pendant que son peuple crève la faim. Il réduit les libertés individuelles et on assiste à la montée de l’Islamisme. L’Ayatollah Khoméni, futur guide suprême sort de l’ombre. En février 79, c’est le bordel le plus total. Khoméni prend le pouvoir après 15 ans d’exil. Des tribunaux révolutionnaires voient le jour à travers tout le pays. C’est la grande purge. On élimine les figures de l’ancien régime et les opposants du nouveau. On instaure une république islamique en avril 79. Le sentiment anti-américain atteint son paroxysme avec ce que l’on a appelé la crise des otages. Et le film peut alors débuter. Tout ça est résumé en 4 minutes tout au plus avec des images d’archive, de bande dessinée quand on n’a pas d’archives. On est plongé directement au cœur de la grande histoire. A Téhéran, des gens manifestent devant l’ambassade américaine. Le peuple en colère la prend d’assaut. Panique à l’intérieur de l’édifice. On efface toutes les traces. Les déchiqueteuses tournent à plein régime. Finalement, l’ordre est donné de décamper en vitesse. Trop tard, les assaillants sont entrés dans les couloirs de l’ambassade. 6 membres parviennent tout de même à s’échapper discrètement. Ils trouvent refuge dans celle du Canada. Enfermés ici sans possibilité de sortir sous peine d'être repérés, arrêtés, torturés puis tués, ils attendent l’intervention des services secrets de leur pays pour être libérés.
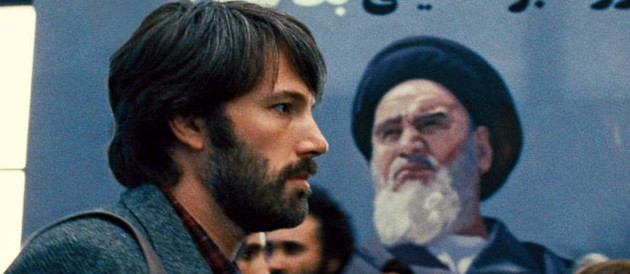
Aux Etats Unis, on envisage plusieurs plans pour les exfiltrer, dont des pistes assez farfelues. On projette très sérieusement par exemple de leur livrer des vélos pour qu’ils rejoignent la Turquie en pédalant. Mais on s’interroge. Savent-ils faire du vélo ? Alors on se dit qu’il faudra leur envoyer aussi des roulettes ! Bref, ça déconne plein tube à la CIA jusqu’à ce que Tony Mendez, alias Ben Affleck le spécialiste de ce genre d'opération secrète à haut risque préconise de monter un gros bobard. Il faut les faire passer pour une équipe de cinéma canadienne en repérage en Iran. Et voilà comment avec l'aide de John Chambers (alias John Goodman), il vont monter cette supercherie. Chambers est connu comme maquilleur d’exception. C’est lui qui s’est occupé des primates de la planète des singes. Il est tellement bon, qu’il a été récompensé aux oscars. Mais ce John Chambers a surtout l’habitude de bosser pour la CIA et notamment avec Tony Mendez… D’ailleurs, très vite, Tony se rancarde avec lui. Il le met au courant de cette affaire d’otages à Téhéran, et lui demande son aide pour monter cette escroquerie. A ce moment-ci, le film prend un tournant comique inattendu. Exit le film politique sérieux. On assiste à une attaque en règle d'Hollywood. Chambers parle d'un film de SF sur lequel il bosse. Il est clair. Je cite la conversation :
-Le public cible va détester, dit-il
-Qui est le public cible?, lui demande-t-on
Des gens avec des yeux….

Donc là pendant 20 ou 30 bonnes minutes, Ben Affleck se lâche sur Hollywood et les nababs de pacotille qui peuplent l’usine à rêve. D’ailleurs, il lui faut un producteur qui joue les nababs. Ils en ont un qui pourrait être mis dans la confidence. Le type marche à fond. Ça lui plait. Il loue des bureaux, fait faire des cartes de visite, installe une ligne de téléphone parce qu’il faut que la supercherie ait l'air vraie. Ensuite, ils choisissent un script au pif sur les centaines qui croupissent dans des tiroirs. Le type met une option sur un scénario qui se passe évidemment en Iran. On prend des acteurs bidon et on convoque la presse à une première lecture avec petits fours et champagne, tout ça pour se garantir une demi-page dans Variety, histoire de renforcer la couverture. Bref, en quelques jours, on est prêt à vendre du vent. ARGO remake de Star Wars avec une princesse tralala itou et un chubaka bleu sont annoncés. L'opération ARGO est lancée. On se marre bien et le film de Ben Afleck peut rechanger de registre. Exit la comédie, retour au film d’espionnage, au thriller psychologique comme on savait en torcher dans les années 70, avec un réel suspens. On suit l’opération d’exfiltration, sans doute la plus couillue jamais mise sur pied par la CIA.

ARGO, un putain de film. Ils sont rares. C’est de loin celui pour l’instant qui trône à la première place de mon palmarès 2012. ARGO s’appuie sur une réalisation efficace sans fanfreluche. La seule course poursuite à lieu un peu avant la fin. Il n’y a pas de gadget à la gomme. Le suspens, le rythme, le scénario, le casting, la direction d’acteurs, la mise en scène, la reconstitution historique, tout est bon dans ARGO. En plus, le film est divertissant en même temps qu’il vous permet de réviser une leçon d’histoire. Et puis, l’autre force de ARGO, et ça, c’est la griffe Ben Affleck, c’est qu’il réalise un film où l’humain est au centre de ses préoccupations. Oui, c’est l’être humain avec ses failles, ses doutes, ses convictions, ses audaces ou au contraire, son manque d’audace qui le passionne. Il met en avant le courage de l'ex-filtreur, mauvais père qui sera absent pour l’anniversaire de son fils mais en même temps excellent organisateur dans son job, excellent comédien capable de mener en bateau les autorités iraniennes. Ce gars prend la responsabilité de cette opération contre l’avis de sa hiérarchie et du coup, il va forcer le président Carter à prendre les siennes. Ben Affleck n’oublie pas non plus de s’attarder sur les otages, sur leurs peurs. Ces 6 personnages doivent s'inventer une vie et ils ont 48h pour faire croire aux iraniens, à cette vie imaginaire. ARGO, de et avec Ben Affleck, Jhon Goodman, c’est incontestablement, LE film a voir en salles.
Les Enfants Loups
Une émouvante
Louve-Story

LES ENFANTS LOUPS de Mamoru Hosada, une production des studio Chizu, créés exprès pour réaliser ce film. Et ce qui frappe immédiatement avec ce manga, c’est la ressemblance avec Frankenweenie de Tim Burton. On est face à des artisans qui limitent le recours aux technologies au minimum. Burton aurait pu faire son Frankenweenie en synthèse. Pareil pour Mamoru hosada… Et ben nom. Ici, tous les dessins ont été réalisé à la main, un par un. Autre similitude, le thème principal, la différence. Dans LES ENFANTS LOUPS, derrière la fable, on découvre un film sur la difficulté de vivre loin des standards, en marge de la masse. Quand on est différent des autres, on est obligé de masquer, de cacher cette différence aux yeux du monde pour continuer à vivre à peu près normalement. La solution de la fuite en avant n'en n’est pas forcément une. Voilà ce que raconte LES ENFANTS LOUPS avec aussi évidemment la prédominance d’un thème bien dans l’air du temps: Le retour à la nature, à l’état presque sauvage.
Tout débute ici avec une petite fille qui raconte l'histoire de sa mère. Elle est allongée dans l'herbe et aperçoit un homme flou. Elle raconte alors la rencontre à l’université entre sa mère et cet autre étudiant si différent qui ne prenait jamais de note. Le jeune garçon qui n'est pas inscrit officiellement, intrigue de plus en plus la jeune fille. Elle décide de l’aborder, elle en tombe follement amoureuse. Toutefois, ce jeune homme a un secret. Il est un homme loup. Oui, il a la faculté de se fondre dans la masse sous l’apparence d’un humain, mais aussi celle de redevenir un mammifère carnivore. La demoiselle n’a que faire de cette différence. Elle veut vivre sa louve story à fond avec l’élu de son cœur. Et voilà comment, 9 mois plus tard, elle met au monde deux enfants, qu’elle devra ensuite élever seule. C’est que l’homme loup a été abattu par la police alors qu’il sillonnait les rues de la ville, à la recherche d’une proie. La vie va se compliquer pour cette mère célibataire, mère de deux enfants loups. Faut-il aller chez le pédiatre ou le vétérinaire quand les enfants sont malades ? Et comment éviter d’être rattrapé par les services sociaux, d’autant que ces enfants n’ont été déclarés nulle part puisqu’elle a accouché dans le secret, seule, dans son appartement. Avec une petite fille capricieuse mais choux comme tout, qui se change en louve à la moindre colère ou crise de joie, la vie en ville devient impossible. En plus les deux gamins crient la nuit comme des loups. Le voisinage se plaint. L’unique solution pour vivre heureux est de vivre cachés du reste du monde, loin de la ville, dans un village presque désert.

LES ENFANTS LOUPS, un animé super joli et intelligent avec ça, qui permettra d’expliquer bien des valeurs essentielles à vos têtes blondes… le film rend hommage au courage des mères célibataires. Il véhicule d’autres valeurs, comme la solidarité et l’entraide. Il insiste aussi sur le fait que l’homme a pourri la vie de dame nature qui le lui rend bien avec des pluies diluviennes aux conséquences fâcheuses pour la faune, la flore et les êtres humains. Et puis, LES ENFANTS LOUPS parle aussi des choix de vie qui s’offre à chacun de nous. En l’occurrence, en grandissant, les enfants devront choisir entre un retour aux racines ou alors, comme leur parents, mener une vie d’homme. LES ENFANTS LOUPS, un animé très beau, du bel ouvrage par Mamoru Hosada, le réalisateur de Summer Wars et La Traversée du Temps, deux films excellents là encore.
Frankenweenie
Enfin, il l'a fait !

Tim Burton, pour la deuxième fois cette année revient au cinéma, après Dark Shadows accueilli mollement par la critique. Ceci dit, je ne suis pas certain que Franklenweenie fasse mieux que que Dark Shadows. Et pourtant, ce film d’animation en noir blanc et en stop motion devrait rencontrer son public, au moins les amateurs de Tim Burton, qui remonteront ainsi à la source de l’inspiration de leur idole. C’est vrai que Frankenweenie marque le grand retour aux débuts de Tim Burton. Il faut se souvenir qu’il y a une trentaine d’années, il n’était qu’un vulgaire tâcheron chez Disney. Il croquait du Rox et Rouqui à longueur de journée. Pour s’éclater, on peut trouver mieux! Evidemment que très vite, sa vision du dessin ne sera plus en accord avec celle de Mickey, qui lui laissera néanmoins sa chance. Il signe un premier animé avec la voix de son idole Vincent Price et dans lequel un petit garçon est fan de films d’horreur. Ce premier court en stop motion film est mis au placard. On lui donne une seconde chance. Cette fois, ce n’est pas de l’animation mais de la prise de vue réelle. Le court métrage s’intitule Frankenweenie et raconte comment un enfant ramène à la vie un soir d’orage, son chien écrasé par une voiture, un hommage à Frankenstein. N’empêche qu’en 1984, Frankenweenie n’emballe absolument personne chez Disney! Tim Burton prend la porte et c’est tant mieux pour l’histoire du cinéma! Tant mieux pour la Warner qui le récupère. On lui confie un budget dérisoire pour tourner Pee Wee, qui sera un succès surprise au box office. La carrière de Tim Burton est enfin lancée.

Ce qui est intéressant avec le Frankenweenie 2012, c’est que Tim Burton reprend exactement l’histoire de l’originale. Certes, il tire sur la corde, rajoute des scènes pour atteindre une durée de 90 minutes. Par exemple, dans le court métrage, le chien meurt au bout de 3 minutes. Alors qu’en 2012, ça prend un peu plus de temps. Tim Burton introduit de nouveaux personnages. Il se fait réellement plaisir en imaginant des scènes impossibles à réaliser en 1984 en prise de vue réelle à moins d’exploser le budget. Rejouer Godzilla en animation avec une tortue en caoutchouc et des décors en papier mâché est moins coûteux avec des maquettes et des marionnettes qu’avec des monstres géants qui piétinent des vrais décors, et pourquoi pas, qui éclaffent des vrais acteurs… De toute façon, dans la version originale, il n’y avait pas de monstres. Dans celle de 2012, Godzilla est bien présent. Burton rend hommage aussi à Draculla, aux Greemlins, et j’en passe. C’est pour cela qu’il a repris ce vieux film, pour enfin matérialiser un vieux fantasme. Il n’était pas question de simplement humer le parfum pas très enivrant de la nostalgie. Pas lui…. Pas Tim Burton. Il a juste cherché à se faire plaisir en développant en stop motion, tout ce qu’il n’avait pas pu concrétiser dans les années 80. Le résultat est à la hauteur de ses espérances, de nos espérances, jouissif à souhait. Peut-être parce que ce film-ci est sans aucun doute le plus personnel de sa filmographie. Il raconte ni plus ni moins qu’une partie de son enfance. Tout petit Tim Burton était un gamin solitaire qui bouffait de la bobine, essentiellement des films de monstres, et autres productions plus gore de la Hammer, exactement comme le Victor Frankenstein de Frankenweenie. A l’adolescence, il réalisait déjà des petits courts métrages en super 8 et prenait un malin plaisir à faire peur aux petits mecs de son âge en leur inventant des histoires de martiens envahisseurs mangeurs d’homme. Tout ça, on le retrouve dans la psyché du héros Victor, un cinéaste en herbe.

L’animé débute justement par la projection dans le salon de la maison familiale des Frankenstein, d’un film de monstres amateur, en 3D avec Sparky le chien héros qui boute Godzilla hors de la ville. A la fin du métrage, la bobine en argentique prend feu, mais l’incendie est vite stoppé. Victor et Sparky montent au grenier. C’est là qu’ils bricolent leur petit film amateur digne de Méliès. Ce grenier ressemble à s’y méprendre à celui de Sweeny Tood, le barbier boucher qui faisait les meilleurs pâtés à la viande humaine. Et pourtant, la maison n’a rien d’angoissante. Au contraire, on la croirait tout droit sortie du quartier résidentiel d’Edward Aux Mains d’Argent, à deux pas du cimetière des Noces Funèbres. Sauf que là, c’est un cimetière pour animaux domestiques. Même Hello Kitty a trouvé refuge ici. Notez que dans le court métrage de 1984, Hello Kitty était déjà présente dans le cimetière !

Ceci dit, ça et là, on débusque bien des références appartenant à d’autres films de Burton. Par contre, je n’ai pas souvenir d’avoir déjà vu dans un précédent métrage, un chien caquer des crottes en forme de lettres de l’Alphabet. Et le pire, c’est que lorsque le cleps pose une merde en forme de V, par exemple, cela sous-entend qu’un mauvais présage pourrait planer au-dessus de la tête de Victor. La propriétaire de l’animal et de ces déjections canines est formelle. Il y a des précédents très inquiétants. Et apparemment, elle dit vrai. Il va se passer quelque chose d’horrible pour Victor puisque son chien va mourir écrasé par une automobile. Victor va alors sombrer dans une profonde dépression jusqu’à ce que son professeur de science ne lui redonne de l’espoir, l’espoir de faire revivre son ami défunt.
Frankenweenie, une comédie dramatique rondement menée, où l’on passe des larmes aux rires, d’un genre à l’autre, de la comédie pipi caca pour enfant, au film d’amitié en passant par le drame et la science-fiction. Sur le fond, très clairement, Tim Burton met l’accent sur la difficulté à vivre dans un monde uniformisé quand on est différent de la masse, que l’on soit un petit gros ou un enfant solitaire avec un goût prononcé pour les monstres par exemple. Burton en profite aussi pour glisser à quel point le sens du compromis l’agace, le temps d’une conversation entre un père et son fils, très drôle. Il stigmatise la stupidité et l’ignorance qui ne peuvent qu’engendrer la peur, la peur, mauvaise conseillère de villageois qui vont condamner la science trop rapidement. Ceci dit, là encore, Burton n’est pas dupe et insiste sur le fait que la science peut servir le bien comme le mal. Il faut la manier avec prudence. Aussi intelligent que brillant, voilà un Frankenweenie de Tim Burton que je vous encourage à découvrir au cinéma.
J'Enrage de son Absence
Les premiers pas de Sandrine Bonnaire Réalisatrice
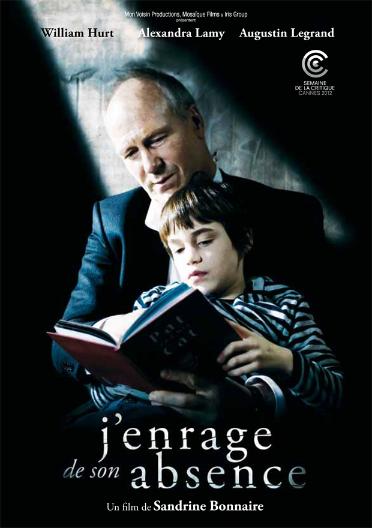
Que de chemin parcouru depuis Les Sous-Doués en Vacances. En 30 ans de carrière, la surdouée Sandrine Bonnaire a su mener sa barque, apparaissant dans des films qui resteront à jamais des pierres angulaires du 7ème art comme A Nos Amours de Pialat où elle incarnait une ado en quête de liberté. Elle avait envie de voir le loup… tout simplement. Saluée par un César du meilleur espoir en 84, elle apparaîtra encore chez Pialat dans Sous Le Soleil de Satan notamment, juste après avoir décroché un vrai César en 86 pour son rôle de clocharde dans Sans Toit Ni Loi de Agnès Varda. Bonnaire fera ensuite le bonheur des Rivette, Sautet, Chabrol, Leconte, pour ne citer que ceux-là. Autant dire que l’actrice a été à bonne école jusqu’en 2007, année où elle surprend son monde en passant de l’autre côté de la caméra. Elle réalise un documentaire sur sa sœur autiste intitulé Je m’appelle Sabine. Ce premier film n’avait alors rien d’un caprice. Sandrine Bonnaire en goûtant à la réalisation a découvert ce que signifiait la nécessité de raconter des histoires et de les réaliser. Elle a choppé le virus et s’est mise à l’écriture de sa première fiction : J’Enrage de son Absence, un premier film touchant et émouvant, appliqué sur la forme, mais un long métrage un peu court sur le fond. En effet, l’histoire démarre réellement à 20 minutes de la fin. Toute la longue exposition des personnages, de leurs failles prend beaucoup trop de temps.

Imaginez des retrouvailles entre un homme, Jacques, William Hurt, et une femme, Mado, Alexandra Lamy. Exilé aux Etats Unis, il est de retour en Europe pour régler une succession. Le notaire l’a convoqué pour signer quelques paperasses. C’est l’occasion de reprendre contact avec Mado. On apprend alors que ce qui unissait Mado et Jacques quelques années plus tôt n’était autre que la douleur, la souffrance. Ils ont eu un enfant qu’ils n’ont pas vu grandir. Le môme est décédé à 4 ans lors d’un accident de la route. Si Mado a tenté de tourner la page en refaisant sa vie avec un autre homme, Stéphane, Augustin Legrand, devenant de nouveau maman, Jacques lui, n’y est jamais parvenu. Mais ces retrouvailles auront bientôt un goût amer, alors que Jacques s’incruste de plus en plus dans la vie de Mado, et surtout, se rapproche de son fils, Paul. Il fait en quelque sorte un transfert sur cet enfant qui n’est pas le sien.

Inspiré d’une histoire personnelle, Sandrine Bonnaire avoue avoir repensé à un homme qui était lié à sa mère et a accompagné son enfance. Un jour, il a disparu. Elle a recroisé ce type lorsqu’elle avait 20 ans. Aujourd’hui, ce destin est devenu ce film, J’Enrage de Son Absence, pour lequel Sandrine Bonnaire a réservé le rôle du type torturé par le chagrin, anéanti par la tristesse liée à la perte d’un enfant, à son ex-époux dans la vie, William Hurt. Une demi bonne idée. S’il se révèle excellent dans ce rôle, on a de la peine à croire qu’il a été un jour le compagnon de Alexandra Lamy. Y a un truc qui ne colle pas trop dans le choix de ce couple pas bien assorti. Par contre, le grand Don Quichotte, Augustin est parfait pour jouer au papa et mari d’Alexandra Lamy, surtout quand il pique une colère dirigée contre son fils. A ce propos, la gamin, Jalil Meheni, bluffant, est sans doute le meilleur acteur de J’enrage de Son Absence. Quand Sandrine Bonnaire déclare qu’elle n’aurait jamais pu faire ce film sans lui, on peut la croire sur parole. Cet enfant est très doué. Touchant, émouvant, sincère, ce premier long métrage repose sur une excellente direction d’acteurs, normal de la part d’une actrice aussi chevronnée, mais aussi sur une mise en scène très scolaire, au service de la narration. Sandrine Bonnaire prend le parti de filmer systématiquement en plan fixe le personnage qui fait du sur place dans sa vie alors qu’elle opte pour une caméra plus légère, plus libre pour l’autre qui a tourné la page. C’est ce qu’on apprend dans les écoles de cinéma. Nul doute qu’elle va s’affranchir de ce genre de conventions pour son prochain long métrage. J’espère qu’elle en fera un, car celui-ci, malgré ses défauts, est très prometteur.
UN PLAN PARFAIT

UN PLAN PARFAIT, que dis-je, un plan imparfait est le deuxième long métrage de Pascal Chaumeil après l’Arnacoeur. Celui qui a assisté Luc Besson sur Jeanne d’Arc et Léon avant de réaliser l’Arnacoeur, s’est offert des vacances au Kenya, en Russie et en Belgique. En effet, exit le rocher de Monaco et vive un tour du monde sympa pour raconter une nouvelle comédie romantique d’une inoriginalité crasse. Certes, il faut tout de même saluer le soin apporté aux dialogues. Certains font mouches. A tel point qu’on en viendrait presque à avouer que le terme comédie n’est pas complètement galvaudé. Pour la romance, par contre, elle suit le chemin ultra balisé du genre. On connaît la formule, depuis le temps. Deux êtres pas du tout fait pour vivre une love story se rencontrent par hasard, se reniflent le cul, se roulent des pelles, s’apprécient, s’embrouillent, se séparent, avant de se rendre compte qu’ils sont fait pour vivre heureux ensemble.
Pour tout dire, tout commence un soir de Noël. A la table familiale, une invitée de passage, genre grosse chieuse, a été invitée pour ce réveillon. Pas grand monde ne peut la supporter, à tel point que lorsqu’elle évoque sa nouvelle coupe de cheveux qui lui ouvre le visage, le père de famille balance discrètement cette vanne : « J'aurais préfère qu'elle ferme sa bouche ». Mais la jeune femme ne relève pas. La pipelette parle, parle. Elle s’épanche tellement qu’elle finit par s’écrouler et chialer.
Autour de la table, les aïeuls sont cashs, avec cette femme dont on apprend qu’elle a été larguée comme une merde par son mec. « Je suis juste bonne à me faire sauter et me faire jeter », dit-elle.
« Papa c'est quoi sauter ? », demande l’unique petite fille de la tablée. Pas gêné pour si peu, le papa répond : « c’est quand on se fait des câlins mais en plus hard ! » C’est alors que pour lui remonter le moral, les convives s’y mettent tous pour lui raconter une histoire. Dans cette famille, il existe une malédiction, celle du premier mariage. C’est comme ça depuis plusieurs générations. Toutes les femmes de la famille n’ont jamais vécu heureuses lors de leur premier mariage. C’est comme ça. Elles ont toutes divorcées, à l’exception d’Isabelle, l’absente de la soirée. Elle a essayé de conjurer le sort.
UN PLAN PARFAIT, un film où l’on rit beaucoup sur la première demi-heure. Passé ce cap, ça patine et on anticipe les différentes étapes du scénario. Dommage. Ceci dit, on pourra toujours se rabattre sur les images dépaysantes du Kenya et des rituels de mariage ancestraux pour ne pas trop s’ennuyer. C’est maigre. Ceci dit un film avec du AC DC dans la bande son ne peut pas être foncièrement mauvais.
SKYFALL

Cette semaine, la planète cinéma fête un anniversaire… Et pas n’importe lequel, celui de James Bond. Cinquante ans qu’il traque les méchants sur grand écran. Sur Terre, sous mer ou dans les étoiles, James Bond a tout connu et n’est visiblement pas prêt de prendre sa retraite. Au contraire, 50 ans ça valait bien un 23ème épisode au cours duquel Bond se refait une nouvelle jeunesse. Intitulé Skyfall.

Dans Skyfall, Daniel Craig est toujours 007. Mais Daniel Craig n’est plus exactement le même Bond que celui de Quantum of Solace ou de Casino Royal. C’est un peu comme si les ayants droits de la saga la plus lucrative du cinéma avaient un message à faire passer. Oui Bond s’éclate aux 4 coins du globe depuis les années 60. Oui, il est temps de tourner la page et de tuer un héritage devenu trop lourd. Tout ce qui appartient au passé doit être effacé, détruit, ruiné, jeté aux oubliettes, de l’Aston Martin avec ces gadgets vintages genre mitraillettes dans les phares ou siège éjectable de série commandé au levier de vitesse, au manoir familial de Bond en Ecosse, en passant par… par… par un monument de la série, qu’on n’aurait jamais cru qu’il disparaisse un jour. Pour assurer sa pérennité et de juteux dividendes aux investisseurs pour les 50 prochaines années, James doit impérativement entrer dans le 3ème millénaire. C’est chose faite via Skyfall, l’épisode le plus freudien qu’ait jamais connu la franchise, celui où Bond va enfin couper un cordon ombilical devenu gênant.
A la barre de ce Skyfall, Sam Mendès. Le réalisateur de American Beauty et autre Jarhead, revient aux fondamentaux et propose un épisode qui ravira les fans et enchantera les néophytes. Son plan d’attaque est simple, renouer avec un cocktail gagnant à base d’action, d’humour, et un peu d’amour mais pas trop. Bien sûr, comme le veut la bible Bondesque, le film s’ouvre sur une scène de pré-générique musclée. Fidel à la tradition, c’est un modèle du genre avec un agent 007 sous adrénaline qui cavale derrière un vilain. On est à Istanbul. Même si cette entame rappelle vaguement celle de Taken2, Bond va beaucoup plus loin. Il faut dire que désormais, dès qu’on se rend à Istanbul pour une course poursuite infernale, il faut détaler sur les toits des maisons au-dessus du grand bazar. C’est devenu un incontournable, un must. Mais tandis qu’on se course à pied dans Taken2, dans James Bond, les moteurs des motocyclettes vrombissent. C’est tellement plus fun. Et la scène se prolonge même de manière insensée jusque sur le toit d’un train de marchandises pour un corps à corps interminable dont l’issue sera fatale à l’un des deux protagonistes. Un corps tombe à l’eau, s’enfonce dans les profondeurs, annonçant un générique en animation un peu léger, porté par la chanson titre de Adèle qui commence par ces mots : This is the End.

Le ton est donné d’emblée. C’est la fin. La fin d’une époque. Bond doit se moderniser, en finir avec son passé. Le MI6 doit tirer les conclusions qui s’imposent. Le service est vieillot. Les méthodes de M ancestrales. Ce dinosaure de l’espionnage qui n’a pas su s’adapter au monde moderne, doit prendre sa retraite et vite. En effet, la couronne britannique risque de payer très cher ses erreurs. C’est qu’un disc-dur avec le nom de tous les agents de sa Majesté travaillant sous couvertures et infiltrés au sein de groupes terroristes, se balade dans la nature. Mais qui, bon sang, qui possède cette bombe à retardement? Qui aurait intérêt à publier sur le Web la liste de M? Qui? Javier Bardem pardi, alias Raoul … Mais Bond connaît pas Raoul… aux 4 coins de la ville qu’on va le retrouver… Eparpiller façon puzzle… euh.. .non pardon… ce n’est pas exactement le même genre de Raoul. Ce Raoul là, Raoul Sylva est sans aucun doute l’un des méchants les plus charismatiques qu’ait jamais connu la saga Bond. Derrière un côté pince sans rire, se dissimule une âme froide, un type cynique, joueur, qui soigne ses entrées et qui se montrera prêt à tout pour atteindre son but.

Skyfall, l’épisode du cinquantenaire, un brin nostalgique, celui que l’on espérait plus. Sam Mendès et ses scénaristes ont ré-introduit ce qui faisait sévèrement défaut aux deux précédents épisodes mettant en scène Daniel Craig, l’humour. Enfin, la noirceur du héros s’estompe et l’on se surprend même à se marrer à moult reprises. Le retour de l’humour dans Bond, voilà une très bonne nouvelle. Si Daniel Craig n’est pas Roger Moore, n’empêche qu’il prend une autre dimension. Il n’est plus cet être torturé, trop sombre. Bond est désormais un homme qui sait rire, un homme qui pourrait, à l’instar d’Astérix, en aimer d’autres! Damned, rompre avec le passé, d’accord, mais de là à imaginer le symbole de virilité par excellence depuis 50 ans se roulant dans les bras d’un costaud gaillard, c’est osé! Un 007 homo, c’est certes moderne, mais c’en serait terminé avec les james Bond Girl … A ce propos, celles de cet épisode, Naomie Harris et Bérénice Marlhoe, sont reléguées non pas au deuxième ou troisième plan, mais encore plus loin, derrière les décors. La présence de ses belles plantes devient anecdotique, comme pour enfoncer le clou : l’espion moderne ne doit plus se laisser détourner aussi facilement de sa mission par la femme, aussi aguicheuse et mystérieuse soit-elle. Plus de Q dans Bond, c’est la nouvelle règle! Quoique … . Il y a du Q, en réalité un jeune Geek qui fait office de Q. Exit le vieux monsieur en blouse d’antan. Là encore, le MI6 doit se tourner vers l’avenir, faire confiance à la jeunesse, celle qui accompagnera encore très longtemps l’agent secret. Et oui, pas d’erreur, avec ce Skyfall, Bond revient en très grande forme au cinéma, pour le plus grand bonheur des spectateurs, et m’est avis qu’il a encore de très beaux jours devant lui.
ASTERIX 4
Au Service de Sa Majesté

On a échappé au pire, par Toutatis! Malgré le succès incompréhensible du 3ème épisode de la franchise, avec près de 7 millions d’entrées en Gaule (pas suffisant pour éviter le naufrage financier), Anne Goscinny , l’héritière de René n’a pas refilé cette nouvelle adaptation à Thomas Langmann. Comme elle a bossé sur le scénario Du Petit Nicolas, autre création de Goscinny père, elle a pu évaluer le travail de Laurent Tirard. C’est donc lui qui a remporté le morceau haut la main avec la société Fidélité Film, éjectant du même coup le Minimoy Luc Besson, entré dans la danse tardivement. Il faut dire qu’une adaptation réussie d’Astérix au cinéma, malgré un budget démesuré, peut vous permettre d’atteindre directement la case retraite dorée sans passer une vie entière à trimer. Claude Berri en 99 ne s’était pas contenté d’amortir le budget le plus gigantesque du cinéma français à l’époque. Les 42 millions d’investissements avaient été remboursé largement. Mission accomplie aussi pour Cléopâtre et les 50 millions d’Euros de la bande à Chabat. Seul, le fils Berri, Thomas Langmann a bu la tasse, et pas une tasse de thé chère aux bretons. 78 millions dépensés et un gadin au box office plus tard, Langmann n’a ressorti la tête de l’eau que récemment, grâce à la divine intervention des Weinstein qui ont fait la fortune de cet Artist. Mais si le tocard aux Jeux Olympix s’est vautré, c’est bien la faute à un scénario fainéant, voire inexistant. Tout le pognon est passé dans le casting, les décors et la logistique, des erreurs que Laurent Tirard n’allait pas commettre avec ce 4ème opus, ASTERIX, Au Service de Sa Majesté.

Ce n’est un secret pour personne, Laurent Tirard est un cinéaste qui a la tête sur les épaules. Habitué aux monuments de la culture française, (Molière au cinéma, c’était lui), il a pensé efficacité et s’est logiquement focalisé sur deux albums : Astérix Chez Les Bretons et Astérix Et Les Normands, deux BD qui ont déjà connu une adaptation, mais en dessin animé, sous le titre, Astérix et les Vikings pour l’épisode normand. Tirard a-t-il joué la facilité? Oui, un peu. On dira plutôt: la sécurité. Avec les dessins animés, sorte de story-board de luxe, on voit directement ce qui risque de ne pas marcher à l’écran! Avec cette matière et celle des BD encore inexploitée, plus une volonté farouche pour le réalisateur et ses producteurs de ne pas se contenter de reprendre la franchise et de s’inscrire dans la lignée des 3 précédentes réalisations, il y avait de grandes chances qu’il mène à bien son entreprise. Noter que sur la volonté de ne pas se contenter de reprendre la franchise et de s’inscrire dans la lignée des 3 précédentes réalisations, on peut émettre un doute. Voilà le genre de déclaration juste bonne à trôner dans un dossier de presse, pour faire joli. Car, à y regarder de plus près, ce 4 est un méli-mélo, sorte de mélange savamment dosé de ce que l’on a déjà vu dans les précédentes adaptations. La potion n’a plus rien de magique. Elle est mathématique. Avec des dialogues parfois inspirées de chansons de variété française comme dans le 3, un peu de l’humour Canal avec les anachronismes du 2, et les effets spéciaux hyper légers du 1 lorsque l’on ingère de la potion, ce 4 est donc bel et bien une adaptation qui s’inscrit dans la parfaite lignée des précédentes avec ceci dit, la Tirard Touch en plus! Et ce n’est pas rien. C’est là en effet que se joue la différence.

Dès le générique, on sent qu’on va passer un chouette moment. Au court d’une animation clin d’œil évident à James Bond, on découvre l’Union Jack en 3D et la couronne de la reine où des diamants pas éternels, s’envolent. Le tout est porté par une musique qui rappelle celle du célèbre agent secret. Ceci dit, Obélix n’est pas 00 sexe! Même si son charisme ne laissera pas insensible la jolie bretonne Miss Macintosh (parfaite Valérie Lermercier en reine de la bonne tenue et du bon goût), les seuls gadgets de l’obèse gaulois sont sa boîte à claques et son menhir à nœud fuchsia! Immédiatement après cette entame, la magie de la 3D s’estompe. Gérard Barbe Rouge Jugnot et ses pirates se font exploser au milieu de la mer du nord par la flotte romaine emmenée par César. Fabrice Luchini et son armée foncent sur la Bretagne et comptent bien profiter de ce moment où les bretons s’arrêtent de vivre pour boire de l’eau chaude, pour conquérir ce lopin de terre. Les Romains de Tirard sont un peu les Américains d’aujourd’hui, des envahisseurs qui n’hésitent pas à partir en guerre et occuper des territoires pour le soit-disant bien des populations. Typiquement, ce serait rendre service à l'humanité toute entière que d’obliger les anglais à parler normalement. Le plus hilarant, c’est que ce César là possède du Sarkozy et du Berlusconi en lui. Adepte des orgies, il doit faire profil bas lorsque le sénat vient lui quémander quelques explications quant aux dépenses superflues de l’Etat. Que signifient ces 20 000 sesterces pour un déplacement personnel en galère privée alors qu’une galère publique aurait été moins chère? La référence aux dépenses en avions sous l’ère Sarkozy saute aux yeux et l’on ne peut s’empêcher aussi de songer au yacht de Bolloré ou aux déboires de Michèle Alliot Marie partie en vacances en Tunisie au frais du clan Ben Ali. Il est également question dans cette nouvelle aventure, du contrôle des flux migratoires. Il faut faire attention aux sans papyrus et renvoyer d’où ils viennent celles et ceux qui ne sont pas en règle. Cette modernité dans le scénario d’Astérix est payante. Le rire est garanti.

Il en va de même avec Goudurix qui a subi un petit lifting depuis 1966, année où les lecteurs de Pilote le découvraient en fâcheuse posture avec des Normands. Dans la BD, Goudurix est le type même du jeune parisien issu des yéyés. 40 ans après, les Yéyés ne disent plus rien au grand public. Il faut parler en 2012 de beau gosse. En ce domaine, Vincent Lacoste en connaît un rayon. Il est sublime en ado qui se rêve barde. Le jeune garçon dans le vent, stupéfait en découvrant les Beatles jouant dans les rues de Londinium, ne veut pas devenir un homme au sens où Astérix et Obélix, ces parrains gaulois, l’entendent. Il ne distribuera pas des baffes en rafale et ne matera pas du romain. Goudurix n’a pas la même conception de la masculinité que ces chaperons. Son dada, c’est la hallebarde saturée, un bon truc pour conter fleurette aux donzelles. Mais ce Hendrix de pacotille, peureux de nature, irrévérencieux, mal élevé ne sera pas au bout de ses surprises dans ce royaume de Bretagne ou les filles ne sont pas si faciles que cela. Il ne vivra pas non plus avec un autre homme, sous la même hutte, qui plus est avec un chien! C’est trop bizarre. Astérix et Obélix seraient-ils des homos qui s’ignorent ? La question est en tout cas posée dans ce 4ème opus par le breton Jolithorax. A la simple idée qu’on le prenne pour ce qu’il n’est pas, Astérix va donc partir en chasse, tenter de couper le cordon qui le lie à son boulet d’ami depuis toujours. Pour le coup, les deux héros fonctionnent véritablement comme un vieux couple de pacsés qui auraient eu le droit d’adopter un ado, une têteàclax qui devra échapper aux terribles normands. C’est que les hommes de Olad Grossebaffe, prodigieux Bouli Lanners, ont débarqué eux aussi en Grande Bretagne pour aider César à accomplir son œuvre, la conquête totale de cette île. Ils ont accepté à condition que César les aide à percer le mystère de la peur. Ces cons de Normands s’imaginent que s’ils parviennent à dompter la peur, ils arriveront à voler! Et voilà pourquoi ils se retrouvent au pied des falaises bretonnes, non loin de ce village qui résiste à l’envahisseur. Ici s’est réfugiée la Reine Mère, Catherine Deneuve. Elle a intimé l’ordre à Jolithorax, Guillaume Galliene, d’aller demander de l’aide aux cousins gaulois, et de ramener un peu de cette potion magique dont on dit le plus grand bien et qui permet de contenir les romains. Jolithorax a mené cette mission et le voici enfin de retour dans son pays natal, accompagné d’Astérix, Obélix, Goudurix mais pas Idefix resté en Gaule. Les embûches seront nombreuses pour nos amis avant de rallier le village encerclé.

Asterix, Au Service de Sa Majesté, une délicieuse comédie Rock N Roll, et je ne dis pas ça uniquement à cause de la présence sur la bande son des Beatles, Ramones et autre BB Brunes. Le film est rondement mené. Et pour ceux qui douteraient encore de la distribution avec Edouard Baer dans la défroque d’Astérix, qu’ils se rassurent, le choix est judicieux. Il permet au petit gaulois de non seulement gagner quelques centimètres, mais surtout d’apparaître pour le coup sophistiqué, limite intello, terriblement moderne pour l’époque, un brin arrogant ce qui coïncide parfaitement avec l’image que se trimballent les gaulois à l’étranger. Edouard Baer est donc monté en grade, passant du statut de scribe dans la Mission Cléopâtre à celui d’Astérix au Service de Sa Majesté! Laurent Tirard n’oublie pas de rendre hommage le temps d’un clin d’œil à son glorieux passé de scribe lors d’une scène oì Astérix converse avec un bourreau et lui demande si c’est une bonne situation, bourreau ! Voilà qui rappelle un dialogue de l’épisode égyptien. Le seul bémol que l’on pourra émettre, le seul reproche, c’est que cette nouvelle aventure manque sérieusement de calva. Tirard n’a pas repris cette idée pourtant sublime de Goscinny, de mélanger les références entre normands scandinaves et normands de la province française. Ici, ils n’utilisent jamais de crème pour leur bouffe et ne font jamais des réponses de normands. Ils ne chantent pas non plus « je veux revoir ma Normandie » de Frédéric Berat. Mais là, c’est vraiment pour chipoter !
LE MAGASIN DES SUICIDES
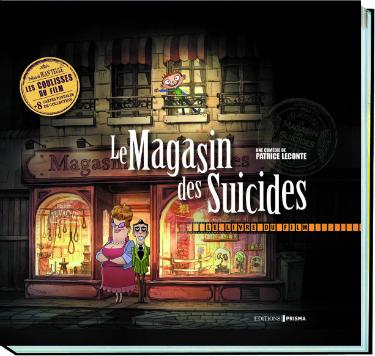
Imaginez une ville triste et affreusement grise où tous les habitants tirent la tronche et n’ont qu’une idée fixe en tête: en finir avec la vie. Ici, tous les moyens sont bons pour se suicider. Mais attention à ne pas se rater, et encore moins à commettre son geste irréparable en pleine rue, sous peine de chopper une grosse amende! Vous me direz qu’une fois mort, qui se souciera de cette prune à payer? Les descendants du macchabée, pardi! Alors plutôt que de finir sous un autobus ou de se jeter du haut d’un pont, autant allez faire ses commissions au magasin des suicides du coin, et opter pour une solution finale à la maison.

Dans cette boutique aux couleurs éclatantes, sorte d’échoppe de farces et attrapes, le seul endroit de la ville à briller autant, les affaires vont bon train. Ici, on vient chercher son sabre, sa fiole de poison ou son petit morceau de corde. Ici, on est accueilli à bras ouverts et en chanson par les tenanciers Mishima et Lucrèce. Seulement, le couple attend un heureux évènement qui va se révéler être un calvaire. Madame Lucrèce accouche du petit Alan, un bébé qui sourit et qui ne cesse de rire! Enfer et damnation!!! Qu’est-ce que c’est que cet intrus, que cet enfant heureux de vivre! Alan est la honte de la famille. A lui seul, il risque de ruiner un commerce juteux. Et les affaires ne vont pas aller en s’arrangeant au fur et à mesure qu’Alan va grandir.

Pour l’anecdote, et selon une source sure, Jean Teulé, auteur du roman original paru en 2007 et qui a servi de base au dessin animé, les personnages tirent tous leur prénoms de célébrités: celui de Mishima, le père est inspiré de l’écrivain japonais Yukio Mishima qui s’est fait Hara-Kiri. Celui de sa femme Lucrèce fait référence à la célèbre empoisonneuse Lucrèce Borgia. Quant aux enfants, Marilyn et Alan, leur prénoms viennent de Marilyn Monroe et Alan Turing, Alan Turing l’inventeur de l’ordinateur qui s’est tué en mangeant une pomme, une Apple trempée dans du cyanure. Le Magasin des Suicides, un film Microsoft? Peut-être, peut-être pas. Ce qui est certain c’est que c’est un film numérique! Réalisé pour être exploité en 3D, cet animé est aussi visible en 2D! Pour sûr que si Tim Burton avait eu connaissance de ce projet, il l’aurait fait en prises de vue réelles. C’est évident, ce Magasin des Suicides aurait pu, aurait dû être un film de Tim Burton, tant l’univers noir, morbide et le cynisme de l’humour sont omniprésents et auraient particulièrement sieds à l’auteur des Noces Funèbres et autre Etrange Noël de Monsieur Jack.

C'est justement pour amoindrir cette noirceur, cette mélancolie à la limite du supportable que Le Bronzé Patrice Leconte a apporté quelques modifications au texte de Jean Teulé, notamment sur la fin. Si le roman, ne se terminait pas vraiment sur une happy end, la fin du fil elle, est kitch et résolument optimiste, un manque de radicalité coupable! Patrice Leconte s'est donc fait plaisir mais risque de se heurter aux critiques des nombreux amoureux du texte de Jean Teulé. Mais Patrice Leconte s'en fou. Arrivé en fin de carrière, se soucie-t-il encore des critiques ? Pas sur, sinon il aurait changé de métier après Les Bronés 3
!

Par contre, il confesse volontiers qu’à son âge, réaliser un animé est parfait. On évite les caprices de stars. Les acteurs savent leur texte. On ne s’enquiquine pas avec la météo. Lui qui a commencé comme dessinateur chez Pilote, qui a bricolé des courts métrages en papier découpé lorsqu’il était ado, entre donc à 64 ans dans le monde merveilleux de l’animation par la grande porte, en signant une œuvre visuellement sublime.

Il a également tenu à concrétiser un vieux rêve de cinéaste: réaliser son film musical. En tout, 9 chansons ponctuent cet animé. Mais 9 chansons, c’est beaucoup trop. Bien sûr, on comprend l’envie de mettre de la gaieté et de la légèreté dans ce monde oppressant, mais le rythme du film est du coup ralenti. Pire, il y a des redites et ça tourne parfois à la répétition. Quand Mishima nous offre un tour du propriétaire en chanson, qu’il fait l’apologie des articles phares de sa boutique, c’est drôle. Mais lorsque quelques minutes à peine après, un client en fait de même, c’est redondant! Ça masque une intrigue trop légère pour tenir sur 1h20, un scénario un peu fainéant. C’est dommage car sans cela, Le Magasin des Suicides aurait été une remarquable radiographie du mal être ambiant. Vous me direz qu’on ne va pas se mettre la tête dans le four pour si peu! Le Magasin des suicides reste en effet un film d’animation recommandable, mais attention, pour adulte uniquement.
HOPE SPRINGS

On vous l’a dit et répéter des comptes de fois, NE REGARDEZ JAMAIS UNE BANDE ANNONCE pour vous aider à choisir un film. Entre celles qui déballent absolument toutes les surprises et autres meilleurs moments en 2 minutes, et celles qui vous induisent en erreur tellement elles sont mal fichues, il faut effectivement éviter de voir ces objets promotionnels. C’est d’autant plus vrai cette semaine avec celle de Hope Springs! C’est évident, la production a dû confier ce job à un stagiaire sous payé, voir pas payé du tout, peut-être même mal traité, snobé, et qui a du coup trouvé un bon moyen d’assouvir une vengeance personnelle! Il n’y a pas d’autres explications. Quand on regarde cette bande de lancement, un sentiment étrange s’empare de vous : « C’est quoi ce film à chier que l’on nous vend ici ? », voilà ce qu’on se dit. Et pourtant, après vision du film, on ne peut que réviser ce jugement un peu trop hâtif.

En effet, Hope Springs est moins pire que prévu. Certes, cette comédie dramatique manque encore un peu de folie et d’extravagance, mais sur l’ensemble le sujet, à savoir comment raviver le désir sexuel quand on a passé 31 ans de mariage, est sacrément bien traité. Enfin, je n’en sais rien, mais j’imagine que ce que l’on voit sur l’écran doit se passer à peu près de la même manière dans la vraie vie. Je me dis aussi que quand Judd Apatow, le livreur de mode d’emploi « quand on est en cloque », accessoirement le quarantenaire toujours puceau, en arrivera aux séniors et à leur libido, ça donnera une comédie lourdingue genre 90 ans et toujours la trique, un film avec des gags dopés au Viagra ou des plaisanteries de carabin à la gomme. Ici, dans Hope Springs, on opte pour un traitement radicalement opposé, avec un certain réalisme et une réelle subtilité. C’est un peu la griffe de Damien Frankel, le réalisateur du Diable s’Habille en Prada. David Frankel a cartonné avec ce film mettant en scène Meryl Streep dans la peau de l’ignoble rédactrice en chef de Vogue, où d’un magazine de mode jamais cité mais qui rappelait franchement celui-ci. Avec Hope Springs, il renoue avec Meryl Streep et débute son film avec cette scène drôle, mais pas seulement, scène qui donne le ton d’une comédie douce amer.

Meryl Streep en peignoir de soie, dissimulant un déshabillé un peu sexy pénètre dans la chambre de Tommy Lee Jones, son mari dans le film. Elle reste dans l’encablure de la porte d’entrée. Cette femme est en manque de câlin. Maladroite comme une jeune adolescente encore vierge, elle vient quémander à son mari un peu de chaleur. Mais le vieux bougon, rustre personnage, allongé sur son plumard, plongé dans ses lectures nocturnes, refuse catégoriquement de répondre aux avances de madame sa femme. C’est qu’il est un peu ballonné. Il digère mal le porc qu’il a mangé à midi. Sous ce sinistre prétexte débile, il évite de justesse la corvée que sa femme cherche à lui imposer. Alors, elle s’en retourne dans ses pénates, triste, déçue, obligée de se contenter en solitaire. Pathétique ! La situation est pathétique, mais tellement emprunte de vérité. A passé 60 ans, le sexe devient problématique. Certes, l’amour est bien présent sinon, ces deux-là n’auraient pas passés 31 ans à se supporter. Et le film de montrer la dangerosité de la routine, lorsque le désir n’est plus, que ce mari est devenu un ami ou un frère, plus qu'un amant. Alors que faire en pareil cas? Divorcer, ou bien se payer une chance de rallumer la flamme? Plutôt la seconde option. Et pour cela, rien de mieux que de suivre une thérapie de couple express dans le Maine, avec pour conseiller Steve Carrel, un psy qui vous écoute et vous donne des exercices pratiques censées réveiller une libido en berne. Encore faut-il mettre de la bonne volonté pour arriver au terme de cette semaine de cure avec la sensation que tout n’est pas encore perdu.

Hope Springs, un film drôle et intelligent, qui repose sur un duo d’acteurs excellents. Tommy Lee Jones en handicapé du sexe et des sentiments est plutôt pas mal. Ce vieux bougon trouve à redire sur tout et sur tout le monde. Il se plaint du prix du psy, plus cher qu’un avocat, gueule sur le prix du petit déjeuner au troquet du coin, et sur le service, aussi! Quand il doit juste se glisser sous la couette, pour serrer sa tendre et douce entre ses bras, il tire la tronche plutôt que sa femme. A croire qu’on l’envoie à l’abattoir! Ce type est invivable, infernal et tranche avec Meryl Streep, patiente, pleine d’espoir, une femme nostalgique et rêveuse qui n’imagine pas une seconde la fin de son couple. Alors elle met de la bonne volonté. Elle va même jusqu’à tenter une fellation dans un cinéma, alors qu’elle déteste ça… Enfin, elle ne déteste pas le film projeté, entre parenthèse, le dîner de con, mais elle a en horreur l’idée de gâter son mari en public, comme en privé. La pipe à moustache, c’est pas son truc ! Vous me direz, à chacun le sien. Celui de Damien Frankler est donc de décrire la dure réalité d’un couple vieillissant sans sexe, celui du public sera peut-être de savourer cette comédie subtile Hope Springs, traduit en français par Tous Les Espoirs Sont Permis avec Meryl Streep, Tommy Lee Jones et Steve Carrel.
DO NOT DISTURB
Mon pote est un acteur !!!

On va s’encanailler cette semaine grâce à Yvan Attal, François Cluzet et Laetitia Casta. Le film nouveau de Attal s’intitule DO NOT DISTURB et m’est avis qu’il va disturber plus d’un esprit chaste…Si vous avez aimé Miri et Zack font un Porno, m’est avis que vous allez adorer ce Do Not Disturb. Dire en pré ambule qu’il s’agit d’un remake, Humpday de Lynne Shelton, en fait un film de commande de la part de UGC. Un film qui s’inscrit très bien dans la continuité du travail de Attal réalisateur. Après Ma Femme est une actrice, Ils se marièrent… il continue dans le registre de la comédie, à étudier la femme, l’homme, le couple. Sauf que ici, il est contraint de se pencher plus précisément sur la sexualité et ses ambiguïtés. Do Not Disturb débute toute fois sans aucune ambiguïté, directement sur une levrette à 2 du matin. Le couple est interrompu par l’ami de toujours, un pote qui débarque à l’improviste en criant… ouvrez, ouvrez… vous êtes pris en flagrant délit de sodomie… Voilà un film couillu me dis-je…. Un gars qui s’incruste au plus mauvais moment.

En fait, ce vieil ami, François Cluzet, va venir perturber le quotidien pépère du couple tranquille Attal Casta. Assez rapidement, tu sens les embrouilles arriver. Dès le lendemain, Attal plante sa femme pour aller faire la fête avec Cluzet. La maison s'appelle sodome et gomore. Attal téléphone à sa tendre et douce et lui dit : T'es invitée à gomorer, tu sais. Elle refuse et reste seul avec son plat de nouille qu’elle avait préparé avec amours. Pendant qu’elle picole en solitaire, son mari picole aussi mais à Sodom et Gomore. La fête bat son plein. il fume des joints, bref, il s’amuse et en fin de soirée. Il en vient à discuter d'art et notamment, d’un Festival de porno gay amateur, HUMPDAY, qui se déroule à Seattle. C’est le festival du cul qui cherche ses limites, ou tout le monde baise dans la salle et à la fin on brûle les films pour ne pas que ça ne te poursuive toute ta vie. Il y a eu paraît-il l’année précédente un porno avec ET qui revenait voir Eliott. Il avait toujours une petite lumière rouge mais plus au bout de son doigt. Bref, l’alcool aidant, les idées fusent et voilà comment Cluzet et Attal en viennent à se lancer un défi complètement fou : réaliser leur porno gay, un film avec deux hétérosexuel qui s'enculent.

Et voilà donc un prétexte tout trouver pour, derrière la comédie pure, aller gratter d’autres sujets. Bien sur que le film point surtout du doigt le sujet de l’homosexualité. On a tous une part d’homosexualité en nous, plus ou moins refoulé. Et si finalement, derrière une relation d’amitié forte entre deux hommes, il y avait une relation amoureuse cachée…. L’amitié est-ce de l’amour, et si oui, est-ce que ça ne pourrait pas devenir amour physique ? Le film parle encore du désir animal de faire l’amour avec un inconnu sans pouvoir jamais refreiner ce désir… Peut-on lutter contre ses désirs ? Le choix de vie est aussi un des thèmes majeurs du film: est-ce que l’on s’épanoui quand on est engoncé dans un modèle bien établi, bien étroit, avec pour seul projet de vie, fonder une famille, d’avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme et de beaux enfants? Est-ce que c’est ça, la vie ? Do Not Disturb est aussi un film sur le couple. On croit connaître la personne avec qui on partage sa vie, mais connaît-on cette personne réellement ? pas forcément. Enfin, dans Do Not Disturb, il est question de l’art et de la posture de l’artiste. C’est quoi un artiste ? Un être humain qui doit aller là ou il a peur d'aller. En l’occurrence, les deux apprentis cinéastes ont peur de faire l’amour, ils sont deux artistes qui vont repousser leur limites, outre-passer leur peur...

D’un mot encore sur la forme. Il y a des scènes géniales ou la voix est décalée par rapport aux images. En gros, Attal et Casta sont filmés en étant chacun de leur côté, pensif, silencieux, dans leur coin, enfermés dans leur propre réflexion et sur la bande son, on suit la conversation qu’ils ont eu quelques minutes avant ce silence, sur leur couple, leur vie, leur désir…etc… C’est vachement bien, parce tu ne sais pas si c’est une conversation réelle ou si on est dans le registre du non-dit. Pour rire et réfléchir aussi, Do Not Disturb, de et avec Yvan Attal, avec François Cluzet et Laeticia Casta, plus des apparitions de Joey Starr ou charlotte Gainsbourg ou encore Asia Argento… ça sort aujourd’hui en salle. En plus, il y a une bande son géniale, à base de Pharell Williams, d’acid jazz, de punk…éclectique.
SAVAGES
Pas très sauvage
le nouveau Stone!

Savages, le nouveau Oliver Stone, une histoire d’O… pas le film de Just Jaekin qui réalisa aussi Emmanuelle, mais une d’histoire d’Ophélia. C’est le prénom de cette héroïne libérée qui vit une histoire d’amour intense à trois. Cette femme aime deux hommes, deux amis qui se connaissent très bien. Elle a donc deux mecs, l’un pour la baiser sauvagement parce qu’elle aime ça de temps en temps, et l’autre pour lui faire l’amour tendrement parce qu’elle aime ça aussi. Ce trio vit à Laguna Beach, dans le luxe et pour cause, puisque les deux amis sont à la tête d’un trafic de weed particulièrement lucratif. Disons qu’à son retour d’Afghanistan, Chon a ramené dans son baluchon de Marin’s des graines formidables. Ben le botaniste a été chargé d’exploiter et de tirer le maximum de ces graines. Résultat, ils se font un max de pognon, à tel point que leur empire commence à susciter bien des convoitises du côté des narco trafiquants mexicains. D’ailleurs le film commence par la, par une scène de décapitation à la tronçonneuse. Savages ne s’appelle pas Savages pour rien. Je rassure les âmes sensibles, on entend plus qu’on ne voit réellement la décapitation. Mais enfin, cette vidéo est postée dans la boite mail de Chon avec un message lui indiquant un rdv à ne pas rater. On est au début de ce long flash-back. En effet, pendant qu’elle se balade sur une plage, une blondasse, en fait, la gonzesse de Ben et Nuts… ben et Chon raconte en voix off comment tout a dérapé. Ça a débuté par ce mail, puis très vite, les deux gars ont voulu joué au plus malin avec Salma Hayek, la cheffe de cette mafia mexicaine, alors que John Travolta, le flic corrompu a cherché lui-aussi de son coté à entourlouper son monde. Bref dans cette histoire, tout est allé de travers..

Savages, c’est un peu, Le bon la pute et le truand. Oui, il y a un côté western dans ce film, notamment sur le final. Oliver Stone se fait plaisir avec la bande son qui lorgne sur ce genre et la mise en scène d’un duel final. Les chevaux mécaniques ont remplacés les animaux. Les cowboys sont des trafiquants de drogues qui ont recours à des armes automatiques plutôt qu’à des colts. Et y a même les tireurs embusqués en hauteur, façon sniper de l’ouest. Comme d’hab, Oliver Stone se fait plaisir en utilisant toute sorte d’images, d’ordinateurs, de téléphone portable, de webcam. Il y a même un petit passage en animation plutôt rigolo avec une blonde qui se fait couper la tête sur fond de musique de videogame à deux balles. Le reste du temps, la bande son lorgne sur le rap mexicain plutôt bien fichu. Une chance, ça contrebalance avec le film qui s’appuie sur une intrigue déjà vue, des acteurs parfois très mauvais comme Benicio Del Toro en multi traitre sadique jamais convainquant. Quant à Salma Hayek, elle ne s’en tire pas trop mal en cheffe mafieuse. A la limite, la meilleure reste sans contestation Umma Thurma, coupée au montage!!!! Gageons que tout ça ne sera pas suffisant à Oliver Stone pour éviter un nouveau gadin au box-office après les deux gamelles successives Alexandre le Grand et Wall Street2. Même le coup de la fausse fin ne convaincra personne !
TAKEN 2
Aucun intérêt!

Taken2 un film de Olivier Mégaton, méga étron plutôt, c’est une étiquette qui lui colle tellement mieux… Transporteur3, Colombiana, Hitman.. .que des films d’auteurs pour ce tacheron de l’écurie EuropaCorp chère à Luc Besson. C’est d’ailleurs lui qui a écrit le scénario de Taken 2. Un film qui fait vroum vroum et pan pan, pif paf pouf dans ta face pendant 1 heure 30 et puis c’est tout…. Ce deuxième volet est incompréhensible. Autant on pouvait trouver un certain charme, un certain amusement à regarder Liam Neeson perdu à Parsi, sans argent en train de se dépêtrer avec des tueurs d’Europe de L’est qui avait kidnappés sa fille chérie. Il y avait un enjeu. Il allait débusquer toute une filière de prostitution en deux temps trois mouvement au grand damne de la police française. Liam Neeson et ses muscles allait venir à bout de cette mafia. Dans l’épisode 2, figurez-vous que l’heure de la vengeance a sonnée pour la famille mafieuse. Il est temps de venger les morts que Liam Neeson a fait. Donc le film reprend le même schéma sauf que cette fois, on est à Istambul, mais Liam Neeson va faire équipe avec sa fille chérie pour sauver son ex-femme de ces vilains gredins qui l’ont enlevé.

Taken 2, un film avec un réel intérêt. Si vous vous amusez à relever les invraisemblances, les approximations, vous aurez de quoi vous occuper. Par exemple, cette scène de l’accident de voiture. On imagine une ruelle étroite. Liam Neeson au vont de sa voiture s’engouffre. Il remarque qu’in automobile le bloque au bout de cette ruelle. Alors il enclenche la marche arrière. Seulement, une autre auto le bloque. Donc il stoppe son véhicule. Il est pris au piège. Et ben non ! Quand les malfrats ouvrent la porte de la voiture de Liam Neeson, il s’est volatilisé. Il est en train de galoper dans une rue adjacente... Wouahou, ce type est fort... il est tellement balaise, qu’il a un GPS dans la tête. Il est capable de se repérer dans une ville après avoir été trimballé avec un bandeau sur les yeux simplement en enregistrant les sons d’un chat, d’un aveugle qui joue du violon en faisant la manche... C’est du gros n’importe quoi. Taken .
LES SEIGNEURS
Bienvenu chez les chti bretons!

Les Seigneurs, une comédie populaire, et je dis pas ça avec arrogance. Y a rien de dédaigneux dans l’emploi de ce terme : comédie populaire. Au contraire. C’est plutôt une bonne chose que de penser à divertir le peuple qui en a bien besoin ces temps-ci. Ah ben, en temps de crise, on veut rire au cinéma. On veut pas se coltiner le malheur des autres.Alors tout l’enjeu des Seigneiurs est là. Va-t-on rire ? Oui, Danny Boon devrait se marer. Le nordiste va rire jaune en remarquant comment Olivier Dahan a recycler la formule gagante de Bienvenu Chez les Ch’ti. Ben oui, Les Seigenurs, c’est ça. Des types qui sont obligé d’aller bosser dans un blaid paumé. Ils y vont sans entrain, sans enthousiasme et vont finir par y trouver leur compte et même s’y plaire.

Pour camper ces gaillards, Olivier Dahan a réuni la crème des comiques hexagonaux : José Garcia, Gad Elmaleh, Frank Duibosc, Ramzy Bedia, Omar Sy. Il leur a collé dans les pates Joey Starr. Et pour parfaire le choc des générations, il a encore convoqué Maître Mariel. Jean Pierre donne ici un petiit coté Atomic Circus, le bide retentiossent des frères Poireaux. Vous vous souvenez de ce dingo de Mariel qui organisait la fête de la tarte à la bouze dans cette aventure de James Bataille ou déboulait des martiens venus faire la nique aux habitants de Skotlette city. Alan Chiasse dit Poelvoorde essayait par tous les moyens de tirer Conchia, alias Vanessa Paradis, la fille de Marielle. Il flottait la dedans un parfum de n’importe quoi réjouissant, tout ce qui manque aux Seigneurs! La tactique de Olivier Dahan est simple, mais efficace. Il confie un rôle de meneur à José Garcia. Ici, il incarne un alcoolo ancienne gloire du ballon rond en pleine déchéance. Chargé de mené le FC Molène à la victoire en coupe de France face à l’OM, lui, l’ancien numéro 10 des bleus, n’a d’autre choix que de rappeler ses anciens camarades de jeux pour relever le défi. Et voilà comment, Résidane, le résidu de Zidane Gad Elmaleh et son slip qui pue la marrée, Frank Dubosc reconverti dans l’acting, Ramzi le goal devenu cokaïnoman sereal niqueur, et Omar Sy le sosie de Thuram vont se retrousser les manches pour le bien de du FC Molène et de sa conserverie de sardine. Celle-ci est menacée par une faillite. Il faut trouver du pognon pour éviter la fermeture définitive et le chomage aux habitants de l’ile.

Ce fond social plutôt intéressant font de ces Seigneurs une comédie plutôt réussi, à défaut d’être totalement savoureuse. On sent que l’équipe s’est poilée sur le tournage. On imagine que Olivier Dahan est depuis en cure de repos, qu’il a du faire preuve d’un grand calme pour retenir cette équipe de furieux. Avec Les Seigneurs, il ne faut pas vous attendre à un film où l’on se bidonne à chaque minute. C’est un peu plus subtil que ça. D’aucuns diront plutôt, poussif au lieu de subtil… Toujours est-il que pour une première incursion dans ce genre-là, le Môme Olivier Dahan s’en tire pas trop mal. Pour sur que le box-office va s’affoler. Un film sur le foot avec un casting comme celui-ci, je prévois un minimum de 5 millions de spectateurs en France. Au Brésil, à peine 3 !!!
Les Saveurs Du Palais,
une comédie culinaire gouteuse mais pas très craquante

Christian Vincent est le réalisateur de LA DISCRETE avec Luchini… C’était son premier long métrage, immédiatement césarisé.
Juste avant ça, il avait fait quelques courts et surtout, s’était fait la main et l’œil en tant qu’assistant monteur sur ON SE CALME ET ON BOIT FRAIS A ST TROPEZ, ainsi que sur DEUX ENFOIRES A ST TROPEZ, deux des volets de la trilogie tropézienne de Max Pécas, le spécialiste des films vulgaires qui faisaient un carton dans les villes de garnisons, rapport au casting féminin courtement vêtu qui peuplaient ces films à chier. |
 |
Depuis, Christian Vincnent a roulé sa bosse. Récemment, il mettait en scène Lanvin et Viard en parents qui se déchirent dans Les Enfants. Il squattait également le Carlton sur la Croisette le temps de réaliser Quatre Etoile avec José Garcia, Isabelle Carré en escroc prêt à pigeonner François Cluzet. Christian Vincent prendrait-il gout au luxe ? Désormais, c’est dans le palais de l’Elysée qu’il a décidé de planter ses caméras… Enfin seulement pendant deux jours ! Pour le reste du tournage, il a du se coltiner à la météo changeante de l’Island et autrement, se réfugier en studio. Voilà ce qu’il en coute quand on veut raconter cette étrange relation entre inspirée d’une histoire vraie, celle entre une master cheffe du centre ouest de la France et le président Mitterrand. Epicurien devant l’éternelle, il aimait le gout du terroir, la cuisine authentique plus que les chichis des chefs parisiens. La cuisine prout prout machère, c’était pas son truc, d’où l’envie d’avoir à demeure, au 55, comme on dit, 55 rue faubourg St Honorée, une cheffe dont il appréciait la cuisine familiale, celle qui lui rappelait son enfance.

Bien sur que quand cette femme qui n’a pas fait d’école, qui n’a pas d’étoile, qui est sorti de nulle part s’est installé à l’Elysée, en cuisine, on ne lui a pas déroulé le tapis rouge. Bien au contraire. C’est en ce sens que le film est également intéressant. A l’Elysée, ça complote…. Partout, y compris derrière les fourneaux… Le film, qui se joue à 2 niveaux, montre, en flashback, 2 ans de la vie de cette femme au service du président 24h sur 24… En fait, on est en Antarctique et la cuisinière a décidé de sublimer la tambouille du personnel qui bosse sur cette base au milieu des glaces. Ici, il faut magnifier des surgelés… Autant dire que ça n’a rien à voir avec la mission qu’elle avait à l’Elysée, mission dont elle se souvient par bribe tout au long du film, alors qu’une journaliste tente de la faire parler et de faire un reportage sur ce personnage charismatique.

Pour jouer cette femme de caractère, Catherine Frot, actrice qui aime la bouffe et qui aime picoler, mais piètre cuisinière, selon les dires de Christian Vincent. C’est là que tu vois que c’est une excellente actrice! Elle fait parfaitement illusion lorsqu’il s’agit de nous faire croire qu’elle a mitonnée un chou farci au saumon. C’est un plat magnifique, du vert, de l’orange à l’écran… pour un cinéaste, c’est génial. Christian Vincent a choisi les plats en fonction de critères qui n’ont rien à voir avec le gout, mais plus avec l’esthétique. Ceci dit, c’était des vrais plats qui étaient préparés par des vrais chef. Les Saveurs Du Palais, c’est pas le mac do de la comédie, ce n’est pas non plus un épisode de Master Cheffe , tout juste un petit film de Christian Vincent, avec Jean Dormesson qui incarne Mitterrand… C’est sans doute l’élément le plus drôle quand on sait que les deux hommes se sont tout au long de leur vie opposé sur le plan politique…
LAWLESS,
Des Hommes Sans Loi,
A part celle du Tallion!
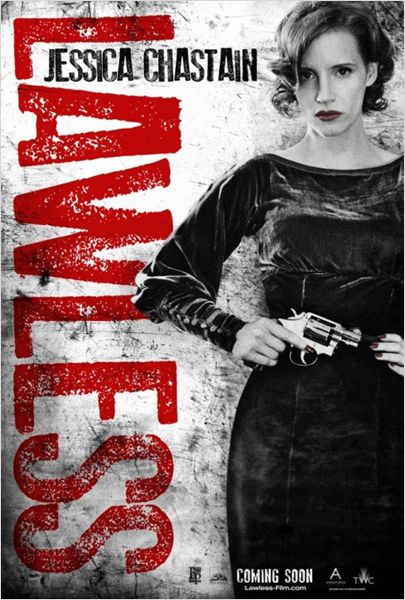
LAWLESS, Des Hommes sans loi, j’ajouterai : à part celle du talion. Ici, c’est œil pour œil, dent pour dent, gorge pour gorges, lorsqu’il s’agit d’en trancher une… oui, LAWLESS est une love story teintée de barbarie dans l’Amérique profonde tourmentée par la prohibition. En 1931, on ne se bourre pas la tête… ou alors en cachette ! En 1931, on distille en douce des tords boyau dans des alambiques de fortune planqués dans des forêts inaccessibles. Ces alcools sont tellement infâmes qu’on peut s’en servir comme carburant pour alimenter les automobiles… C’est dire ! Qu’importe la mauvaise qualité de ces whisky et autre prunelles maléfiques, il y aura toujours des cowboys pour picoler et se renverser la tête. à Franklin, en Virginie, comme partout ailleurs en Amérique. A Franklin, le commerce va bon train pour les frères Bondurants. Seulement, un jour, le nouveau procureur Wardell et son bras armés vont débouler de Chicago et réclamer leur part du gâteau. Un bras de fer va alors s’engager entre les ploucs qui distillent et les voyous aux cheveux gominés de la ville.

Lawless, un film avec de beaux décors et de beaux corps… à corps hyper sanglant. Il faut dire qu’à l’époque de la prohibition, on tirait dans le tas, on se mettait des bonne mandales et on n’hésitait pas à trancher des gorges s’il le fallait. On était comme qui dirait, bas du front. C’est le reproche que l’on peut faire au scénario, un peu simpliste et qui se déroule en parfaite ligne droite. Autant dire que l’on anticipe tout ce qui ce qui va se trame, dans ce film qui ressemble à un western. C’est vrai que l’histoire repose sur les archétypes du genre cher à Léone, avec son lot de bons, de brutes et de truands, sans parler de la femme fatale, des duels et de l’affrontement final ou ça pétarade.

Lawless, un film en costume de John Manteau… enfin, de John colline manteau, enfin John Hillcoat si vous préférez. Lawless avec au générique, Guy Pierce, Tom Hardy, Shia Laboeuf, Jessica Chastain et Nick Cave. Lui, il a signé la musique ainsi que le scénario adapté du roman de Matt Bondurant intitulé THE BWETTEST COUNTRY IN THE WORLD et dans lequel il raconte l’histoire de ces ancêtres. Il faut savoir que LAWLESS a été montré en compétition officiel au festival de Cannes en mai dernier. Il en est reparti assez logiquement bredouille. C’est en tout cas à la suite de la projection,, lors de la conférence de presse que le rocker Nick Cave a dévoilé ce qui lui avait plu dans le bouquin : « J’ai surtout aimé l’ambiance du livre. J’ai adoré cette histoire d’amour classique qui se trouve dans ce roman, mêlée à une violence excessive. Ces deux éléments conjugués m’ont réellement attiré. J’ai adoré cette espèce de sentimentalité teintée de violence crue ». De la violence, il y en a effectivement dans LAWLESS, du sentiment, un peu aussi… il y a surtout je le disais en pré ambule, une histoire un peu simpliste. A cette remarque, peut-être désobligeante, Jhon Hillcoat et Nick Cave ont répondu de concert… à Cannes: « Un livre est très dense et dans celui-ci, il comportait d’autres personnages, comme par exemple Henderson, un journaliste. En fait, il a fallu élaguer, simplifier, .et donc on a centré notre histoire sur ce qui arrive à certain personnages, sur les conséquences de leurs actes violent, sur la manière dont cette violence affecte leur vie. Donc, oui… on a juste voulu simplifier l’histoire de base. En fait, on ne savait pas vraiment si l’histoire des Bonduantes était vraie. on voulait juste faire un film à regarder en deux ou 3 heures. Il a donc fallu tout condenser mais il fallait que les choses aient l’air véridique. On dit d’ailleurs que c’est une histoire vraie, mais je ne sais pas si une telle histoire a réellement existée. Je ne pense pas que l’histoire vraie existe… Je voudrais rajouter (Hillcoat) que Matt est un excellent auteur qui arrive toujours a bien exprimer les choses, qui a du style et du talent à tel point qu’on pourrait croire que ces dialogues ont réellement existé. Je pense (Cave) que les Bondurants vont être très content quand le film sortira. Ils le sont déjà. Je les ai vu. Ils sont très très content ». Nick Cave et John Hillcoat, en représentation au festival de Cannes. C’est un peu les papy du Muppet… N’empêche que l’on retiendra que la mention écrite sur le générique de Lawless, tiré d’une histoire vraie, est un gros foutage de gueule… Ce qui intéressait réellement John Hillcoat, ce n’est pas tant de raconter un pan de la vie des Bordurant, mais plutôt de choisir le prétextes de ces personnages évoluant au siècle dernier pour raconter une histoire moderne: « Personnellement, je pense que cette idée de prohibition et précisément dans ce film, est très moderne parce que, d’une certain façon, ça existe toujours aujourd’hui. il y a toujours une guerre mais contre la drogue. Donc, en fait, on peut faire une espèce de parallèle entre les deux époques. C’est pour ça qu’on a repris les préoccupation de notre époque en les déplaçant dans une autre, à celle de la prohibition. on a cherché à le faire de manière authentique, en optant pour un style pouvant réunir ces deux époques. Voilà la logique qui a sous-tendu notre travail ». Un travail a découvrir en salle depuis cette semaine.
CAMILLE REDOUBLE
A voir deux fois
plutôt qu'une!
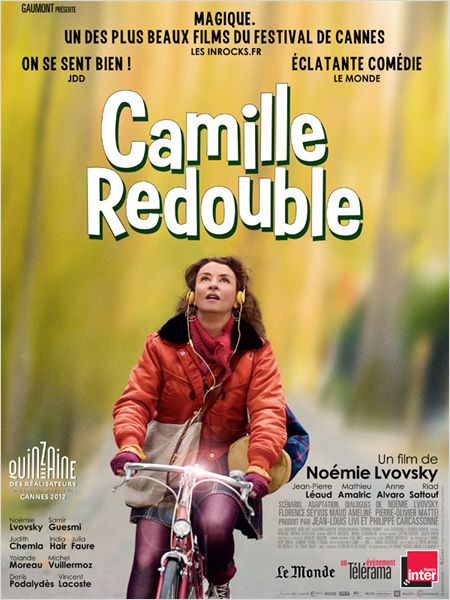
...de et avec Noémie Lvovsk. Il fut présenté en clôture de la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes cette année, et avait conquis critiques et jury puisque la société des Auteurs a remis son prix à Noémie Lvovsky. Et pour le coup, cette récompense n’était pas du tout usurpée. Quelques mois plus tard, comment va réagir le public ? Certainement très bien, car Noémie Lvovsky fait preuve d’originalité avec cette 5ème réalisation. Et ça, le public, il aime bien! Imaginez que Noémie Lvovsky incarne les deux Camilles du film, celle de 40 ans et l’adolescente! Quelle belle idée. Notez que sans cela, la scénariste réalisatrice n’aurait pas accepter de faire ce film. Camille Redouble est donc ce film un peu fou, que l’on attend depuis le début de l’année, et que l’on s’est tous fait un jour ou l’autre dans la tête. Qui n’a pas rêvé revivre son passé, revivre son adolescence mais en gardant à l’esprit tout ce que la vie nous a jusqu’alors appris. Bref, qui n’a jamais rêvé rectifier son passé pour améliorer son présent. Voilà de quoi parle Camille Redouble. Et c’est là que vous me dites que Coppola et son Peggy Sue est déjà passé par là. Oui, peut-être un peu. C’est vrai.
On était alors dans les années 80, en 85 sauf erreur. Peggy s’évanouit et revit sa jeunesse, les années 60, alors qu’elle est follement amoureuse de celui qui va devenir son mari. Effectivement, il y a de ça dans Camille Redouble. Et noémi Lvovski ne se cache pas pour dire que Coppola l’a influencé. Mais la différence entre les deux films, c’est que Camille ne revient pas dans le passé pour reconquérir son mari. Non, elle a une autre motivation.
|
 |
En tout cas, c’est sans Doloréan et sans l’aide du doc que cette Marty McFly va revenir en 1985, au lycée.

Camille dans sa jupe plissée, avec ses cheveux ondulés, son walkman jaune à k7 vissée sur les oreilles, écoute à fond Nena f… elle revoit ses parents, ses amies et elle ne comprend pas.
. Sans doute rêve-t-elle. A priori non ! alors Camille se fait une raison et se dit qu’il faut profiter de cette occasion de revivre cette jeunesse à fond. Mais attention à ne pas commettre les mêmes erreurs qu’elle a déjà commises une fois.

Malgré quelques longueurs, Camille redouble se laisse agréablement regarder sans doute parce que dans ce film de science-fiction un peu autobiographique, ce qui est étrange pour de la SF, Noémi Lvovski met beaucoup d’elle. Déjà, le film a été fait en réaction à la séparation d’avec son homme. Le film est également dédié à sa maman, décédée. La Camille des années 2000 est toute heureuse de pouvoir reparler à sa mère décédée dans les années 80. Alors, elle a le réflexe d’enregistrer sa voix, et celle de son père aussi, comme pour garder un témoignage impérissable de ses parents, dès fois qu’elle revienne un jour en 2012. Au passage, ses parents sont interprétés magistralement par le duo Michel Vuillermoz Yoland Moreau, excellent comme toujours.

Dans ces années 80, on retrouve aussi quelques uns de ses amis, des acteurs de sa famille et notamment Mathieu Amalrich, incroyable de drôlerie en prof de français maniéré, qui fait la police dans sa classe avec son sifflet au bec et traite toutes ses élèves de pucelle décérébrée qui ne pense qu'à noircir des journaux intimes insipides plutôt que de réviser leurs classiques ! Cette scène géniale ne manquera pas de faire sourire les quarantenaires qui ont peut-être eut affaire à ce genre de gugusse là. D’autres brillants acteurs apparaissent furtivement comme Jean Paul Léaud en bijoutier horloger maître du temps ou encore Denis Podalydes, alias Alfonse, Voilà un prénom qui va vite, Alfonse, le prof de science fera néanmoins du sur place, dépassé qu’il sera par cette Camille revenu du futur. Camille Redouble, l’excellente comédie de science fiction autobiographique de cette rentrée .
HIT AND RUN
Quel bon titre!
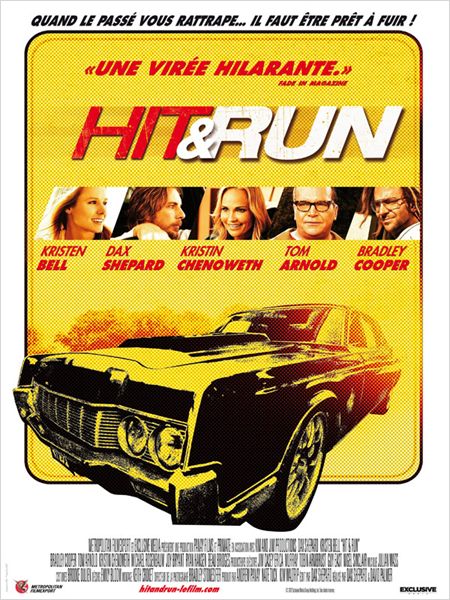
C’est vrai, Il n’y a rien d'autre à faire que de détaler devant ce film pas très percutant. Et pourtant, avec un si bon titre, on se dit que ça va frapper et courir, bastonner et cavaler dans tous les sens, qu’il y aura des coups de feu, de la tôle froissée, des belles pépés, des vilains garçons, des biftons, de l’émotion, de la dérision, de la trahison, de l’action. Sérieux, il fait rêver ce titre : Hit And Run… il promet au spectateur de passer un délicieux moment dans une salle sombre. Il attire. Il nous fait de l’œil. Il nous dit : allez viens, cours et Frappe à la porte du cinéma, tu ne le regretteras pas ! Ah ben pour sur, si vous aimez les films ou on dépense beaucoup de salive pour pas grand-chose, vous serez conquis! Pour les autres, le dépit sera votre seul ami !

Et pourtant, l’affaire ne s’engage pas trop mal. On peut être conquis par la scène d’ouverture, digne d’un Buster Keaton. Un marshal homosexuel téléphone au volant de sa voiture. Il se gare. Tout en continuant sa conversation téléphonique, il descend du véhicule. Sans qu’il ne s’en rende compte, son mini van se barre, tout seul, comme un grand, comme un signe annonciateur pour dire au spectateur… barrez-vous… bande de gogo, faites comme moi, la voiture intelligente, tirez-vous en douce. En fait, la commande électronique de l’aide au pilotage s'est enclenchée toute seule et le diabolique engin s’est mis à rouler sans chauffeur. Evidemment qu’il prend de la vitesse et le piéton, Randy, le Marshall homosexuel, dégaine son flingue pour stopper le bolide: En vain. Le van s'immobilise néanmoins un peu plus loin grâce à un talus magique. Il stoppe pile devant deux gamines qui jouent dans un jardin. La catastrophe est évitée de peu. Après cette scène d’ouverture assez drôle, les zygomatiques vont pouvoir se crisper jusqu'à la fin du métrage ou l’on va se coltiner pendant plus d’une heure trente, une gonzesse insupportable qui psychanalyse son mec en permanence ! Il lui a caché tellement de chose sur son passé de voyou, d’as de la conduite au service de cambrioleurs. Pour que l’histoire avance un peu, et parce qu’on est aux States, patrie du road movie, les 2 tourtereaux dont la relation a du plomb dans l’aile, vont s’embarquer pour LA, là où la demoiselle doit passer un entretien d’embauche. Seulement, le voyage sera perturbé par l’ex petit ami de la nana, les ex-petits amis du truand repenti, et une ribambelle de flics homos. Dans Hit And Run, Flic égale pd… quoique non, il ne faut pas dire Pd. C’est la gonzesse insupportable qui insiste. Il faut être respectueux et dire homosexuel! C’est un peu le message de ce film jamais drôle, toujours ennuyeux, aussi excitant qu'une séance dans le canapé d'un psy! Parce que Hit And Run se limite à ça, une nana qui psychanalyse son mec dans toutes les situations.

Finalement, la relation amoureuse tumultueuse au sein d’un couple en cavale, plus que la fuite des malfrats, prend le dessus. Derrière ce faux film de gangster et de course poursuite infernale se dissimule en fait une romance insipide. Notez que je n’ai pas dit comédie romantique, mais romance. Dans la mesure ou toutes les tentatives de dialogues comiques tombent à l’eau, on ne va surement pas ranger Hit And Run au rayon comédie romantique. Avouez qu’il y a de quoi rester atterré devant cette conversation sur l'ethnie d’un type qui en a violé un autre en prison, tout ça pour en arriver à la conclusion : mon trou du cul à voyager jusqu’au Mexique… C’est lourd… mais plus lourd encore, les phrases qui précèdent cette chute, un dialogue raciste et bourré de clichés. Voilà ce qui arrive quand on écrit un script en 3 semaines et qu’on ne se donne pas la peine de le relire. On croit avoir signé la comédie de l’année et en fait, on a rien pondu d’autre que la fiente de l’année. Oui, Dax Shepard, l’auteur réalisateur de Hit and Run s'est peut-être fait plaisir en se confiant le rôle principal et en réunissant pour la secondes fois dans un film ses potes, mais il a juste oublié de faire plaisir au public. Et ce n’est pas la présence de Bradley Cooper et de ses lunettes de soleil aux verres jaunes, Bradley Cooper habitué aux very bad trip, qui va ré hausser le niveau. Comptez pour cela sur la musique, la seule note positive de ce Hit and Run, une compile hétéroclite à base de soul, de Fela, de pop rock, de nujazz, de Hendrix, de Dylan....Mais bon, allez au cinéma pour écouter un disque, c’est un peu limite !
WRONG
Ca manque de chien!
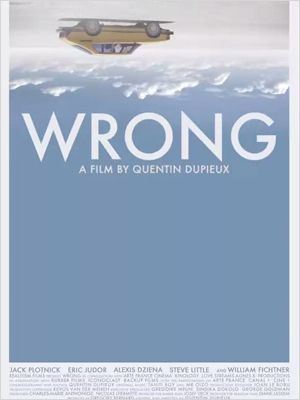
WRONG, le nouveau film de Quentin Dupieux sort enfin au cinéma. Il a été présenté au festival de Sundance en début d’année avant d’être dévoilé à Locarno cet été. On pensait le voir à Cannes, et en fait, pas du tout. A la place, Quentin Dupieux a refourguer un court métrage intitulé WRONG COPS chapiter one. Aucun lien de parenté entre Wrong Cops et Wrong. Quentin Dupieux dit juste qu’il est trop fainéant pour trouver des titres donc il a décidé de jouer la carte du Wrong parce que Wrong, ça sonne bien. C’est vrai qu’avec un titre pareil, on imagine tout de suite une route, un camion en feu qui se consume pendant qu'un pompier fait caca un peu à l'écart de cette scène d’accident. Le fireman baisse son froc, s'accroupi au milieu de la route et pause un bronze en lisant le journal.

Bienvenu dans WRONG, un film un peu poussif et le terme poussif n'a rien à voir avec le pompier qui défèque! Poussif par rapport à Rubber. Vous vous souvenez de Rubber, ce film déjanté et gonflé avec un pneu télépathe et tueur en série. Poussif aussi par rapport à Steak qui mettait en scène le duo Éric et Ramzi dans un monde futuriste où tout le monde ne jurait que par la chirurgie esthétique. On se saluait en gueulant Cheevers ou Botine quand on voulait se foutre de la gueule d'un type pas trop dans le coup. Poussif encore par rapport au Non Film, un ovni, le premier de monsieur Oizo, un court métrage un peu long d'une cinquantaine de minutes ou l'on se rendait compte au bout d'un moment que les personnages étaient en réalité des acteurs évoluant sur un plateau de tournage, tournage qui allait virer au carnage involontaire avec pas mal de morts. Donc avec WRONG, et son début où ce pompier fait caca au milieu de la route, on se dit que Quentin Dupieux en a peut-être chié pour torcher un scénario aussi surprenant que les précédents. Et cette impression se confirme malheureusement assez vite. Dans Wrong, Quentin Dupieux empile les situations incongrues, certes dopées aux dialogues abscons, mais il manque un véritable enjeu dramatique fort pour maintenir le spectateur sous pression. Elle est là, l’erreur dans Wrong! Contrairement à Dolph, le personnage principal, on la débusque tout de suite l’erreur. Dolph est beaucoup peiné. Son chien Paul a disparu. Dolph a beau l'appeler, le siffler, l'animal ne répond pas et semble avoir déserté le domicile. Dolph en parle avec son voisin d'en face. Mais ce dernier n’a rien vu. C'est alors que Dolph remarque sur son paillasson, un flyer pour une nouvelle enseigne de pizzas à domicile. Dolph compose le numéro, non pas pour commander une pizza, mais pour avoir des explications sur le logo étrange, un lapin sur une mob. C'est sympa, un lapin sur une mob, mais ça veut dire quoi, au juste, un lapin sur une mobylette? Que la livraison sera super rapide? Oui lui confirme l'hôtesse au téléphone : avec ce lapin au guidon d'une mobylette, on insiste sur la rapidité. Dolph trouve ça complètement con car un lapin va de toute façon plus vite qu'une mob. La conversation en reste là mais avant de raccrocher il précise qu'il s'en fout de ce logo et que ce petit moment au téléphone lui a juste permis d'oublier un instant la disparition de son chien qui le rend si triste. C’est alors que le jardinier de Dolph se pointe chez lui. Il a un vrai problème. Le palmier planté dans le jardin quelques jours plus tôt s'est transformé en sapin de Noël! C'est étrange, sans doute une maladie, s’interroge le jardinier. Dubitatif, il promet de trouver une solution, pendant que Dolph sera au travail. On ne sait pas trop ce que lui et ses collègues glandent dans cet open space où il pleut des cordes sans interruption. Si dehors le temps est sec, à l'intérieur, il pleut en permanence.

Malgré ses nombreuses idées rigolotes, WRONG patine un peu. Certes, les personnages sont suffisamment intrigants et franchement bien joués. Master Chang, alias William Fishtner, le flic de la CIA psychotique popularisé par la série Prison Break, trouve ici un rôle à sa mesure, celui d’un gourou charismatique, auteur du livre qui changera votre vie MY LIFE, MY DOG, MY STRENGHT, ma vie, mon chien, ma force. Il est inquiétant avec ses rêves prémonitoires. Le détective privé à la solde de Master Chang qui mène une enquête inutile sur la disparition du chien, mais sans jamais emporter avec lui la moindre photo, est bien allumé lui-aussi avec cette manie de lire le passé de l’animal dans ses crottes et son gros colon. Et que penser de ce jardinier un peu con brillamment interprété par Eric Judor ou de cette réceptionniste nymphomane de la pizzeria à domicile qui fait passer ses billets doux dans les pizzas qu'elle fait livrer? Pas d’erreur, il casting et la direction d’acteur est parfaite dans Wrong. La seule erreur commise par Quentin Dupieux est de se répéter. La télépathie qui était au cœur de Rubber s'invite également dans WRONG. Dupieux peine donc à se renouveler et m’est avis qu’avec son prochain film WRONG COPS, le sentiment sera le même.

WRONG COPS est visible sur le web sur videobash.com. On y croise Marylin Manson, en ado qui écoute de la techno au pied d’un arbre. Un flic, dealer d’emphet, venue pisser devant Manson lui demande si il veut prendre sa bite en photo… le flic arrête l’ado, l’embarque chez lui pour lui enseigner l’art de la musique, en slip dans son salon… WRONG COPS, 13 minutes décapantes, complètement barges, bien plus encore que WRONG. Wrong Cops à voir gratos sur le web, avant de filer découvrir WRONG au cinéma. Un conseil, restez après le générique de fin de Wrong!
TURN ME ON
Les malheurs
d'Alma La Bite!
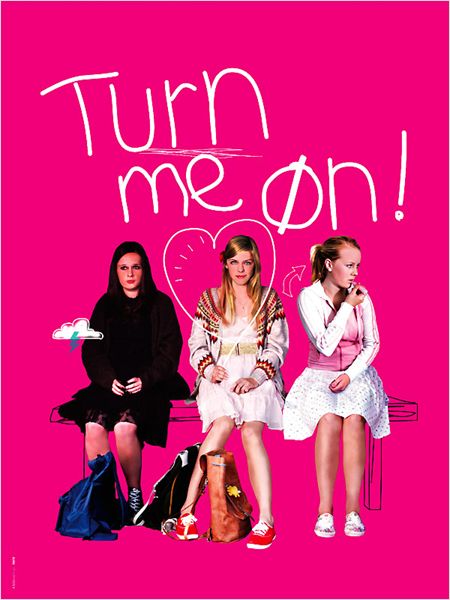
Du haut de ses presque 16 ans, Alma est grave excitée. Elle appelle régulièrement un téléphone rose surtaxé pour se payer son petit orgasme à même le sol, allongée dans la cuisine de la maison familiale. Vivant seule avec sa mère, Alma est très copine avec les sœur Bjorne, une blonde qui passe son temps à se glosser les lèvres et une brune rebelle qui rêve de se tirer au Texas pour abolir la peine de mort. Dans ce petit bled loin, très loin de la grand ville Oslo, la jeunesse s’emmerde. Il n’y a rien à glander, à part boire des bières à l’abri bus du coin. Ici, les routes sont soit désertes, soit désertes avec un tracteur, soit déserte avec des mouton à la noix qui errent. Un soir que la fête des jeunes bat son plein à la MJC du coin, Alma sort en douce pour boire une bière en solitaire. Arthur, le guitariste de la chorale du village, celui qui fait flancher la blonde Bjorne, mais auss Alma, la rejoint. Sans prévenir, il sort sa bite et l’exhibe devant Alma. L’histoire en reste là. Alma, de retour dans la salle, après un orgasme rapide en solo dans les chiottes, raconte l’affaire à ses copines. La rumeur se répend comme une traine de sp… de poudre… Mais Arthur nie en bloc. Alma est en quelque jour exclus de la communauté. Solitaire, elle prend sur elle pour éviter le regard moqueur des autres jeunes de son âge qui l’accusent d’avoir inventé toute cette histoire. Exclus au collège, exclus des fêtes, pour enfoncer le clou, le petit manège téléphonique d’Alma est bientôt mis à nu par sa mère qui découvre le gros poteau rose de l’interlocuteur de la ligne téléphonique sur taxée. Plus de 6000 couronnes dans une facture, ça ne passe pas inaperçue. Rejetée par sa mère, Alma doit définitivement affronter seule sa mauvaise réputation et sa libido de plus en plus débordante. Mais jusqu’où ira le calvaire de celle que l’on surnomme désormais Alma La Bite?

Inspiré d’un roman culte à succès dont je vous ferai grâce du titre norvégien, le récit a déjà donné lieu à une pièce de théâtre avant de prendre corps au cinéma. Plusieurs bonnes idée, indépendamment de l’aventure désastreuse d’Alma, jalonnent cette perle de comédie nordique. D’abord, il y a les fantasmes d’Alma. Elle rêve de son prince charmant, mais évidemment, pas d’un prince charmant qui sort sa bite à l’improviste. Elle peut aussi se retrouver avec un rouleau de pièce de 1 euro enfoncé dans la chatte pour mieux fantasmer sur son patron, alors qu’elle s’emmerde à la caisse de la supérette déserte du village ou elle travaille pour rembourser sa facture de téléphone. On a parfois la peine à faire la part entre rêve et réalité. Disons qu’on se laisse prendre à croire que ce que l’on voit à l’écran se passe réellement avant que, par un subterfuge habile, la réalisatrice remette Alma au cœur de sa réalité, toute autre. Et puis, régulièrement, la voix off de Alma commente ce qui pourrait se passer derrière son dos, alors que sur l’écran défile un diaporama, étalage de photo en noire blanc qui montre ses camarades de classe. Si la curiosité liée au sexe à l’adolescence est bien croquée dans ce film, la cruauté des ados entre eux aussi. Pour amener un supplément de véracité, la cinéaste a en plus opérer son casting dans la région même où se déroule l’intrigue du roman. De telle manière, ces acteurs non professionnel pour la plus part savait ce que signifiait que de grandir dans un village aussi paumé que celui du film.

Auréolé d’une polémique à sa sortie en librairie en 2005, le film adapté du roman n’a pas échappé lui-aussi à sa polémique. Avant même que le film ne soit visible dans les cinémas norvégiens, les médias se sont emparés du sujet sulfureux du film, un sujet encore tabou, la sexualité des ados. Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour un premier film, Jannicke Systad Jacobsen a réussi son coup, un film court, pas plus de 1h15, qui va droit au but, sans fioriture, esthétiquement bien maîtrisé et qui repose sur un casting d’ado subtilement dirigé. On a qu’une chose à dire : encore!
L'ETRANGE POURVOIR
DE NORMAN:
un animé complètement zombiesque
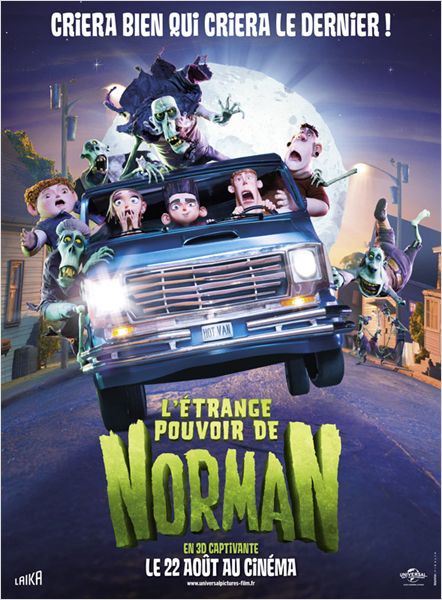
Comment initier vos chérubins de 10 ans au film de pétoche? En les laissant se frotter à L’Etrange Pourvoir de Norman, le premier long métrage d’animation de Chris Buttler, un acteur de série télé de seconde zone arrivé là on ne sait trop comment. Certes, il n’est pas seul aux commandes. Sam Fell, qui a déjà œuvré sur Souris City et La Légende Despereau, est aussi crédité comme réalisateur de L’Etrange Pourvoir de Norman, un film ponctué de références au cinéma fantastique ou horrifique: les morts vivants de Romero, le petit garçon qui voit des fantômes à l’instar de celui de Shyamalan dans le 6ème sens, l’exorciste en sonnerie de téléphone, le masque de Jason de Vendredi 13, La Chose de la Famille Adam ou encore la griffe de Freddy qui caresse un mur… Rien ne manque, y compris le van de Scoubidou! Excusez du peu, mais certain épisodes de Scoubidou, quand on avait 10 ans, nous faisait furieusement flipper! Ici, l’ambiance est donc à l’épouvante avec l’âme d’une fillette jugée en 1712 pour sorcellerie et qui revient aujourd’hui hanter la ville et réveiller les morts. Tout ça pour se venger du sort qu’elle a subi. Norman, le mouton noir du collège, celui que l’on moque, celui que l’on prend pour un illuminé à force de le voir parler seul dans les rues, celui qui n’a pas d’ami hormis Bouboule, le petit gros autre mouton noir de l’école, sera le seul à pouvoir conjurer la malédiction. A Moins que la sorcière ne se laisse pas convaincre aussi facilement de mettre sa rancune de côté.

Si les adultes ne se crisperont pas sur leur fauteuil, il est sûr qu’ils se feront un plaisir de débusquer les références. Pour les mômes, ils apprécieront certainement le radio réveil à bras de zombi qui pointe vers le ciel et lance un râle en guise de sonnerie. Ils reconnaîtront probablement en Courtney leur grande sœur ado stupide qui en pince pour le bobet musclé du lycée gentiment con et s’identifieront aussi à Norman ou à son copain Bouboule. Ce sera fonction du poids! Les deux looser magnifiques sauront braver leurs angoisses, se conduire en héros et connaîtront leur heure de gloire. Les enfants apprendront encore quelques valeurs bien saines comme la notion de pardon. Oui, il faut savoir donner une seconde chance à celui qui a commis une erreur, à condition qu’il l’admette. Les enfants comprendront aussi aisément que l’ignorance et l’aveuglement peuvent engendre la peur, cette si mauvaise amie. La peur conduit à prendre de mauvaises décisions. Elle n’est pas bonne conseillère. Au pire, à cause d’elle, on peut condamner injustement un innocent, innocent qui ne rêvera que d’une chose, se venger. Pour le coup, c’est nouveau dans une production américaine, la vengeance est décrite comme malsaine. La vengeance n’amène rien de bon. Elle ne guéri rien, et ne permet surtout pas de refouler sa haine. Et tant pis si on a été mis au banc de la société sur une erreur de jugement et que l’on se retrouve isolé avec pour seuls amis, la haine et le besoin de vengeance. Il faut résister et se dire que de toute façon, on n’est jamais seul au monde. Il y aura toujours quelque part un ami sur qui compter. Encore faut-il se donner la peine de le débusquer.

De l’action, du frisson, de l’humour, une morale sauve, un happy end, voilà ce que recèle L’Etrange Pourvoir de Norman, un animé en stop motion, technique qui recréer le mouvement image par image, autant dire un boulot de dingue. Pour une à deux minutes de film, il faut compter une semaine de travail minimum. Dans des décors bien réels, des figurines en silicones et en plasticines, matières facilement modulables, sont positionnée de manière précise avant chaque cliché. Bien sûr, depuis le King Kong de 1933 ou le Jason et Les Argonautes de 63, la technique a bien évolué. Wallace et Gromit en savent quelque chose; les Pirates, le Fantastic Mister Fox ou encore le couple Mary and Max aussi.

A noter que L’Etrange Pouvoir de Norman a été produit par Laika Entertainment, nouveau studio qui s’est déjà fait remarquer pour sa participation aux Noces Funèbres de Tim Burton ou plus récemment, en produisant Coraline, un autre animé fantastique avec un monde parallèle sous terrain plutôt terrifiant. Clin d’œil amusant dans L’Etrange Pouvoir de Norman, l’animé débute dans la chambre de Norman alors qu’il regarde avec amusement en compagnie du fantôme de sa grand-mère un film de zombie intitulé justement Laika .
Un Amor
un film inutile

Un Amor est le 3ème long métrage de Paula Hernandez. Dénominateur commun entre ses 3 films: la rencontre, la séparation, les retrouvailles, en un mot, l’amour. L’amour et la mollesse aussi, mais j’y reviendrai plus tard. L’amour est donc le beau matériau de base du travail de cette cinéaste argentine. Qu’est-ce que l’amour? Un lien qui unit des gens? Une tentative de créer ce lien? Un sentiment qui nous anime tout au long d’une vie et aussi meuble qu’une boule de pâte à modeler que l’on triture, forme ou déforme à sa guise, en fonction de ses humeurs et autres inspirations du moment? Qu’est-ce que l’amour? Vaste question qui n’attend finalement pas de réponse définitive. Alors à quoi bon faire un film si on sait d’avance que l’on apportera que des réponses floues et approximatives. C’est bien là le problème de Un Amor, un film gentillet, ni complètement réussi, ni définitivement raté, simplement insignifiant, voir inutile. Chacun sait qu’une relation amoureuse peut être sombre ou lumineuse, éternelle ou éphémère. L’amour est un mystère et c’est justement le propre des mystères que de rester inexplicable! A quoi bon tenter de résoudre l’énigme de cette relation qui se noue ou se dénoue entre deux être? Même si c’est ce qui intrigue Paula Hernandez depuis toujours, je lui conseillerai de passer à autre chose. Ce nouvel essai cinématographique, ce joli petit film, comme on dit quand on pense un long métrage vain, n’apporte effectivement rien de nouveau que l’on ne savait déjà. Tout tend ici à démontrer qu’il est illusoire de penser qu’un jour, l’on pourra revivre avec autant de force, ressentir avec autant de puissance la tempête intérieure qui nous a secoué à l’adolescence au moment du premier véritable amour. Le coup de foudre adolescent n’arrive qu’une fois dans une vie et la nostalgie de ce moment passé n’amène rien de bon quand on est à l’aube de sa quarantième année et qu’on veut le revivre à tout prix. Vouloir renouer avec un amour de jeunesse n’est pas une bonne idée. Cela occasionne trop de questionnements. Cela suggère une remise à plat de toute sa vie, une évaluation de ses choix, bons ou mauvais. Malheureusement, quand on a commis des erreurs, on ne peut les corriger. Il faut vivre avec. Bravo, belle découverte!

Un Amor commence donc là. Lisa, les traits tirés ressurgit soudainement dans la vie de Bruno. Scénariste pour la télévision, marié et père de famille, il est sous le choc de ces retrouvailles. Que fout Lisa chez lui? Que cherche-t-elle au juste? Lisa explique qu’elle veut revoir Lalo. Elle demande à Bruno s’il a des nouvelles. Bruno reste vague. Lisa est de passage dans la ville et insiste pour retrouver Lalo avant qu’elle ne s’en retourne chez elle. Bruno n’est pas très chaud. Il repense alors à cet été, lorsque lui et Lalo, deux copains aussi complices que deux frangins, tombèrent amoureux de Lisa simultanément. Pendant quelques mois, Lisa, Bruno et Lalo ont vécu une étrange histoire d’amour à 3. Mais les années ont passé. Chacun a mené sa vie de son coté en conservant dans un coin de sa mémoire le souvenir impérissable de cette love story adolescente estivale. Bien sûr, quand Lisa déboule à l'improviste chez Bruno, le fantasme de revivre ces instants heureux les hantent tous les deux. Mais un fantasme doit rester un fantasme. La nostalgie n'a pas que du bon. Revivre le passé au temps présent et s'imaginer que tout sera comme avant n'est qu'illusion, une illusion qui ne peut conduire qu’à une désillusion. Par le biais d’aller-retour régulier entre le présent et le passé sur fond de piano un peu mélo, Paula Hernandez tisse ainsi sa toile, une toile sans surprise et molle.

En effet, Un Amor est un film qui sérieusement manque de peps et d’humour, notamment sur la période adolescente des protagonistes, pour envouter le spectateur. Quand on a 16 ans, on fait des conneries. On est insouciant. Malheureusement, on n’a jamais l’impression que les 3 ados vivent des moments si puissant que ça, si complices au point qu’ils seront affectés toute leur vie, hantés par cette histoire d’amour. Pire encore, on finit par se dire que Bruno ne songe qu’à baiser une gonzesse pour se dépuceler, alors que Lalo, lui, ne pense qu’à baiser la pute du village pour ne pas souiller celle qu’il aime réellement. Il le dira d’ailleurs : «dans la vie, Il y a les femmes qu'on baise et celles que l'on épouse». Après tout, c’est peut-être ça, la meilleure définition de l’amour. Mais si c’est le cas, il n’y avait vraiment pas besoin de faire un long métrage aussi peu intéressant pour l’affirmer !
A COEUR OUVERT
A voir les yeux fermés!

On ne va pas prendre de pincettes pour tailler en pièce A Cœur Ouvert, le nouveau long métrage de Marion Laine. Le bistouri et le scalpel seront sans doute de bien meilleurs alliés. Vous me direz peut-être que je manque de cœur. Je vous répondrai que Marion Laine, la réalisatrice, en a pour nous deux. Certes, elle manque de couille, mais pas du cœur, elle en a plein, c’est sûr, et pas uniquement dans les titres de ces films. Oserai-je vous rappeler qu’avant A Cœur Ouvert, elle a réalisé Un Cœur Simple! Vivement le prochain, Coeur Croisé, peut-être! Ah non, déjà fait par le grand réalisateur Monsieur Playtex! Trêve de bêtises. Pour résumer le fond de ma pensée, je vous dirais bien qu’A CŒUR OUVERT est un film à voir les yeux fermés, mais comme on a signé la trêve des bêtises, je me contenterai de juste souligner qu’il s’agit d’un long métrage parfaitement inutile. En effet, à quoi bon se coltiner l’histoire prévisible d’un couple à la dérive? Qu’y a-t-il de neuf dans l’approche, dans le discours, dans les thématiques soulevés, dans la mise en scène, dans le montage ? Rien. Absolument rien! Juliette Binoche se regarde jouer, comme toujours, pendant que Edgar Ramirez tente vainement de faire passer une émotion dans un français approximatif. On ne va pas lui jeter la pierre car il n’y a rien de moins facile que de faire croire à l’existence d’un personnage et de faire passer toute une palette d’émotion dans une langue qui n’est pas la sienne. Il est sincère le Edgar. On sent qu’il y met tout son cœur, si je puis dire, mais ça ne suffit pas. On finit même se demander si le gars qu’on voit gesticuler et maugréer dans sa barbe sur l’écran est le même que celui qui nous a tant subjugué dans le rôle du terroriste Carlos. On a surtout la démonstration évidente que si Olivier Assayas est un excellent directeur d’acteur, Marion Laine, elle, a encore du boulot devant elle!

Que je vous dise que Juliette Binoche et Edgar Ramirez, alias Mila et Javier, vivent en couple. Ils sont heureux. On croirait deux ado complices, joueurs, rieurs, insouciants. Ils connaissent le rpénom de tous les barman de leur quartier et franchissent les grilles du zoo la nuit pour s’encanailler au milieu des roseaux. Ces deux adulescents sont en fait deux chirurgiens, spécialistes du cœur, qui ne se mettent jamais la rate au court bouillon. Ma foie, admettons! Dès le début d’ailleurs, le ton est donné. On entre dans ce film comme dans un épisode de Grey’s Anatomy, par le bloc opératoire, là ou Juliette Binoche rigole en triturant vaguement un cœur en silicone pour nous faire croire à son personnage de Mila. Seulement, si la calotte en papier sur la tête, le masque devant la bouche, la blouse et les gants en latex peuvent faire illusion 30 secondes, ses gestes, eux, ne tromperont personne. Pas plus que Javier. Lui aussi ne trompe personne. Arrivé en retard au bloc, il ne trouve rien de mieux que de s’envoyer une bonne rasade de whisky en cachette avant d’entrer dans l’arène et d’exercer son art. En une scène, tout est dévoilé: les regards complices et amoureux échangés entre les deux chirurgiens, l’alcoolisme de l’un, l’aveuglement de l’autre qui le couvre devant les collègues du bloc peu dupes. Tout est dit et l’on devine dès lors que ce couple va vaciller. Evidemment, cette impression se vérifie très vite, alors que dans la scène suivante, après cette opération réussie, tout le monde se retrouve le soir pour s’imbiber d’alcool au troquet du coin. Mais le réveil sera difficile. A l’hôpital, Javier, malgré son talent et sa notoriété, est mis sur la touche. Il a refusé d’entrer en cure de désintoxication. Le chef de clinique ne peut le couvrir plus longtemps. C’est là que Mila tombe enceinte. Elle qui s’était jurée de ne jamais avoir d’enfant. L’ivg lui semble une solution évidente. A moins que pour sauver son couple, elle décide de garder cet enfant. Se sentir mère ou le devenir simplement en pensant que ça règlera les problèmes, tel est le questionnement du film. Oui, devenir maman et même en profiter pour tout quitter, une situation matérielle confortable, une petite vie égoïste bien réglée, des amis, voilà à quoi songe Mila. Elle imagine que de repartir à zéro, ailleurs avec enfant et mari sous le bras, l’alcoolisme de sa moitié disparaîtra comme par magie. La fuite comme unique solution ? Mila s’accroche à ce rêve, malgré les mises en garde de l’ami et confident de Mila, Marc, joué par un excellent Hippolyte Girardot. Mais au-delà de l’alcoolisme et de la maternité, un autre thème est également disséqué, celui de la domination dans le couple. En l’occurrence ici, Mila a le dessus sur Javier. Elle agit seule, toujours seule. Elle prend ses décisions seules. Elle choisit seule d’avorter ou non. C’est elle qui suggère le nouveau départ, alors que lui, il doit s’effacer, tout le temps. La cause de son alcoolisme est peut-être ici, dans cette domination exercée par cette femme sur cet homme, un type qui a de la peine au fond de lui, à le supporter.

A Cœur Ouvert, un drame qui, sur le papier, s’emmanche plutôt bien. Malheureusement sur la toile, c’est une autre histoire, sans saveur et beaucoup trop prévisible. Vous me direz que quand on s’appelle Marion Laine, y a pas de honte à tricoter un film ou l’intrigue est cousue de fil blanc ! Pour tout dire, A CŒUR OUVERT s’essouffle en réalité assez rapidement et tourne très vite en rond. A l’instar de cette ritournelle, Baisa me mucho et qui revient en boucle régulièrement, le film fini par gonfla me mucho ! Non seulement, on anticipe le drame, mais en plus, on se lasse très vite de cette relation qui manque de corps. On finit par oublier ces personnages pour se concentrer uniquement sur la fabrication. On ne voit que ça, c’est dire si la direction d’acteur n’est pas le fort de Marion Laine. L’exemple le plus criant intervient lors de la grande explication entre les deux tourtereaux. Chacun a atteint ses limites et le point de non-retour est prêt d’être franchi. Normalement, ce genre de scène se tourne en plan séquence, pour permettre aux comédiens une réelle progression dans l’engueulade, pour amener un peu de véracité dans ce moment d’une intense gravité. Au lieu de ça, on se farcit un découpage approximatif, des champs contre champs artificiels. On ne ressent aucune émotion à part celle du monteur qui a galéré pour débusquer des bouts de prises à peu près bonnes et assembler ce qui ressemble au final à une scène d’empoignade molle et fade, jouée sans conviction. Tout ça sonne affreusement faux, mais ce n’est pas le pire moment du film. Il y a aussi celui de la barque qui tombe dans une cascade.

A ce stade, Mila est prise entre deux eaux. Elle rêve qu’elle se trouve sur une barque à la dérive. Des scènes sont donc filmées avec Juliette Binoche à bord de l’embarcation. Mais bientôt, le petit bateau est happé par une cascade. Emporté par un courant très fort, la barque chute et l’on remarque qu’à l’intérieur, Juliette Binoche a évidemment laissé sa place à un pantin! C’est du Benny Hill involontaire. Quand on n’a pas les moyens de ses ambitions, on s’abstient. On ne tourne pas ce genre de scène dont on sait d’avance que le résultat sera à l’image de tout le film, ridicule. Décidément, les seuls moments de grâce du film surgissent lors des fondus au noir, lorsqu’entre deux scènes, il n’y a plus rien à voir sur l’écran! A Cœur Ouvert, à oublier et vite!
EXPANDABLES 2
Plus Explosif que que 1!

L’escouade des Rambodybuldés à la retraite reprend du service pour cette fois empêcher un super vilain de refourguer 5 tonnes de plutonium russe oubliés dans une mine. Les vendre à qui ? On ne sait pas et on s’en fout. C’est clair que Expendables2 n’est pas un film qui invite à la réflexion. Pour une fois, il n’y a qu’à se caler dans son fauteuil et attendre que ça se passe en comptant les explosions, et les munitions dépensées. A la louche, en moyenne, on tire au moins 10 balles à la seconde, on décapite un type toutes les 5 minutes, on décoche un coup de tatane dans un bide ou dans une tronche toutes les minutes, on explose un décor en plâtre toutes les demi-heures. Et quand je dis on explose, c’est on explose, on éclate, on pète, on fait tout sauter! Pour sûr que les artificiers sont à la fête sur un film comme celui-ci, et ce, dès l’entame. La scène d’ouverture est digne du final d’un James Bond ou je ne sais quel autre film d’action. Pendant une bonne vingtaine de minutes, Rambo, qui se prend parfois pour le Hannibal de l’Agence Tous Risque avec son barreau de chaise au coin du bec, Rambo et son équipe s’introduisent sur une base militaire viet. Avec leurs véhicules tunné à rendre malade de jalousie Mad Max, ils traversent le camp à vive allure, tirent sur tout ce qui bouge, butent tout ce qui porte un treillis, et quand les munitions leurs manquent, ils n’hésitent pas à se battre à poêle nue ! Rien de tel qu’un bon coup de poêle à frire dans la gueule pour avoir raison d’un adversaire! C’est malin. Ingénieux également, cette méthode particulièrement efficace pour dézinguer un hélicoptère à l’aide d’une motocyclette. C’est tout à fait possible. Il suffit de bien viser avant de lancer l’engin motorisé sur l’hélico!

Toute cette débauche d’énergie, toutes ces prises de risque pour libérer un milliardaire chinois retenu prisonnier. Mais oh surprise, lorsque Rambo et ses potes atteignent leur objectif, ils tombent nez à nez avec Conan Le Barbare. Arnold est prisonnier lui aussi. On est en train de le passer à tabac. Quitte à rendre service, Rambo libère aussi Terminator, qui saura être redevable un peu plus tard dans le film. Et oui, he’ll be back, le temps d’une scène un peu moins époustouflante, mais tout de même, bien musclées aussi, ou cette fois, on détruit un aéroport pour empêcher le vilain de l’histoire de charger son plutonium à bord d’un zinc. Ah, il faut le voir ce géant Arnold, coincé à la place passager d’une Smart dont il a défoncé la porte pour mieux respirer. Au volant de ce jouet, Bruce Willis, le commanditaire de l’opération en fera de même, histoire de conduire d’une main et de garder l’autre disponible pour appuyer sur la détente de sa mitraillette. Pour le coup, on est presque à la fin du film. Chuck Norris a eût le temps de briller. Non Chuck Norris n’est pas mort et le scénariste de Expendables2 insiste, recyclant une vieille van concernant l’acteur. Alors que Rambo est surpris de le revoir, Chuck annonce la couleur. Un jour un Cobra m’a mordu à la jambe. Cinq jours après, il est mort ...le cobra! C’est drôle.

D’une manière générale, le film, qui n’est pas non plus une comédie, sait garder du recul par rapport au genre. Il y a pas mal d’autodérision, une pointe de second degré bien agréable. N’empêche que le Porté Disparu du grand écran depuis 2005, ex leader du Delta Force reconverti un temps en Walker Texas Rangers, n’est plus qu’un bon sniper. Même si i ne lève plus la jambe très haute, il ne se déplace toutefois pas encore en déambulateur! Idem pour Arnold et Willis. Plus de corps à corps pour eux. Par contre Stallone a gardé la forme. Il est capable de rivaliser le temps d’un combat de vrai mec testostéroné avec Jean Claude Van Damme. Le belge aware est aussi présent au générique d’Expendables2. Ben on n’allait pas le snober. Notez qu’une armada de petits nouveaux ont également rejoint le casting. Parmi ceux et celles venu botter des fesses, la femme du film, Nan Yu et surtout Liam Hemsworth aperçu dans la franchise à succès Hunger Games.

Expendables2, un bon divertissement pour la rentrée, un film d’action dans la plus pure tradition, du bel ouvrage façon Simon West, réalisateur qui compte parmi ses faits d’armes, la mise en boîte de Lara Croft, l’adaptation du jeu Tomb Raider. Simon West reprend ici une casquette abandonnée par Stallone. Rocky n’est plus aujourd’hui que producteur, scénariste, et acteur. Il n’a pas souhaité réaliser ce 2ème volet des retraités, un tournage entaché de plusieurs décès. En effet, un cascadeur lors d’une scène de course poursuite maritime, à voir dans les fameuses 20 premières minutes, a perdu la vie. 22 000 chauves-souris ont également trouvées la mort à cause de la sur activité provoqué par l’équipe de ce tournage. Dérangées dans leur grotte bulgare, les copines de Batman n’ont pas résistées. Reste à espérer que vous, vous ne tomberez pas comme une mouche devant les exploits de nos papys de l’action movie, des papys pas encore prêt pour la maison de retraite puisque le volume 3 est déjà lancé.
ATMEN
Le bon mort,
dans le bon cercueil,
au bon endroit,
au bon moment.
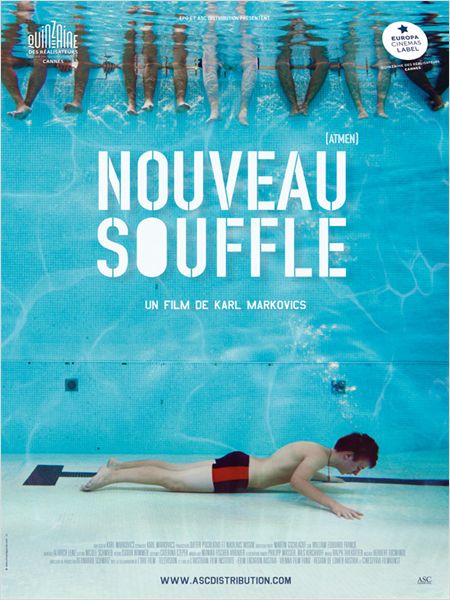
Atmen, c’est la comédie autrichienne de l’année, le camping de dubosc version maison d’arrêt pour jeune délinquant… Evidemment, je déconne. Vous le savez, en Autriche, on ne rit pas, jamais. Les exemples pullulent. Regardez Michael Haneke ? A-t-il déjà fait montre d’humour au moins une fois dans un film? A moins de trouver les plaisanteries de carabin des enfants futurs parents du nazisme du Ruban Blanc comiques, à moins de s’éclater devant La Pianiste qui se taillade ou à moins d’aimer se fendre la gueule devant un couple de vieux qui vit le parfait Amour mais file tout droit vers la mort, pas sûr qu’on se bidonne devant un film de Haneke! Pareil pour Markus Schleinzer et son pédophile de Micheal! Pour Ulrich Siedl, autre grand cinéaste autrichien, il faut mettre un bémol car le rire peut surgir n’importe où, n’importe quand. Il peut vous chopper à l’improviste ce rire jaune, mal saint, involontaire, mais un rire tout de même. La vision de son dernier film Paradies Lieber sur le tourisme sexuel en Afrique devrait vous convaincre. Fort de ça, vous comprendrez aisément que Karl Markovics, lui-aussi, n’est pas là pour déconner. Avec Atmen, on ne va pas être mort de rire même si la mort est le thème principal du film!

En partant d’une image, simple, une rêverie, Karl Markovics s’est lancé dans ce projet. Il visionne le corps d’une femme âgée étendue sur le sol de son salon. Autour d’elle, des employés de pompes funèbres s’agitent. Ils lèvent le corps, le nettoie délicatement, l’habille précautionneusement avant de le mettre dans la grosse boite en métal gris et froid, habitacle bas de gamme pour son ultime voyage. Après avoir imaginé des dizaines de versions de son scénario, Karl Markovics sent bien que de raconter une histoire aussi banale ne suffira pas à attirer le public. Alors il a l’idée de croiser le quotidien des employés de pompe funèbre avec celui d’un môme taciturne, avare de mot. Roman Kogler, du haut de ses 18 ans, a passé toute sa vie seul. Enfermé en maison de correction depuis ses 14 ans, après avoir tué un gamin de son âge, Roman attend une hypothétique libération conditionnelle. Pour cela, il doit à tout prix décrocher un boulot. Mais Roman, au grand désespoir de son éducateur, n’a pas le cœur à bosser. Bon gré mal gré, comme pour se foutre de la gueule du monde, Roman découpe une annonce dans le journal qui attire son attention. Une entreprise de pompe funèbre recherche de la main d’œuvre. Assez paradoxalement, c’est dans cet univers morbide, entouré de collègues hostiles que Roman va renaître.

Avec la rigueur qui caractérise le cinéma autrichien, Karl Markovics signe un premier film qui a les qualités de ses défauts. En effet, à force de soigner ses cadres, d’enchainer ses plans toujours fixes (sauf le dernier, un plan de grue pour une vue aérienne imprenable sur un cimetière alors que le héros prend enfin de la hauteur), Karl Markovics, sans s’en rendre compte, installe un filtre qui empêche toute transmission d’une quelconque émotion au spectateur. Jamais on ne ressent de l’empathie pour se pauvre petit homme solitaire. Ni empathie, ni sympathie, ni haine. Non. On s’en fout un peu de ce jeune mec qui tente de reprendre un nouveau souffle. Atmen est en plus plombé par quelques scènes métaphoriques assez lourdingues qui reviennent régulièrement, comme pour marquer l’évolution du héros. On voit souvent Roman plonger dans la piscine de la prison. Il fait mine de se noyer avant de systématiquement remonter à la surface. Dès le début, on sent de toute façon que les métaphores vont tourner à plein régime. Lors du générique, la caméra se pose au milieu d’une route déserte qui s’étire en ligne droite à l’infini. Roman marche seul.

Une voiture s’arrête. Il monte à l’intérieur. La voiture s’éloigne tranquillement. La route, à défaut d’être sinueuse, sera longue avant que Roman n’aperçoive la lumière. Tel est le message de ces premières images. Invités sur la banquette arrière, le spectateur se retrouve pris en stop également. Et nous voilà partie pour faire un bout de chemin avec Roman, le temps de savoir qui il est, d’où il vent et où il va comme ça. Sans doute qu’il ira loin dans le 7ème art. En effet, Thomas Schubert, acteur non professionnel recruté sur casting crève l’écran dans la défroque de Roman. Pour son dépucelage cinématographique, le jeune garçon donne tout le crédit nécessaire à son personnage. Sa prestation est assez stupéfiante. Il faut dire que pour l’aider, le scénariste réalisateur Karl Markovics a misé sur l’économie de dialogue. Roman ne parle pas, ou peu. Thomas Schubert parvient donc à exprimer toute une palette de sentiments simplement grâce à des regards, des attitudes, toujours juste.

Un bon acteur principal et une certaine maestria dans la mise en scène, tels sont les atouts de ce Atmen. En effet, quand il s’agit de montrer la rudesse de la vie quotidienne dans un centre de détention pour mineur, Karl Markovics opte pour un cinéma naturaliste. Il filme avec réalisme les fouilles au corps à chaque retour de permission, les tensions entre jeunes toute en retenue, les séances de natations, seuls moments ou les corps peuvent s’exprimer dans cet univers où la vie se cantonne dans une cellule de 4 m2. De la même manière, le cinéaste filme méthodiquement le quotidien des employés de pompes funèbres. On se croirait presque dans un documentaire. Karl Markovics ne succombe pas non plus à la tentation du happy end téléphoné et pas crédible. Il aurait pu, mais non! Cette fin pas très heureuse n’empêche cependant pas Roman de prendre un nouveau souffle, un peu à l’instar de Karl Markovics, ancien acteur qui réussit sa reconversion en réalisateur. En allant finalement droit au but, il signe Atmen un film peu ordinaire sur des gens ordinaires qui mènent des vies ordinaires. Prometteur!
The Cabin In The Wood
une cabane moins puante que celle au fond du jardin de Cabrel!

Tourné en 2009, annoncé en 2010, il déboule seulement maintenant au cinéma, la faute aux déboires financiers de la MGM, à l’agonie, qui a cherché longtemps avant de trouver un acquéreur canadien, en l’occurrence Lionsgate. Ceci dit, le premier long métrage de Drew Goddard sort du bois cette semaine et force est de constater que le garçon connaît ses classiques. Il revisite tout le bestiaire du film d’horreur pour faire rire un public d’avertis à défaut de lui flanquer la pétoche. Pire, les amateurs risquent fort de crier au scandale au moment de la conclusion. Oublions en effet cette fin débile avec Sigourney Weaver qui sort de nulle part pour nous balancer une explication sans queue ni tête sur le pourquoi du massacre. Massacre ? vous avez dit massacre ? il va donc y avoir des hectolitres d’hémoglobine qui vont couler dans cette cabane. Oui le sang va couler à flot. On va badigeonner des murs entiers. Bref, The Cabin in The Woods va prendre des allures de boucherie. Avant cela, il va falloir se fader un scénario qui alterne entre grosse fumisterie pataude et génie absolue. Déjà, vous prenez 5 jeunes adultes stéréotypés: une blonde décérébrée aux hormones en ébullition, une brune intello sainte ni touche vierge, un athlète qui fait flancher la blonde, un gentil garçon à lunette et un fumeur de cannabis. Vous les enfermez dans un camping-car pour qu’ils rejoignent une forêt isolée, avec son lac, sa cabane et forcément, ses zombies menaçant de série et vous obtenez The Cabin In The Woods.

Bravo pour l’originalité, de s’esbroufer le lecteur attentif. J’y viens. Là où le scénario vire au génial, c’est que tapis dans l’ombre, à l’abri dans un bunker, l’équipe de technicien du Truman Show cher à Jim Carrey orchestre le massacre des gamins et surveille l’évolution de l’équarrissage en direct sur leurs écrans. L’idée est de mettre en image un show de télé réalité dont les candidats ne savent pas qu’ils sont pris à ce piège. Ainsi, des scientifiques en blouse blanche emmenés par Richard Jenkins et Bradley Whitford géniaux de cynisme, prennent les paris pour savoir qui crèvera en premier et dans quelles conditions. Le souci, c’est que leur maitrise des fondamentaux va les conduire à commettre la boulette. En sous estimant ces nouveaux candidats, il se pourrait bien que la situation leur échappe. Si les âmes sensibles devraient aisément tomber dans les vapes au moment où des créatures visqueuses de toutes sortes, serpents géants, loups garous poilus aux dents de sabre et autres saloperie menaçantes seront libérées, les plus blasés auront déjà commencé à roupiller depuis longtemps. Bref, même si ça ne mérite pas un 10 sur 10, The Cabin in The Woods est quand même moins puant que la cabane au fond du jardin de Francis Cabrel.
To Rome With Love
La Dolce Vita
façon Woody Allen
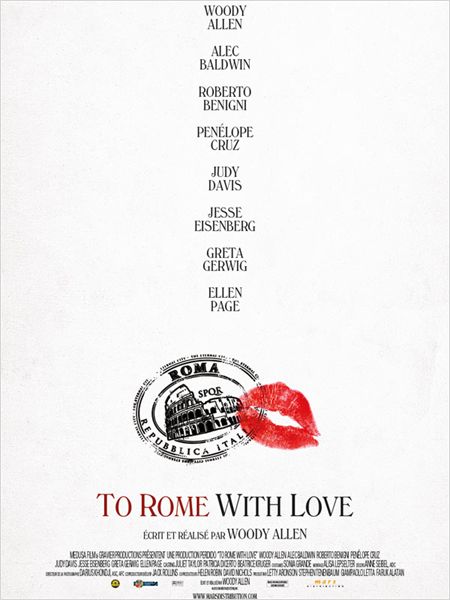
Après Barcelone et Paris, Woody Allen poursuit son tour d’Europe. En effet, To Rome With Love, son nouveau film, hommage à peine voilé à la comédie à l’italienne a pour cadre une capitale européenne. Avec To Rome With Love, Woody se prend pour Frederico plus que pour Dino. Même si dans To Rome With Love, un parfum de femme flotte dans l’air, l’absence d’aveugle fera dire que seul l’ombre de Rizi, le monstre, plane sur ce film. Mais plus que Dino Risi, c’est surtout la Dolce Vita de Frederico Felini qui semble avoir inspiré le New Yorkais Allen. Sont présents des paparazzis, mais pas que. Il y a aussi une prostituée, une star américaine en voyage à Rome, une fille innocente et pure qui pourrait être celle du restaurant de plage l’Acobaleno. Et puis il y a la structure même du film, sous forme de sketch pour mieux traquer les travers de la nature humaine.

En fait, pas comme dans Midnight In Paris qui s’ouvrait sur une série de clichés touristiques affreux, To Rome With Love débute au croisement de deux artère principales. Un policier assure la circulation et déclare posséder la place idéale pour tout voir et tout savoir de tout le monde dans cette ville. Et voilà comment on entre dans une histoire à tiroir ou l’on suivra plusieurs personnages qui n’ont rien à voir entre eux. Il y a tout d’abord une jeune touriste américaine qui tombe éperdument amoureuse d’un romain. Le couple veut se marier mais le courant passe moyennement bien entre le père névrosé joué par Woody Allen et son futur gendre trop communiste à son gout! Dans un hôtel, un autre couple de jeunes tourtereaux italiens venu tenter leur chance à la grand ville est en péril. Pendant que le marié essaye de se dépêtrer d’une situation complexe avec la call gril Pénélope Cruz qui s’est trompée de chambre et de client, sa femme, elle se perd pour de bon au bras d’un acteur vedette qui ne pense qu’à baiser cette naïve créature. Enfin, un troisième couple est en danger. Leur amour est mis à mal lorsque débarque Ellen Page, l’amie d’enfance de la fille. Elle séduit malgré elle tous les garçons. Le jeune homme promet à sa copine que lui, ne se laissera pas avoir.

Et les paparazzis dans tout ça, ils sont où, me direz-vous? Ils cavalent après Roberto Benigni. Ça aurait été un comble de tourner à Rome et de ne pas s’adjuger les services du comique italien. Ce père de famille, prévisible, réglé comme une horloge répète tous les jours les mêmes rituels. Un matin qu’il part travailler, une nuée de journalistes et paparazzi lui sautent dessus dans la rue. On le bouscule. On lui pose des questions. Il ne comprend pas. On l’emmène sur le plateau du journal télévisé. On lui demande ce qu’il a déjeuné le matin. Il répond : des tartines avec du beurre. On s’extasie de cette réponse… avec un peu de confiture précise-t-il. Immédiatement, dans les gazettes poeple, on s’interroge sur le parfum de la confiture. Bref, dès cet instant précis, ce quidam ne peut plus faire un mètre dans la rue sans être suivi, poursuivi, traqué par des caméras et des micros. Au bureau, cette nouvelle célébrité lui donne droit à quelques privilèges bien excitants. On fait des reportages sur lui. On tourne des images dans sa salle de bain, quand il se rase. Il a accès aux défiles de mode, dine avec les plus beaux mannequins. Bref, La célébrité a changé sa vie, ainsi que celle de sa femme, mais la célébrité en pareil cas est bien souvent éphémère et le revers de la médaille est bien plus amer à supporter qu’on ne peut l’imaginer. To Rome With love est une comédie parfois surréaliste, bourrée de surprises et de trouvailles ou des situations savoureuses s’enchainent sur un rythme d’enfer.
L'AGE DE GLACE
Génial et Drôle

Et de 4… L’Age de Glace 4: La Dérive des Continents, est sorti sur nos écrans. Non, ce sous-titre n’est en rien un présage de mauvais augure, la franchise étant loin de partir à la dérive. Avec l’arrivée de nouveaux personnages venus booster les vedettes déjà connues du public, le film s’offre même une nouvelle jeunesse. Mais gaffe, car il est vrai que le singe Pirate en chef, que les sirènes maléfiques, que la tigresse blanche et surtout que la mémé de Sid sans son dentier, qui enquiquine tout le monde, acariâtre presque aveugle et baveuse, éclipserait presque Manny le papa mammouth, Sid, le salle et stupide paresseux et Diego le Tigre. Par contre, personne ne fera jamais de l’ombre à Scrat. Lui et son gland ne risquent absolument rien. L’écureuil préhistorique reste le personnage préféré du public, à tel point d’ailleurs qu’il s’offre régulièrement des films courts en dehors de la série. Le dernier en date, génial au demeurant, hommage à The Artist, The Scratist a d’ailleurs fait office de bande annonce.
D’une manière générale, c’est par Scrat qu’arrivent les scènes les plus drôles. Le film commence d’ailleurs avec lui, Sur la glace, il cavale après sa noisette. Il l’attrape et veut la planter pour souffler un peu. Pas de bol. La glace se fend en deux. Un classique. Il rebouche vite le trou. La banquise se recolle. Un peu plus loin, il repère une mini cuvette, emplacement idéal pense-t-il. Avec toutes les précautions qu’on n’imagine même pas venant de lui, toute la délicatesse dont il peut faire preuve, au moment pile où il dépose la noisette sur le sol gelé, ce n’est plus la banquise qui se fend en 2, mais carrément la Terre qui s’ouvre. Il tombe dans une crevasse gigantesque, une chute sans fin jusqu’au noyau de notre planète. Après une course folle avec sa noisette sur ce noyau, Scrat sans le savoir, dessine la carte des continents plus ou moins telle qu’on la connait aujourd’hui. En surface, pendant ce temps-là, c’est la panique. On assiste à des glissements de terrain. Des icebergs gigantesques se créer et c’est justement dans ce contexte de création des plaques tectoniques par un rongeur insignifiant, que la horde de Manny va connaître quelques chamboulements. Manny, Sid et Diego vont être bloqué sur un iceberg, coupée de leur tribu et vont devoir affronter, pour retrouver la terre ferme, les éléments déchainés ainsi qu’un équipage digne de Pirate des Caraïbes. On ne le sait peut-être pas, mais à cette époque déjà, des bateaux pirates fendaient les eaux. Sauf qu’à l’Ere Glaciair, ces malandrins naviguaient sur des bateaux en iceberg ! Evidemment qu’on pense immédiatement à Jack Sparow, aux sirènes maléfiques puisqu’il y a une séquence avec elles comme dans le chant des sirènes du volume 4 de Pirates des Caraïbes. D’autres clins d’œil à des films célèbres ponctuent le film, comme Braveheart, avec Mel Gibson qui cherche à bouter hors de ses terres écossaises l’envahisseur anglais, sauf que dans L’Age de Glace 4, des marmottes se peinturlurent en bleu et partent à l’assaut de l’envahisseur.

Dans cette nouvelle grande et belle aventure, on retrouve surtout ce qui a fait le succès des 3 précédents épisodes: une histoire de famille avant tout avec Manny le père mammouth qui a bien de la peine avec sa fille Pèche devenue adolescente. Elle veut plus de liberté, batifoler avec des copines à sa guise, se faire un mec tellement cool. Son père lui, ne voit pas les choses sous cet angle et lui impose des règles strictes. Derrière le divertissement familial, faut-il y voir une petite leçon d’éducation? Certainement. Il faut faire confiances à ses enfants. Il faut aussi les laisser commettre leurs propres erreurs et savoir être là pour les rediriger lorsqu’ils ouvrent les yeux. Pêche va évidemment en faire une belle en oubliant son véritable ami au profit de ces nouveaux camarades superficiels. En dehors de ça, le film reste un hymne à la tolérance avec tous ces animaux de races différentes mais qui se serrent les coudes, les trompes, les griffes, pour aller de l’avant .

L’Age de Glace 4, une aventure drôle et rythmée, un épisode qui devrait cartonner encore plus que les précédents. A ce jour, la franchisse a rapporté 2 milliards de dollars, un succès qui est allé crescendo. M’est avis que cette nouvelle aventure va faire des étincelles au boxoffice mondial, une juste récompense pour le duo de réalisateur, Steve Martino, qui s’est fait remarquer avec Horton l’éléphant (excellent animé avec deux mondes parallèles) et Mike Thrumeier qui était directeur des animateurs sur ce même Horton mais aussi scénariste de l’Age de Glace 1 et réalisateur de 2 courts métrage sur Scrat.
7 JOURS A LA HAVANE
Long et chiant comme un doiscours de Fidel
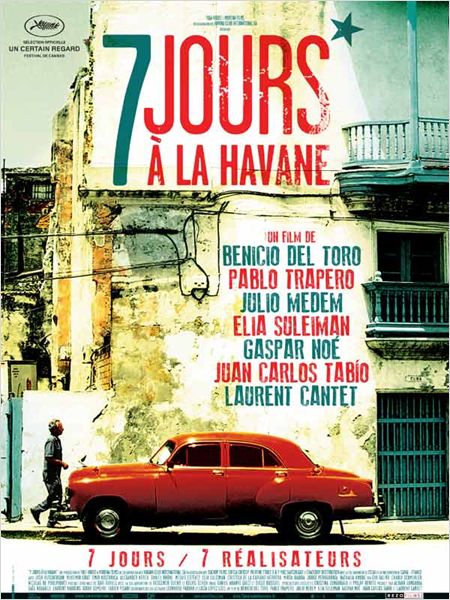
Ça sent les vacances, les envies d’ailleurs, de voyage et pourquoi pas, l’envie de se barrer en Amérique du Sud, histoire de passer 7 jours à la havane. C’est le titre de ce film de Bénicio Del Toro, Pablo Trapero, Elia Suleiman, Julio Medem, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabio et Laurent Cantet, un film collectif, sur le principe des Paris Je t’aime et New York I Love you. Oui, c’est exactement ça mais en plus chiant! Il faut imaginer 7 types qui ressassent dans chacune de leurs histoires, un cliché lié à Cuba. Si un producteur confiait demain à ces mêmes gars, 7 jours à la Brévine, pour sur que même là, ils reprendraient tous les clichés sur la Suisse, de la fondue aux banques en passant par le chocolat mais en oubliant l’absinthe et les Läckerli! En plus, ils prendraient leur temps pour raconter leurs histoires, 2h10 pour surpasser 7 jours à la havane, parce que 7 jours à la havane dure 2h09. C’est le temps de tirer sur un cubain de petit calibre un peu vanillé… En tout cas, 7 JOURS A LA HAVANE donne un film inégal composé de 7 courts métrages qui n'ont aucun lien entre eux si ce n'est qu'ils ont pour théâtre Cuba. Une seule fois, un personnage principal d'un des segments réapparait dans un autre, mais c’est tout. C’est ce qui est dommage parce qu'on aurait aimé voir Kusturica plus souvent. Il est formidable. Il apparait le mardi, On est dans le segment JAM SESSION. Il est invité à un festival de cinéma. Mais il est tellement bourré, donc naturel, qu’il est incapable de se fringuer. Il dégueule avant d’entrer en scène. Il fuit le diner officiel pour se rendre à une jam session. Il se met dans un état lamentable et il trouvera ce qu'il n'est pas forcement venu chercher, un ami trompettiste hors pair à qui il proposera du boulot pour son prochain film.

Avant le mardi, il y a le lundi, Benicio Del Toro ouvre donc la semaine avec un jeune touriste américain Teddy, en manque de sexe, guidé par Angelito un taxi ancien ingénieur également mécanicien. Il l'invite à manger chez sa tante. Mais il n’y a pas d'œuf, pas de bière et une fois le repas mitonné malgré tout avec des bananes fris, le touriste a casquette va faire la fine gueule. Plus tard, au cours de la tournée des bars, il va percer l’origine du terme Yuma avant de ramener à son hôtel une beau blonde. Ensuite entrera en piste le mardi Kusturica, et les jours vont défiler comme ça. Dès le mercredi, on commencera à regarder la montre. Le jeudi on reprendra un peu espoir. Elia Suleiman alpague la longueur interminable des discours de Fidel. Esthétiquement, THE DIARY OF A BIGINNER est sublime, tout en plan fixe avec pas mal de burlesque. Gaspard Noé, lui, reste fidèle à sa réputation signe un court sexuelo-bizarre ou comment des parents décident de désenvouter leur fille homo lors d'une cérémonie nocturne particulière. Samedi. On s’intéresse aux clandestins qui prennent la mer et dimanche, à l'importance de la religion.

Et la musique dans tout ça, me direz-vous… Ben c’est du heavy metal philippin…. Surprenant… Non je déconne! Evidemment, elle est cool et heureusement. Il manquerait plus que la bande son soit décevante. Elle sauve le film, que dis-je cette série d'image, de clichés sur un pays bouffé par l'embargo. 7 JOURS A LA HAVANE Un voyage touristique prévisible donc vite ennuyeux.
Le Dictateur
An Aladeen Movie!
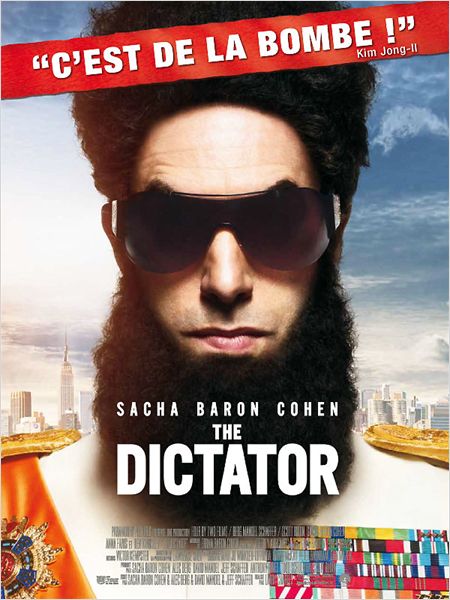
Après Borath et Bruno, voici le bictateur.. .euh, non, le dictateur barbu du Wadiya. Sacha Baron Cohen s’éclate dans ce nouveau film qui ne reprend plus les codes du documentaires mais plutôt ceux de la comédie romantique. Et oui, dans le corps d’un dictateur bat aussi un petit cœur fragile en mal d’amour et de sentiment. Pour tout dire, Le dictateur débute malgré tout comme un docu, le temps de résumer en quelques minutes le début de la vie jusqu’à sa majorité de Aladeen, le plus haut dignitaire du Wadiya. Né avec une barbe qui ne le quittera plus, Aladeen va faire de son pays le plus riche du Moyen Orient mais aussi le plus gênant pour les occidentaux. Même si Aladeen s’en fout, cet ami intime de Ben Laden n’est pas prêt de transformer sa dictature en démocratie, fusse-t-elle une démocratie moderne à la chinoise, un modèle du genre selon lui! Vous le devinez, les droits de l’homme, c’est son truc à Aladeen. Toutefois, son plus proche conseiller, son ami et second, va le trahir et tenter d’assoir sur le trône du Wadiya, une doublure du dictateur complètement conne, un être inculte, débile, facilement manipulable, une doublure qui devra signer la nouvelle constitution du Royaume, à New York devant les Nations Unies. Ce texte prévoit la proclamation de la démocratie. Mais Aladeen ne va pas se laisser faire.

Truffé de gags et de dialogues hilarants, Le Dictateur est un modèle de comédie. Sacha Barron Cohen et ses auteurs ne nous laissent aucune seconde de répit. Il n’y a pas de temps mort entre la première image, hommage à feu Kim Jong Il et la dernière ou Aladeen le musulman découvre le secret de sa promise. Aladeen a eut quelques bonnes idées de par le passé, comme celle de supprimer du dictionnaire les mots positifs et négatif pour les remplacer par Aladeen! Cela donne une scène hilarante aucours de laquelle un médecin annonce à son patient qu’il a une Aladeen nouvelle et une Aladeen nouvelle à lui dévoiler. Par laquelle on commence, demande le toubib. Par la Aladeen répond le patient. Très bien, alors vous êtes séro Aladeen.. le patient sourit puis fond en larme. Est-il séro positif ou pas ? il ne le saura jamais. Voilà juste un exemple du niveau des dialogues. Le film est ponctué de moult trouvailles de ce gout la.

Le dictateur, un pure moment de bonheur, de rire, un film irrévérencieux, vulgaire, scato qui plaira aux âmes misogynes, qui emballera ceux qui aiment entendre REM chanté en arabe, qui ravira ceux qui n’ont jamais vu un vagin filmé de l’intérieur… c’est fou la place qu’il y a la dedans. Notez que celles qui rêvent de voire Sacha Baron Cohen, la bite à l’air, s’exploser sur la vitre d’une fenêtre d’immeuble, face a une gonzesse qui se demande d’ou sort ce type ne seront pas déçues non plus ! Bref, LE DICTATEUR, du grand et bon n’importe quoi, l’une des meilleures comédies de l’année, un film à voir et sans attendre.
HASTA LA VISTA:
Intouchable 3!

Je ne sais pas si le succès d’Intouchable a contribué à lancer une nouvelle mode, mais force est de constater que désormais, certains producteurs n’hésitent plus à investir dans des films ou les personnages principaux sont atteint d’un handicap lourd, comme si un tabou, une barrière avait enfin été brisée. En effet, après le succès mondial de Intouchable, les flamand ont vu beaucoup plus grand et ont réalisé Intouchable3! Et oui, dans Hasta La Vista, vous aurez 3 handicapés pour le prix d’un : un tétraplégique, un cancéreux en phase terminale cloué dans son fauteuil et un bigleux aux portes de la cécité. Dénominateur commun, ils sont jeunes. Ils sont puceaux. Ils sont déterminés à se rouler dans la luxure avant le décès annoncé du cancéreux. Pour cela, ils vont prétexter auprès de leurs parents, de vouloir faire la route des vins entre

Certes quelques gags, notamment avec l’aveugle, sont assez bien vus, sans mauvais jeux de mot, mais on débusque assez vite les deux ou trois surprises que réservent le scénario comme par exemple la faille de la chauffeuse ou la barrière de la langue qui n’en est pas une entre ces flamands et wallons. On pourra reprocher aussi à Geoffrey Enthoven, ce coté roublard, pour ne pas dire un peu pute. Pour sur qu’il sait parfaitement s’y prendre pour vous arracher une couler de larme. Ceci dit, à la deuxième tentative de faire chialer la salle, ça ne prendra pas! N’empêche que si il est un reproche que l’on ne peut pas lui faire, c’est bien celui de taper juste. J’imagine que peu d’entres vous ont vu le documentaire Sexe, Amour et Handicap. Geoffrey Enthoven s’approche au plus près de ce qui est dévoilé dans ce film ou des handicapés lourdement atteint sont obligés de se payer les services de prostituées pour avoir leur dose de chaleur, de câlin, de caresse et de jouissance. Le sexe fait partie de la vie et il n’y a pas de raison, qu’au prétexte qu’ils soient cloués dans un fauteuil, ils ne puissent pas y avoir droit. Ceci dit, Ils et elles sont contraints à franchir le ligne de l’illégalité, pour assouvir un besoin naturel car peu d’hommes ou de femmes valides veulent coucher avec eux et assouvir leurs fantasmes. Si le documentaire relançait le début sur le légalisation de la prostitution ou tout du moins la reconnaissance dans de tel cas de la prostitution comme acte médicale, Hasta La Vista, lui, vise plutôt à raconter, sans trop romancer, la solitude, la gêne, la tristesse, la colère aussi qui frappe les malades en manque de sexe...

Il se dit que le film n’est pas inspiré de ce documentaire mais plutôt d’une histoire véridique, celle de Asta Philpot, un citoyen américain né avec une maladie congénitale : l'arthrogrypose, une maladie handicapante, irréversible, évolutive qui contracture progressivement les articulations. Après avoir entendu parler d'une maison close munie d'un accès pour fauteuil roulant en Espagne, il a visité l'endroit et y a perdu sa virginité. Bouleversé par l'expérience, il a décidé d'organiser des voyages avec d'autres personnes éprouvant les mêmes difficultés pour trouver une relation amoureuse ou sexuelle en raison de leur handicap physique. Il a également fondé "L'Asta Philpot Fondation" qui prône le droit à une vie sexuelle active pour les personnes handicapées. Hasta la vista de Geoffrey Enthoven, un film sur l'amour, l'amitié inconditionnelle et la frustration de ne pas pouvoir jouir de son corps à cause d’un handicap. Le corps, autant que l’esprit, a besoin de tendresse, d'affection, de détente et de passion. Pour les valides, c'est évident, mais pour les handicapés physiques, il faut et il faudra encore bien des films comme Hasta La vista pour que cela devienne une évidence pour le commun des mortels.
ADIEU BERTHE:
un enterrement réjouissant

Mémé is Dead.. .C’est avec ces quelques mots que s’ouvre ADIEU BERTHE. Mémé is dead, Berthe n’est plus. Pour résumer, un pharmacien quadra, magicien secret, en phase de rupture lente avec sa femme, apprend la mort de son ailleul. Pauvre Armand qui s’en trouve tout chamboulé même s’il avait quelque peu oublié sa grand-mère. Il faut dire que cette femme avait tendance à se fondre dans la masse, à passer inaperçu. Elle avait cette faculté à se faire oublier, alors forcément, qu’Armand a fini lui aussi par oublier de rendre visite à sa mémé. Toujours est-il qu’il va falloir trouver le bon cercueil, peut-être sur internet, sur le site Dead-line.fr. A moins qu’une séance holographique dans un magasin de pompes funèbres high-tech ne soit plus efficace. La formule Toille-lette, la disparition comme un coucher de soleil, qui est une promesse de lendemain et ne tue pas l’espérance pourra peut-être faire l’affaire. Le cercueil verticale, ou celui en forme d’œuf dessiné par Starkwell seront sans doute la dernière demeure de Berthe la plus confortable.

Finalement, l’organisation de cet enterrement sera une occasion de savoir enfin qui était réellement cette mémé Berthe que Armand pensait connaître. Avec sa maitresse, un brin dingo, Valérie Lemercier, il va passer une nuit dans la maison de retraite, dans la chambre de mémé. Ce temple bourrée de bibelots précieux, avec son vieux tourne-disque sur lequel passait Comme un p'tit coquelicot, la chanson de Mouloudji, cette caverne avec sa mystérieuse malle des Indes posée par terre, et au mur ces deux posters : Le Roman d'un tricheur, de Sacha Guitry et Monsieur Kiff le magicien, renforcent d’avantage le mystère. Certes, ce n’est pas celui de la chambre jaune. L’histoire plus intime qui se cache dans cette chambre de Berthe, plus romanesque à n'en pas douter, attise néanmoins la curiosité d'Alix et d'Armand. Ils fouinent, ils cherchent les signes qui leur permettraient d’accéder au secret de Berthe et c’est finalement un paquet de lettres, une correspondance entretenue avant son mariage avec le magicien de l'affiche, Monsieur Kiff, qui dévoilera la personnalité de Berthe.

ADIEU BERTHE, une comédie savoureuse basé sur le dialogue et dans lequel on ne joue pas le gag pour le gag, même si le burlesque n’est jamais très loin. Le rythme n’est pas celui de la comédie hystérique. Au contraire, ici, on prend le temps de vivre, ou plutôt le temps d’enterrer mémé. On prend le temps de s’interroger sur le vrai sens du mot ‘vouloir’. Et oui, chez les Podalydès, on aime à philosopher en se marrant. Dans ce film, le réalisateur Bruno Podalydès renoue avec ses acteurs fétiches: Isabelle Candelier, Michel Vuillermoz, Jean-Noël Brouté présents depuis ses débuts dans tous ses films. Il élargit sa famille de comédiens en invitant Valérie Lemercier qui se fond dans le décors et trouve sa place dans cette troupe bigarrée.

Il collabore également de nouveau avec Pierre Arditi après Bancs Publics en 2008. Au passage, après Banc Public, ce film choral, Podalydès resserre le nombre de personnage et l’intrigue ce qui n’est pas plus mal. Cela lui permet de mettre en image une comédie magique, l’un de ses meilleurs films qui fonctionne en plus sur une idée extrêmement forte. En s'aventurant sur un terrain a priori refroidissant- le monde des obsèques et le commerce qui va avec, il a su tirer le meilleur et réaliser un film à l’atmosphère très singulière.
JOURNAL DE FRANCE
Le Canard Déchainé

Quiconque n’a jamais entendu parlé de sa vie de Raymond Depardon sera bien avisé de filer découvrir au cinéma Journal de France, un documentaire impeccable que l’on pourrait sous titrer Depardon pour les Nuls. En effet, le film reprend des images d’archives puisées dans le trésor du reporter photographe cinéaste. Ce montage en bout à bout, éclairé par la voix de Claudine Nougaret, sa plus fidèle collaboratrice, ingénieur du son sur tous ses films, permet de mieux saisir l’esprit de liberté qui a toujours animé cet homme. Ces archives à la valeur inestimable sont entrecoupées d’autres séquences montrant Depardon en plain travail, alors qu’il est parti dans sa fourgonnette photographier la France. Comme il le dit « je connais mieux Djibouti que la Meuse ». Il était donc temps de partir pour un voyage de 6 ans, le temps suffisant pour sillonner les campagnes, les villes et les villages, à la recherche du cliché, celui qui ne sera pas parasité par une lumière trop belle, trompeuse, celui qui pourra être immortalisé une fois que les autos et les passants auront passés leur chemin. Le film débute justement par là. Plan fixe, on découvre un quartier discret de la ville de Nevers. Raymond Depardon attend depuis des heures de pouvoir photographier ces bouts de trottoirs et cette devanture d’un tabac restée ancrée dans les années 60. Seulement, à cette intersection pourtant paisible, à chaque fois qu’il essaye de déclencher sa photo, la circulation pas très dense ou un Neversois passe dans le champ de son appareil à chambre. Raymond Depardon a choisi de photographier la France avec cet appareil dont il nous donnera plus tard un petit cours d’initiation. Ce qu’il faut retenir, c’est que la qualité des clichés est sans égale. Mais surtout, elle nécessite un temps d’attente de 1 seconde, équivalent à celui de l’ouverture de son objectif. « Mon travail serait tellement plus facile si la France était déserte ! » dira Depardon plus tard alors qu’il photographie une devanture d’un resto grill à l’abandon où les pancartes ‘ouvert’ ont été oubliées.

Ce début intrigant, plein d’humour, ne va pas sans rappeler l’expérience que nous avons tous et toutes faite, vouloir photographier un paysage, naturel ou urbain, vierge de toute présence humaine, en vain. Seulement, ce qui nous différencie de Depardon, c’est l’œil du maître, le regard qu’il a su poser sur le monde depuis les années 60. Depardon commence par faire des images de Paris en 1962. Caméra en main, il filme des gens, des visages tout en se déplaçant à pied dans les rues de la capitale. A cette époque, tout est prétexte à capturer des images en mouvement. Le moindre voyage comme celui de Caracas en 63, alors que le Venezuela est en pleine guerre civile, lui permet d’affiner sa technique. Alors que ses comparses ont fuit le pays devant la violence des combats, lui, est resté et a filmé. Il a ramené des images inouïes, un témoignage unique.

En 66, il est en République Centrafricaine. Le pays fête son indépendance en ce 1er décembre 66, jour où le futur dictateur cannibale Boccassa prend le pouvoir. Depardon continue de s'entraîner à filmer en marchant, remontant le courant au milieu des foules. Il tourne des plans inutiles. Il cherche encore sa méthode basée sur l'écoute et le regard. La Cisjordanie en 67, Duvalier en Haiti, Saada au Yémen, le conflit du Biafra en 68 avec ses mercenaires sont autant de segments de films écartés à l’époque, aujourd’hui choisis pour composer ce nouveau film. C’est curieux d’ailleurs, comme on peut à un instant T repousser des images jugées mauvaises, ou inutiles, et les ressortir pour refaire un film bien des années plus tard. Tout est question de regard. Sans doute celui-ci évolue-t-il avec le temps, en fonction de celui ou celle qui regarde les images. Car, et c’est là aussi l’intérêt de ce Journal de France, c’est Claudine qui les a chois. C’est à elle qu’est revenue la tâche lourde de sélectionner ce matériel. Depardon lui a fait entièrement confiance. Si il avait dû faire ce travail lui-même, sans doute les aurait-il encore écartées. Pour le coup, Raymond Depardon a laissé toute liberté à sa collaboratrice et amie. La liberté, c’est ce qui a toujours animé ce type, un artiste, un homme libre comme l’air, insaisissable. Il le dit. « Parfois, on m’appelle. On me demande où je suis et je réponds, je ne sais pas… Tu reviens quand ? Je ne sais pas ? Tu fais quoi ? Je prend des photos. Je suis dans ma fourgonnette, quelque part en France. Je suis en orbite ! » C’est ça, il est un satellite qui gravite au gré de ses envies autour de notre monde et photographie, filme des images clandestines en 69 à Prague, après le printemps pendant l’occupation Russe, ce qui lui vaudra 3 jours de prisons et un retour en France. En 74, Raymond Depardon est le premier à s’approcher au plus près d’un homme politique en pleine campagne électorale présidentielle. Giscard d’Estaing l’autorise a tout filmer. Le métrage, achevé au lendemain de l’élection de Giscard intitulé Partie de Campagne sera bloqué par le président Français au motif qu’une image le dérangeait. Giscard a insisté pour que Depardon revoit son montage. Pas question. Le film ne sortira en salle qu’en 2002 !

Comme pour se venger de cette trahison de Giscard, Depardon va filer, sans rien dire à personne au Tchad en 76. Françoise Claustre, une ressortissante française est retenue prisonnière par des rebelles. Ils veulent monnayer sa libération. Pendant 2 ans, il va rester avec ces rebelles et finir par décrocher une interview de l’otage. De retour en France, ces images sont diffusées à la TV française. Giscard, furieux, fait effacer des archives cette séquence du TJ et fait en sorte que le reporter soit condamné pour non assistance à personne en danger à l’étranger. Depardon s’en fout, il a accompli ce qu’il pensait devoir accomplir : aller à la rencontre d’une femme, et des hommes qui retenaient cette femme, l’écouter parler, la regarder, les regarder pour que nous ensuite, nous puissions les regarder.

Lorsqu’il se rend en Italie peu de temps après et filme pendant 4 ans dans les hôpitaux psychiatriques italiens la détresse humaine, c’est ce même désir qui l’anime : que le monde voit ce qu’il voit, des hommes parqués et laissés à l’abandon dans des bâtiments de bétons désertés par le corps médical. Evidemment, Journal de France continue encore. Le film s’arrête avec des extraits inédits là encore du dernier métrage de Depardon. Journal de France, un film important, objet de cinéma somptueux, envoûtant qui montre ce qui signifie avoir un regard et l’importance de celui ci.
SALMON FISHING IN THE YEMEN:
Pas une pêche miraculeuse

Salmon Fishing in the Yémen, traduit par Des Saumons dans le Désert, un film de Lasse Halströem et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa partie de pêche n’a rien de miraculeuse. Il met pourtant en scène un amateur de pêche au gros, Ewan McGregor… Se souvenir de sa prestation dans Big Fish de Tim Burton. A ses côtés, on retrouve Emily Blunt et Kristin Scott Thomas, Kristin qui sauve l’ensemble du naufrage définitif. Chacune de ses apparitions est synonyme de séquence drôle, bien rythmée, bien dialoguée, un brin cynique mais délicieusement jouissive. Elle incarne une conseillère en communication du premier ministre anglais, parfois tyrannique avec les journalistes.

Au début du film, on apprend qu’un attentat vient d’être commis en Afghanistan. Mais l'Angleterre doit mettre en avant une belle histoire pour faire diversion. La conseillère en com’ charge son équipe de débusquer ce beau scénario qui détournera les tabloïds du bourbier afghan. Et voilà comment elle envoie un texto à son premier ministre pour savoir s’il aime la pêche, et pas seulement la pêche aux voix? Oui, répond-il, et ça tombe bien, car l’histoire en question est celle d’un projet jugé insensé par le docteur Jones, éminent spécialiste en poissons. Il est incarné par Ewan McGregor. Un Cheik yéménite, plein aux as, féru de pêche au saumon, s’est mis en tête de détourner une rivière, de construire un barrage avec une réserve d’eau immense et d’y implanter 10 000 saumons prélevés dans les rivière anglaises pour pratiquer son activité préférée chez lui, au Yémen, dans un désert. Evidemment, le docteur Jones est contre cette idée. Ce projet dingue nécessite des moyens colossaux. Très vite, il se rend compte que l’argent n’est pas un problème, et finalement, ce défi le titille quelque peu. A moins que ce ne soit l’assistante du Cheik qui le titille un petit peu... Et voilà que Lass Halstroem se perd ! Le cinéaste dérive vers la comédie romantique au lieu de focaliser sur cette affaire de saumons qui passionne l’Angleterre, au lieu de montrer la panique en haut lieu parce qu’on a oublié que les 2 millions de pêcheurs anglais risquent d'être très en colères à cause de ce projet fou, au lieu de privilégier le fond politique yéménite. C’est vrai que les yéménites reprochent à leur Cheik d'avoir offensé Dieu en détournant le cours naturel de l'eau dans son désert sous prétexte d’amener un peu de progrès à son peuple. Finalement, Le cheik est le vrai saumon du film. Il remonte le courant et va à l'encontre des résistances. MacGregor aussi, résiste au début, et fini par suivre ce cheik et remonter le courant de cette rivière pleine de pièges. Mais ce bon docteur Jones en pince pour l'assistante du Cheik. On débusque d’ailleurs dès le début du film qu’ils vont finir ensemble. Chacun dans son couple a des soucis. Lui se fait plaquer par sa femme et elle, a un mec disparu mais pas forcément décédé en Afghanistan. Leur coup de foudre et leur union semble inévitable. DES SAUMONS DANS LE DESERT, une comédie romantique à peine voilée avec Happy end de série. Halstroem n'arrive pas à noyer le poisson sur ce coup et c’est bien ballot.
SNOW WHITE:
c'est pas elle la plus belle!

La guerre des Blanches Neiges aura bien lieu. Souvenez-vous, le mois dernier Lilly Collins incarnait la préférée des nains dans une version pop colorée, tendance un peu kitch du compte des Frères Grimm, une version destinée aux enfants et plutôt rigolote avec Julia Roberts dans le rôle de la vilaine et méchante reine. Cette semaine, c’est au tour de Charlize Theron d’endosser la panoplie de cette femme manipulatrice qui ne jure que par la beauté et la jeunesse éternelle. Oui Charlize Theron n’utilise pas de crème anti-rides mais opte pour une méthode bien plus radicale. Elle aspire le souffle et l’âme de ses jeunes victimes pour s’accaparer leur jeunesse. L’aspirateur Charlize Dyson… euh, Theron, pardon, apparaît comme une reine des pommes terrible dans cette version nouvelle qui lorgne sur l’héroïc fantaisy et met en scène également la star de la saga Twilight, une certaine Kristen Stewart. La jeune femme, qui se prend vaguement pour Jeanne d’Arc, cavalière émérite, adepte du tir à l’arc et de la fauconnerie dans cette vraie connerie est accompagnée pour l’occasion du gros balaise Thor, plus connu sous le nom de Chris Hemsworth. Il est ici le chasseur, celui qui traque Blanche Neige dans la forêt maudite, avant d’en faire son allié, puis peut-être son amoureuse. Va savoir…

Evidemment, vous vous demandez certainement pourquoi remettre au goût du jour Blanche Neige ? Que se passe-t-il ? Les scénaristes hollywoodiens seraient-ils en panne sèche ? Oui, certainement… Après tout, à quoi bon s’enquiquiner à créer un nouvel environnement, de nouveaux personnages quand les Frères Grimm l’ont fait avant vous, en 1812 ! Notez au passage que de relooker ce compte désuet pour en faire une aventure d'héroïc fantaisy est plutôt une bonne idée. Pourquoi pas. On joue sur les différents univers avec pas mal de réussite. Les effets spéciaux sont à la hauteur des attentes. Même si ce film ressasse uniquement des scènes, des images déjà vues moult fois avant, même si il n’y a plus rien à inventer dans la mise en scène des combats, même si ces soldats en paille de fer n’ont plus rien d’original, même si le miroir, ce beau miroir, se dématérialise et devient une flaque d’or avant de se re-matérialiser en homme avec une grosse voix bien ridicule, force est de constater que ce film n’est ni complètement déplaisant, ni complètement plaisant. Disons qu’on passe à coté d’une bonne idée. Une brèche dans le scénario aurait mérité d’être largement exploitée mais elle ne l’est malheureusement pas.

On aurait ainsi pu ouvrir le film sur autre chose, de plus psychologique, de moins spectaculaire. Privilégier le trouble des personnages au lieu de miser sur les affrontements à tout prix aurait sans aucun doute possible rehaussé le niveau. Typiquement, lorsque la reine parle à son miroir, on se demande si elle n’est pas la proie d’hallucinations car son frère, amoureux d’elle, autre faille non exploitée, ce frère donc qui l’observe depuis l’encablure d’une porte, ne voit pas ce qu’elle le voit. C’est intriguant, mais pas développé ici. Idem quand Blanche Neige s’enfonce dans la forêt maudite. A-t-elle des hallucinations ou est-ce que la terre lâche des pets malodorants pour de vrai? Est-ce que les racines se transforment en serpents ? Est-ce que de vilaines bestioles grouillantes lui foncent réellement dessus. Et cette notion d’hallucination se pose encore dans le sanctuaire, la reposante clairière qui abrite les fées avec ces champignons cyclope, ces Golum miniatures, son majestueux cerf blanc, sa tortue en mousse verdoyante…etc… Blanche Neige et ses amis hallucinent-ils ou pas?

En tout cas, il faut bien admettre que les décors sont peut-être ce qu’il y a de plus intéressant dans ce BLANCHE NEIGE ET LE CHASSEUR. Entre ceux du Parc de Windsor et ceux construits dans le studio du Hobbit, à Pinewood, pas moins de 23 sets ont été bâti et utilisés pour ce film qui repose sur un scénario aussi réfléchi et fin qu’un troll affamé, porté par des acteurs pas toujours convaincants… la guerre des Blanches Neiges est donc terminée avant d’avoir commencé. Universal Picture a été mis chaos par l’outsider Relativity Média !
BEST EXOTIC
MARIGOLD HOTEL
Et Si On Vivait Tous Ensemble En Inde

Adapté de Ces Petites Choses, un roman à succès mitigé de Deborah Moggach, the Best Exotic Marigold Hotel ressemble à s’y méprendre à un film français sorti au début de cette année : En Si On Vivait Tous Ensemble (en Inde). C’est exactement ça. Prenez une poignée de seniors encore frais et dynamiques, parés à croquer leur fin de vie par les deux bouts, loin d’un mouroir déprimant et vous obtenez un métrage qui se laisse regarder, sans plus. Le film s’ouvre sur une série de petits clips, sorte de tranches de vie pour présenter en accélérer chacun des protagonistes anglais de cette histoire. On fait donc connaissance avec une veuve triste, une célibataire peureuse, une raciste qui doit se faire opérer de la hanche, un juge qui veut tout plaquer, un autre célibataire encore suffisamment vigoureux pour donner de la joie aux dames, un couple fraîchement retraité de la fonction publique et dont la femme autoritaire prend un malin plaisir à châtrer son homme. Tous n’ont qu’une idée en tête: profiter du mieux possible des quelques années qui les séparent de la mort. Et voilà comment après avoir tout plaqué, ils s’envolent tous à bord du même avion en partance pour l’Inde. Seulement, à peine arrivée à l’aéroport que les ennuis commencent. Leurs valises ont été égarées. Cette tendance est très à la mode en ce moment dans les films. Après le fils de Bruce Willis qui débarque en Espagne sans ses bagages restés aux States dans Sans Issue, voici nos petits vieux désespérés à la descente d’avion. Qu’à cela ne tienne, un tour de puk-puk plus loin, ils vont enfin s’installer dans l’endroit de leur rêve, le Best Exotic Marigold Hotel, un lieu qui n’a de best, d’exotic, de Marigold et d’hôtel que le nom! La réalité les rattrape subitement. Le rêve vrille en un éclair au cauchemar et ce, malgré la sympathie, la bonhommie et l’optimisme du tenancier, en réalité Dev Patel, le fameux Dev Patel. Souvenez-vous de ce jeune garçon qui avait raflé la mise dans Slumdog Millionaire! C’était lui, Dev Patel. Et bien il n’a rien trouvé de mieux que de reprendre cet hôtel foireux, un héritage familial qui tombe en décrépitude. Avec un bon site internet, quelques retouches sur photoshop, voilà comment ce jeune margoulin est parvenu à attirer dans ses filets les sexagénaires britons. Ici, le téléphone marche quand il y pense, les robinets ne fuient pas puisque l’eau courante n’est pas installée à tous les étages. Quant à la poussière, elle est votre meilleure amie. Mais qu’importe, ce rêveur en est convaincu, avec de l’huile de coude, et accessoirement, un coup de pouce financier du destin, son hôtel sera le plus agréable, le plus beau, bref, le best exotic de la région. Et tant pis si pour l’instant sa maman autoritaire n’est pas convaincu.

Bienvenu au pays du curry. Comme dans tous les pays, on s’amuse, on pleure, on rit, il y a les méchants et les gentils. Oui, le scénario n’est pas plus épicé qu’un épisode de Candy! Je dirais même mieux qu’il est d’une fadeur absolue. Le film repose sur un credo, un seul : qui cherche trouve. En effet, tous les personnages venus chercher quelque chose dans cet hôtel vont forcément le trouver: une âme sœur, du cœur, une hanche, des yeux qui s’ouvrent, du sexe, de l’amour, un travail… Seulement, ils devront tous et toutes faire très attention car rien ne prépare a la profusion d'odeurs et de couleurs, au bruit des Klaxons, au fourmillement de la foule. Le choc des cultures, soit on y fait face, soit on jette l’éponge. Au terme des 51 jours racontés par Judi Dench dans son journal de bord, sans doute que « Tout ira bien à la fin et si tout ne va pas bien. c'est que ce n’est pas la fin ». Telle est la philosophie du propriétaire du Marigold. A signaler la présence au générique de, outre Judi Dench une amie du réalisateur John Madden, un certain Tom Wilkinson rescapé de L’Affaire Rachelle Singer, précédent métrage de Madden, et surtout de Bill Nighy, déjà vu dans un hôtel autrement plus loufoque et sympathique que ce Marigold: l’hôtel Paradiso installé au bord d’un lac radioactif avec Gino Bolognèse et Gina Carbonara les clients, avec Eddie et Rithci les tenanciers déglingués qui se mettaient sur la gueule à coup d’extincteur…. Hôtel Paradiso, un film tellement plus drôle que ce Best Exotic Marigold Hotel.
MARGIN CALL
L'anti Wall Street de Stone

Margin Call remonte à la source de la crise, pas celle de 29, mais belle et bien celle de 2007. Vous vous souvenez de Maddof, les subprime… hein, la banque Lehmann Brothers…Nous y voilà sauf que dans MARGIN CALL cette banque là a un autre nom. Mais c’est bel et bien cette journée là qui nous raconté, la veille du scandale, la veille du jour ou tout a commencé. Le film dure 24h. L’entrée en matière est sobre et presque mystérieuse. On assiste à un étrange balais. Dans une salle des marchés, au cœur du système, des employés sont convoqués les uns après les autres par une équipe de tueuse qui ne sont pas là pour négocier, tout juste pour achever ces messieurs bien tranquilles en leur signifiant leur licenciement. Circulez, y a plus rien à voir car vous n’avez pas fait assez de fric. Voilà ce qu’on leur reproche. Alors les plus mauvais ont 1h pour rassembler leurs affaires dans un petit carton. On leur dit de ne pas oublier, une fois à la maison, de compulser la brochure: le chômage pour les nuls, un feuillet qui les aidera à rebondir en leur donnant quelques combines… Même pas une tape dans le dos, plutôt un gros coup de pieds au cul et le privilège de l’ancienneté ne joue même pas en pareil cas. Après 19 ans de bons et loyaux service, un manager de l’établissement est viré comme une crotte. Et il perd tout dans la minute : je parle pas uniquement de son accès web, de son accès au bâtiment, mais surtout de son assurance maladie. Dès qu’il a posé un pieds sur le trottoir, son téléphone portable est désactivé… grossière erreur… on désactive pas le portable d’un ancien cadre expérimenté… non… Comment fera-t-on quand on sera vraiment dans la merde et qu’on n’aura pas d’autres choix que de le re-contacter pour bénéficier de son expertise sur un dossier brûlant, le genre de patate chaude dont Wall Street n’apprécie que très modérément le goût….On ne pourra pas. On perdra du temps donc de l’argent, beaucoup d’argent. Et ça ne loupe pas. A peine viré la cadre chevronné, qu’un jeune débutant reprend les dossiers en cours et s’aperçoit que la formule utilisée comme modèle pour octroyer les près est fausse. Pour l’instant, personne n'a rien à part le licencié et ce nouveau, en fait un ingénieur en fusée reconverti dans la gestion et le calcul des risques de sa banque. Il teste des modèles et donc découvre un gros loup. Ses calculs sont clairs, sûrs, certains. Y a pas l’ombre d’un doute, la banque va droit dans le mur, les actionnaires et leur dividende avec. Immédiatement, c’est le branle-bas de combat au plus haut niveau de la banque. Au dernier étage, chacune des têtes pensantes cherche à couvrir ses arrière. Pourtant on le sait, y aura un fusible… mais qui ? Qui va sauter? Qui et combien…. Ce sont les deux questions…. Non pas Combien est-ce que l’on va perdre, mais combien est-ce que l’on va sauver dans ces perte astronomiques annoncée et surtout comment faire pour minimiser au maximum les pertes: tricher, être malin, margoulin aussi en vendant le plus vite possible à la concurrence ces subprimes pourries quitte à exploser le marcher et couler un max de monde pour se sortir de cette panade. Finalement, la morale est limpide : à Wall Street, y a pas de morale… il n’y a que du fric, du fric a faire à tout prix.

Margin Call a obtenu le prix du polar 2012 au festival du polar de Beaune cet année alors que c’est tout sauf un polar… c’est une des raison qui explique que le polar à Beaune, c’est fini. Ce sera à Lyon l’an prochain visiblement…. Margin Call, c’est plutôt un thriller d’inaction sur des actions en bourse qui dégringolent, des titres qu’on doit vendre en 24h chrono, un film palpitant sans jack Baeur mais avec d’autres vedettes de la télé, comme Simon Baker rescapé de la série the mentalist ou encore de Zachary Quinto vu lui dans Heroes…MARGIN CALL, un premier long métrage emballé dans une réalisation assez froide, lente, pas tape a l'œil. C’est l’anti Wall Street de Oliver Stone, une sobriété qui colle parfaitement a l'ambiance feutrée de ces bureaux ou l’on décide de mettre dans la merde des millions de gens pour sauver la banque, sauver les plus riches. Et les nantis de se rassurer, mais enfin voyons… C’est que de l'argent, du papier avec des images imprimé dessus. On ne fait rien de mal pense le grand patron. Il le pense sincèrement. Ce type est bourré de cynisme, de réalisme surtout. Il le dit : On a toujours fait ça du fric sur le dos des pauvres. Pourquoi ça changerait ? Ici, c’est l’humain qui prime dans MARGIN CALL, qui subprime. La preuve avec Kevin Spacey qul incarne un chef d’équipe. Il sait qu’il va y avoir des dégâts amis son bataillon de trader. Mais il se tait et parvient à motiver tout le monde. Etre humain selon le réalisateur JC Chandor, c’est faire le job, exécuter les ordres du big boss et pis c’est tout. C’est vrai que le rapport humain entre ces têtes pensantes est intéressant, bien disséqué. Les rapports de force, les tentatives de manœuvres, d’anticipation, et les moments de dépit, tardif, lorsque l’on ouvre enfin les yeux sont bien croqué dans ce thriller financier humaniste.
SANS ISSUE
Courage,
fuyez cette daube!
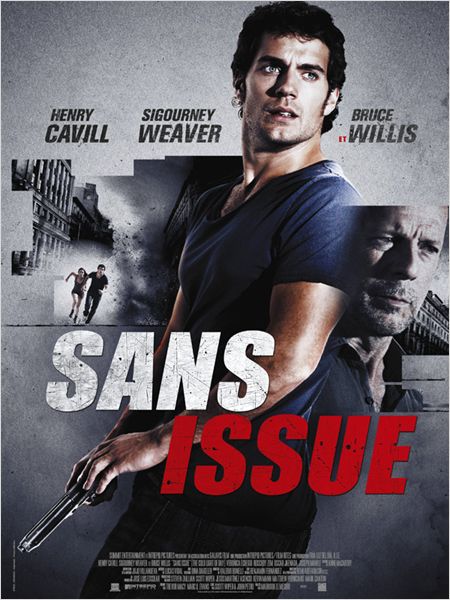
Si vous aimé les films d’action raté, voici SANS ISSUE de Mabrouk El Mehcri…. Grosse déception de la part de ce réalisateur qui nous avait emballé avec JCVD qui mettait en scène Van Dam dans son propre rôle et pris en otage dans une poste belge. Il a réalisé ensuite MAISON CLOSE, une cération orginale de Canal+ super bien sur l’univers des bordels à la fin du 19ème siècle. Là, il a du accepter une commande, vouloir dépanner un pote. Je ne sais pas. Toujours est-il qu’il est le réalisateur de ce gros poireau intitulé SANS ISSUE, un film qui débute sur un gros plan, celui du cul d'un avion qui se pose sur une piste d’atterrissage. Gros plan encore sur la nuque d'un passager qui apprend que ces valises sont restées aux USA. Bienvenu en Espagne. Le jeune homme est venu passer quelques jours de vacances sur le yacht de papa et maman avec sa sœurette qui devrait aussi les rejoindre. A peine posé un pied sur le voilier que l’on sent comme qui dirait une légère tension. Papa et le fiston sont en froid pendant que maman sauve les apparences. Pour ne rien arranger, le garçon apprend que sa société est aux porte du dépôt de bilan. Au cours du repas, c’est la crise de nerf. Du coup, le lendemain, après une partie de pêche qui tourne court, il saute à la baille, rejoint la côte pour aller faire des commissions. Seulement, quand il revient sur la plage, le bateau de ses parents qui mouillait au loin a disparu. Je vous rassure, il va le retrouver, mais vide…. Papa Bruce, Maman Willis, la sœurette et son mec ont disparu…. Le film peut donc commencé. La course contre la montre pour retrouver tout ce petit monde, et surtout essayer de comprendre pourquoi et qui les a kidnappé aussi. Autant dire que les masques vont tomber…Et ça risque de s’avérer sanglant, voir mortel.

Un très mauvais film d’action avec des courses poursuite certes musclées, mais c’est pas non plus Fast and Furious 5. Le placement produit est d’une vulgarité sans égale. On hésite pas les pubs de 10 secondes ou un gars de désaltère face caméra devant une machine automatique de boisson gazeuse. On filme un héros qui traverse une place en panoramique juste pour caser le logo d’un revendeur de culture… On ose le plan extra large juste pour insérer un panneau publicitaire géant de certaines bagnoles du film. C’est grossier, grotesque à l’image du scénario ou finalement le héros va apprendre qui est réellement son papa et quelle est la nature exacte de la jeune fille espagnole qui va l’aider à retrouver sa famille. Un film ou on prend le spectateur pour un bobet incapable de remarquer que quand le héros se prend une balle dans l’épaule, l’accessoiriste costumier lui dessine un trou de balle dans la hanche… Je ne vous parle pas des chutes de toit d’immeuble improbables, ou encore de Sigourney Waver qui s’est gourée de franchise et se prend pour Terminator. Impossible de la tuer cette Alien là ! SANS ISSUE, avec aussi Bruce Willis qui meurt au bout de 20 minutes, avec Ruschdy Zem égaré au milieu de ce truc en agent du Mossad . SANS ISSUE, ça m’étonnerait… Y a toujours une porte de secours pour se tirer le plus vite possible de la salle de cinéma qui projette ça.
DETACH-MENT
Le Blue's des profs
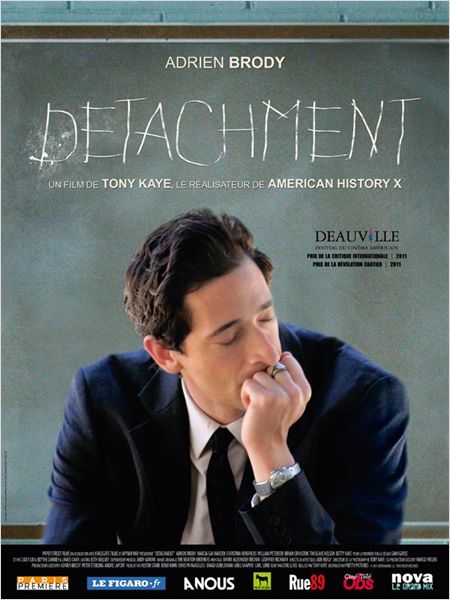
Le film s’ouvre sur une série de témoignages face camera d'enseignants qui livrent leurs états d’âme. On ne sait pas trop de qui ils parlent, mais on sent bien que ce n’est pas la fête. Très vite, on enchaîne sur Adrien Brody désabusé qui marche dans la rue de nuit le temps du générique. Le lendemain matin, il arrive a l'école pour effectuer un remplacement de un mois Dans cet établissement, les autorités ont décidé de donner un coup de balais, de faire un brin de ménage. La directrice de cette école difficile ou des gamins en rupture ultra violents n’obtiennent pas les résultats escomptés, est sur la sellette. Qu’importe, c’est dans ce contexte tendu que ce type, rôdé à l’exercice, habitué à sa faire chahuter, déboule dans sa nouvelle classe. Malgré les sarcasmes, les réticences, il est pareil à une éponge qui absorbe la violence des élèves. Il sait que sa mission se résume à surveiller, pas à enseigner. Malgré tout, il va s’atteler à la tâche. En parallèle, une autre histoire l’accapare, avec son grand père atteint de perte de mémoire. Le vieux est hospitalisé et à chaque fois qu’il rend visite à son aïeul, le vieille homme le prend pour une autre, la mère de son petit fils dont on supposera plus tard qu’il a peut-être eut une relation incestueuse avec elle. Un soir qu’il revient de l’hôpital, il croise une jeune fille, à peine sortie de l’adolescence qui tire une pipe à un gars dans le fond du véhicule. Il regarde, dégoûté, mais n’intervient pas lorsque le le client dégueu refuse de la payer et la moleste. Il descend à son arrêt et elle le suit. Il lui tend la main, lui ouvre la porte de son appartement. Il l’héberge sans arrière pensée. Il veut juste l’aider à s’en sortir à condition qu’elle le veuille elle aussi.

Et l’on passe ainsi notre temps entre cet appartement, les couloirs ou salle de classe, l’hôpital, en même temps que ce personnage principal interrompt la narration pour se confesser et penser à haute voix: « la violence des mômes provient des parents pas doués dans ce rôle », selon lui. Il insiste auprès des gamins pour le redonner le goût de la lecture, leur faire comprendre que lire permet de se développer, développer son esprit critique, sa conscience. Il faut arrêter de regarder ce flot d'image dont les autorités en place nous abreuve pour mieux cultiver notre bêtise et nous abrutir, comprenez par là que le film dénonce le pouvoir de la télé abrutissante, moutonisante. Progressivement, ce prof hors norme commence à se faire respecter, apprécier. L’une des élèves, artiste en herbe, prend des clichés, fait des dessins, des collages. Elle est amoureuse de ce nouveau professeur qui s’intéresse à elle. Enfin, quelqu’un semble la comprendre, comprendre son art. Cette jeune fille, dont le père préfèrerait qu’elle arrête la photo et le dessin, aimerait tellement un peu de réconfort, de chaleur humaine. Elle pense en trouver dans les bras de son prof. Pas question. On est aux States. Les adultes ne peuvent pas avoir de contact physique avec les enfants, même pour les réconforter, sous peine sw subir le regard inquisiteur des collègues, sous peine d’être taxé de présumé pédophile. Mais ce manque de chaleur, cette déshumanisation de l’école, et du monde en général, dans lequel on vit, conduit inévitablement au pire.

Le mal être, voila le fil rouge de ce film, mal être des élèves, des profs, des parents, de la société dans laquelle on évolue. Autour d’Adrien Brody, tout le monde va mal, y compris lui d’ailleurs. Mais au contraire des autres, il semble supporter cet état. Adrien Brody est parfait dans le rôle du prof. A ses cotés, Lucy Lu, qui campe une conseillère pédagogique au porte de la crise de nerf n’est pas mal non plus. La tentation est grande de se bourrer de cachets pour supporter ces gamins qui n’ont de goût pour rien, qui ne sont motivés par rien. Detach-ment, un bon mélo, dont on ressort complètement déprimé, lessivé avec la sensation que ces pauvres ados, si ils ne se prennent pas en main, sont morts! A signaler que tout le film est également rythmé par des animations super jolie sur un tableau noire, les seuls moments de beauté dans ce film.
BARBARA
Un peu de chaleur
en pleine Guerre Froide
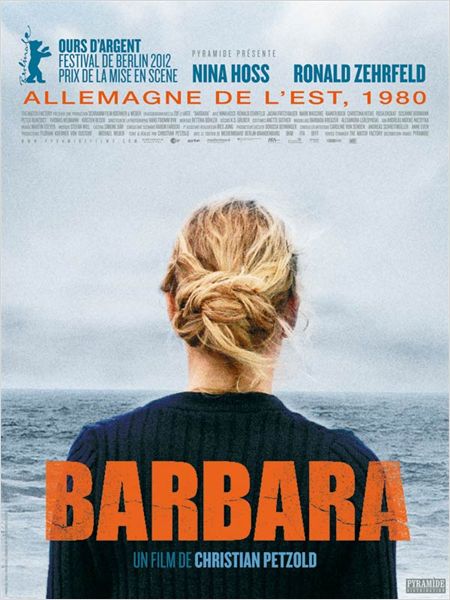
Au festival de Berlin, on ne doit pas se marrer tous les jours. Il paraîtrait d’ailleurs que chaque année en février, la courbe des ventes de cordes et de poutres s’envole dans les magasins de bricolage de la capitale germanique! C’est vrai que Berlin est réputé pour sélectionner et récompenser la crème du cinéma exigeant, fragile, en un mot chiant… euh, non pardon, du cinéma d’auteur. Pour sûr, il faudrait voir à ne pas confondre avec le festival de beauf et de comédie de l’Alpes d’Huez. On s’en est rendu compte récemment avec la sortie en salle du prix spéciale du jury, L’Enfant d’En Haut de Ursula Meier, pas franchement un film de gaudriole. Si un doute persistait dans votre cervelle quant au potentiel comique des films primés à la Berlinale, il va définitivement se lever cette semaine car vous allez tomber sur un os, ou plutôt une Hoss, une Nina Hoss, l’actrice qui incarne Barbara Dns ce film de Christian Petzold. Ce cinéaste a obtenu l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur grâce à Barbara, un film en costume, d’époque qui se déroule en 1980, de l’autre coté du mur, là ou les Mercedes Benz sont aussi rares dans les rues que les cigarettes blondes dans les cendriers. Je parle de cigarette, car dans ce film, on grille clopes sur clopes. Sans doute qu’à l’Est, la cigarette est le seule moyen qu’on a trouver pour consumer son stress.

Ici, on ne lâche pas d’une semelle la grosse fumeuse Barbara, une femme mince, élancée, blonde, pas tout à fait la quarantaine, les cernes naissantes à cause sans doute du poids de la paranoïa qui s’abat sur elle. Barbara, ce chirurgien pédiatre réputé, est une berlinoise pure jus. Mais parce qu’elle a commis l’erreur de vouloir passer à l’ouest, parce qu’elle a été sans doute dénoncée et prise la main dans le sac, Barbara a été mutée par les autorités en pleine campagne, loin, très loin de Berlin, au milieu de nulle part. Bien sur, Barbara, dans son nouvel hôpital, attire les regards et la curiosité, notamment, de son médecin chef, André, un type charmant, prévenant, à l’écoute, un homme qui lui accorde toute sa confiance et lui confie même son petit secret. André a créé en douce un laboratoire dans son hôpital, pour effectuer des analyses plus rapidement, dans le but d’améliorer le confort de ses malades. Mais pourquoi André fait-il autant d’effort pour se rapprocher de Barbara? Serait-il en train de tomber amoureux ou agirait-il dans l’unique but de surveiller pour le compte de la police locale, sa nouvelle recrue? Barbara ne sait pas. Elle se méfie. Alors elle reste distante avec André. Il faut dire aussi qu’elle a conservé un contact avec son amant berlinois, qui lui, vit à l’ouest et met tout en œuvre pour aider Barbara à passer enfin du côté du monde libre. Mais Barbara doit faire gaffe si elle ne veut pas compromettre ses chances. La discrétion est pour l’heure sa meilleurs alliée. Ne pas éveiller les soupçons de la police locale, de André, de la propriétaire de l’appartement qu’on lui loue, de ses patients… C’est à ce prix qu’elle pourra acheter sa liberté.

Barbara, un film tout en lenteur, de quoi renforcer l’atmosphère oppressante qui régnait à l’Est dans les années 80. En étirant lentement chacun des plans du film, en limitant au maximum les dialogues entre comédiens, en insistant sur des regards échangés, sur des gestes méticuleux plus que sur les mots, Christian Petzold restitue la Guerre Froide et notamment le climat de suspicion, de méfiance et de mensonge qui pouvait régner à l’Est. Par exemple, dans une chambre d’hôtel, on ne parle pas, on chuchote comme sir les murs avaient des oreilles. La nuit, on ne croise pas grand monde dans les rues quand on revient d’une promenade clandestine à bicyclette, à part une voiture de police sortie de nulle part et vous barre brusquement la route. Le jour, cette même automobile peut stationner en bas de votre immeuble et le type qui attend à l’intérieur décider de partir brusquement, ou pas… On surveille du coin de l’œil le véhicule, en tirant délicatement le rideau d’une fenêtre. Si la voiture reste là, on fait diversion. On joue du piano. On reprendra plus tard son activité principale, la recherche d’une cachette efficace dans l’appartement pour planquer l’argent nécessaire pour payer son passage à l’ouest. Barbara fourmille de détails de ce genre là et évite le cliché de la ville de l’Est grise et morne. Au contraire, il y a de la couleur, de la verdure. On fait des galipettes dans les bois, en cachette. Car il ne faut pas oublier que Barbara raconte avant toute chose une histoire d’amour belle et sincère dans un environnement hostile.
THE SUBSTANCE
Le very good trip
de Martin Witz

Après avoir réalisé le portrait de Monsieur Migros, racontant la saga de cette enseigne et de son créateur monsieur Dutti, Martin Witz le documentariste s’est pris un nouveau trip, un good en racontant cette fois l’aventure extraordianire et incroyable du LSD. The Substance, Albert Hoffman’s LSD comme son titre le laisse supposer retrace en effet l’histoire de cette drogue surpuissante depuis sa découverte en 1943 par un chercheur bâlois jusqu’à aujourd’hui. Effectivement le chimiste suisse Albert Hofmann découvre fortuitement dans son laboratoire une substance aux pouvoirs étranges et jusqu’alors inconnus. Il devient par la même le premier homme à consommer du LSD sous sa forme chimique. Une décision pas facile à prendre. Il va néanmoins braver l’angoisse de la mort, la peur de laisser derrière lui un veuve et un orphelin, celle tout aussi perturbante des possibles effets secondaires, pour tester la dangerosité de cette drogue. On comprend cette hésitation et d’ailleurs Albert Hoffman l’explique parfaitement dans le film. Ceci dit, après avoir sucé son premier buvard, il va vite y prendre gout! Toute sa vie, Albert Hoffman va consommer du LSd à très petite dose. Quand on sait qu’il est mort à 102 ans, on se dit que le LSD, ça conserve! Attention, je ne fais pas l’apologie de cette drogue. Martin Witz, consommateur occasionnel non plus… Oui, Martin Witz avoue en avoir pris. "Il vaut mieux savoir de quoi on parle avant de faire un film sur le LSD" déclarai-il au festival de Locarno en aout dernier! Le danger avec un film pareil, c’est qu’on fini par se dire que le LSD c’est cool. Evidemment, Martin Witz a bien inserré un passage sur le bad trip, mais tout de même… Bon que les choses soient claires, ce n’est pas le but poursuivi par le documentariste, rendre cette drogue séduisante auprès du grand public. Son film sert avant tout à relancer le débat sur une utilisation thérapeutique légale et encadrée du LSD. La science et les autorités se sont méprises sur la dangerosité de ce produit selon lui. Le LSD comme médicamment?.... Mais pour soigner quoi? Certainement pas un rhume de cerveau! Non, pas un rhum, mais le cerveau, oui! C’est l’un des aspects sur lequel s’étend longuement Martin Witz. Le LSD est devenu très vite le Graal des psychologues… D’un seul coup, le cerveau des cobailles sous l’effet de cette substance s’ouvrait complètement, autant dire le rêve de tous les psy devenait possible: avoir accès à l’inconscient de leur patient! Stanislas Grof, un célèbre psy que l’on voit dans le film dit clairement qu’il a toujours considéré le LSD comme un outil à l’instar du microscope du laborentin. Albert Hoffaman rejoignait cette idée. Toute sa vie, il a oeuvré pour qu’un jour, l’image du LSD change .

Malheureusement, à cause d’une utilisation incontrôlé, il est devenu impossible de réhabilité cette drogue. Tout ça à cause de l’armée amércaine! C’est l’un des chapitres passionnants du film. James Ketchum, ancien colonnel à la retraite de l’amrée US a donné à Martin witz, et surtout, l’a autorisé à utiliser des archives de l’armée américaine exceptionnelles. Et voilà comment on reste médusé devant cette expérience faite sur des jeunes recrues. Deux groupes sont disposés côte à côte, un sous l’emprise du LSD et l’autre non. Rapidement, on devine lequel des deux groupes a consommé de la drogue. Pendant que des millitaires désordonné, se marrent en ne parvenant plus à marcher au pas et en cadence, les autres les regardent, intrigués. On n’est pas dans le film les Chèvres du Pintagone, mais pas loin! En plus, lorsque James Ketchum raconte qu’à l’époque, on songeait sérieusement à utiliser le LSD comme arme de destruction massive, pour éviter de tuer l’ennemi, on se dit que l’armée us est passé à coté d’une superbe occasion de transformer la guerre en quelque chose d’inofensif! Ceci dit, le LSD a servi pendant la guerre, la guerre froide…. En tout cas au début, mais très vite, on s’est rendu compte au sein de

En dehors des archives des militaires, on découvre Albert Hoffman dans sa vie de tous les jours, chez lui, dans son labo. On regarde des images d’expériences psychédéliques mais aussi des séquences saisies au coeur du mouvement hyppie. archives misent en perspective par Carolyn Garcia, l’épouse de Jerry Garcia du Greatfull Dead, de très grands consommateurs de LSD…. J’ai souvenir d’une anecdote, qui n’est pas dans le film, mais tout de même ou Michel Magne, le compositeur de musique de film comme celle de Fantomas par exemple racaontait un épisode savoureux qui s’est déroulé dans son son chateau en France. Il avait accueilli le Greatful dead parce qu’un concert avait été annulé non loin de chez lui et l’ensemble de la caravanne ne savait pas ou dormir. Il a ainsi vu débarquer dans sa demeur le Greatful dead et leur médecin personnel qui était charger de peser les doses de LSD… , de controler le dosage. D’ailleurs, pour en revenir à Carolyne Garcia, elle-aussi insiste sur la complexité à trouver le bon dosage. Reste tout de même cette question en suspend: comment se fait-il que le LSD ait pu quitter les laboratoires de Hoffman puis de l’armée américaine pour être distribué dans les rues? Ben justement, pour tester les effets à grande échelle! Seulement, on n’avait pas envisagé de perdre à ce point le contrôle d’une telle expérience. Comment savoir à l’avance que les chevelus avec élevage de poux dans la barbe allaient faire du LSD leur drogue de prédilection. La seule solution pour Nixon, afin d’endiguer la consommation a été d’inscrire au début des années 1970 le LSD sur la liste noire. A partir de ce moment là, Nick Sand devient l’ennemi public. Il accorde sa première longue interview à Martin Witz. Nick Sand produisait du LSD à très grande échelle avant que le FBI ne l’arrête.
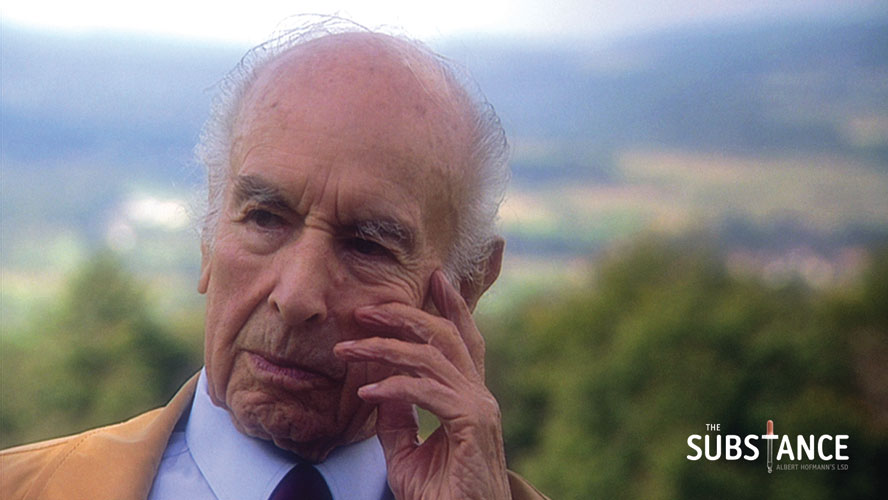
The Substance, Albert Hoffman’s LSD, un film réellement passionnant avec évidemment, comme témoin principal Albert Hoffmann, un vielle homme devenu un peu philosophe avec le temps, sans doute que sa découverte aura radicalement changé sa vie, sa manière d’envisager le monde. Il est devenu mystique avec le temps. Il emploi d’ailleurs une formule magique à ce propos : Un chimiste qui n’est pas porté sur le mystique n’est pas un bon chimiste, autant dire qu’il a été un excellent chimiste! The substance, Albert Hoffman’s LSD, un documentaire formidable, le nouveau film de Martin witz pour tripper au cinéma.
TYRANNOSAUR
Un T-Rex enragé peut
en cacher un autre

Un film anglais prodigieux de Paddy Considine, acteur dont le talent de réalisateur a éclaté au grand jour au festival de Venise en 2007 alors qu’il remporte un Lion d’Argent du meilleur court métrage pour Dog Altogether. Son premier long métrage TYRANAUSORE est en fait la suite de court métrage. On est pris aux tripes dès l’entame du film. Un homme, joué par Peter Mullan, la soixantaine bien tassée sort d’un bar alcoolisé. Il peste contre tout le monde, se plaint d’avoir perdu tout son fric. Particulièrement énervé, il frappe son chien. Un seul coup suffit à mettre chaos ce gentil toutou qui l’accompagne, pauvre animal qui n’a rien demandé et va clamecer dans le plan suivant. C’est à ça que l’on reconnaît la griffe d’un grand cinéaste, en l’occurrence Paddy Considine. Il arrive à capter dans le regard de ce chien, l’essence même de tout son film. On voit dans les yeux du clébard toute la détresse d’un animal qui se demande pourquoi son maître lui a fait ça. Sans qu’il ne puisse parler, ou même japper, on l’entend penser : « Espèce de gros connard, je t’ai rien fait. Je t’ai aimé, je t’ai supporté, je t’ai soutenu et voilà comment tu me remercies, en me tuant, en me faisant atrocement souffrir avant que je crève. Tu n’es même pas une merde, t’es pire que ça ».Inutile de dire que son chien, ce type, Joseph, y tenait. C’était son seul ami, ce chien et son petit voisin, le fils d’une dizaine d’année d’un couple divorcé vivant en face de chez lui. Elle, elle est avec un nouveau compagnon, un jeune con qui est aussi propriétaire d’un chien. Lui et sa bêtise l’ont rendu méchant, agressif… On est au beau milieu d’un quartier un peu pouilleux, gris, sans couleur, sans vie. Au pays de Paddy, pas comme dans tous les pays, les murs défraichies des maisons transpirent la misère sociale, les cabanes en tôle ondulée au fond des jardins puent le désespoir, l’alcool, le désœuvrement. Pas étonnant que Joseph trimbale son spleen de bar en bar pour oublier sa vie de merde. Un jour, après avoir s’être pris le bec avec son bookmaker et avoir fracassé la vitrine de l’établissement, Joseph trouve refuge dans la boutique d’une femme, un cul bénit. C’est pas l’armée du salut son commerce, mais pas loin. Elle redonne des fringues d’occase aux plus démunis et quand Joseph entre se cacher dans sa boutique, elle lui récite une prière. Inutile de dire que si il ne l’allonge pas avec ces points, c’est avec un vocabulaire ordurier qu’il règle son compte à la bigote. Il les insulte, elle et son dieu, avant de se barrer.

Dès lors, le point de vue change. On quitte Joseph pour s’intéresser à cette femme, prévenante, pleine de compassion, une femme en réalité battue, humiliés. Son mari lui pisse dessus ou la tabasse. C’est au choix. Bienvenu au royaume de l’horreur toute crue, toute nue. Dans ce quotidien cauchemardesque, ces deux âmes en peine que sont Joseph et Hanna alias Olivia Collman vont inévitablement se rapprocher. Ça ne sera pas si évident car lui, il ne veut pas de cette bonne femme dans ces pattes. Il a, comme il le dit, assez à faire avec sa propre merde pour s’enquiquiner à gérer celle des autres. En plus, lui même a été un mari violent avec Tyranosaure. C’est le petit nom qu’il donnait à sa femme diabétique avant qu’elle meurt. A l’époque, il trouvait ça drôle. A l’époque., il était con. Aujourd’hui, il le sait...

Tyrannosaur, ce n’est pas une claque. C’est un uppercut, une chronique sociale qui montre le reflet d'un certain aspect de l'Angleterre. Mais au delà de ça, il s'agit également d'une critique des stéréotypes et des jugements fondés uniquement sur l'apparence. Paddy Considine voulait montrer ce qui se cache derrière les sourires quotidiens : "un film intelligent pour dire à quel point on est prisonnier de nos préjugés. La petite dame du commerce d’en bas, souriante, à l’écoute vit peut-être un calvaire, un enfer dès qu’elle quitte sa boutique et qu’elle rentre chez elle ». Voilà ce que raconte ce film avec force, avec talent, avec brio…à tel point qu’il a raflé les prix de meilleur acteur, actrice et réalisateur à Sundance.
LES MECREANTS
Un 1er film prometteur

Au Maroc, comme dans pas mal de pays du monde, la jeunesse rêve de changement. Les jeunes aspirent à une vie meilleure. Encore faut-il s’entendre sur le terme ‘meilleur’ et ensuite, sur les moyens d’y parvenir. Au Maroc, la jeunesse est donc séparée en deux clans parfaitement distincts: d’une côté les progressistes, ceux qui boivent, fument, écoutent de la musique, cherchent le bonheur à travers la liberté de penser, de s’exprimer, de vivre comme ils l’entendent, quitte à se détourner quelque peu de la religion. Pour s’opposer à leur conception de la vie, ils peuvent compter sur de jeunes barbus ultra radicaux qui ne jurent que par Dieu, le port du voile, l’interdiction de succomber aux plaisirs terrestres, l’obligation de suivre à la lettre un coran interprété à leur propre sauce. Quiconque n’adhère pas à leur manière de voir les choses est un mécréant et mérite la mort! Cette idéologie conduit bien souvent sur la voie du fanatisme, de l’intégrisme et du terrorisme. C’est justement pour essayer de montrer que derrière ces terroristes il y a des hommes, à priori normaux que Mohciné Besri a pris sa plume, réuni des amis comédiens et techniciens dans un bled marocain le temps d’un été pour filmer avec un budget dérisoire Les Mécréants, son premier long métrage. De retour à Genève avec ces rush, il a convaincu Akka Film de soutenir son projet. Le coscénariste de Opération Casablanca a donc pu signer un film réalisé avec les moyens du bord et qui n’a plus rien d’une comédie, contrairement au long métrage de Laurent Nègre. Les Mécréants est en effet un huit clos sans gaudriole, intelligent, ultra tendu et qui favorise la rencontre entre deux clans qui ne se côtoient jamais. Cette cohabitation forcée amène le dialogue, et au bout du compte, peut-être un peu de compréhension mutuelle.

Pour tout dire, une troupe de théâtre prend la route afin de rejoindre Marrakech pour y jouer leur création. Deux ans ! Voilà deux longues années qu’ils se prépare pour cet événement. Autant dire que l’heure est à la joie, à la fête. Dans la camionnette, on chante, on cri, on rit. Soudain, au détour d’une route déserte, les comédiens tombent dans une embuscade. 3 jeunes barbus les kidnappent. « Ou allons-nous ? », leur demande un des otages. « En enfer, si dieu le veut! » leur répond le chef du trio. Pas d’erreur, ces trois types ne sont pas là pour plaisanter. Les otages sont en réalité conduit dans une maison isolée loin du tumulte de la ville. Là, ils sont parqué dans une pièce en attendant leur exécution. Mais les ordres du commanditaire de cette opération tardent à venir. Le trio de kidnappeurs doit gérer seul la situation tant bien que mal. D’abord décidé à séparer hommes et femmes, ils reviennent en arrière. A 3, ce n’est pas facile de surveiller 24h sur 24 deux groupes de personnes. Très vite, on se rend compte, les comédiens surtout, que ces ravisseurs ne sont peut-être pas si aguerris que cela à la technique de l’enlèvement et de la séquestration. Il sont nerveux et commettent des erreurs. Il y aurait peut-être un mince espoir d’appeler la police, ou de tenter une sortie digne pour tout le monde. N’empêche que de longues minutes, puis de très longues heures, et finalement des journées interminable d’attente s’égrainent, de quoi privilégier le dialogue. Chacun affûte ses arguments. Une mécréante ose affronter le chef des intégristes : « La valeur de l’être humain ne dépend pas de la longueur de sa barbe ou de sa jupe ». La réaction est immédiate : une paire de claque et le port de la robe obligatoire pour que la gazelle cache ses jambes. D’une manière générale, les filles du film semblent plus courageuses que les hommes. Comme si la révolte face à l’aveuglement stupide des intégristes ne pouvaient être initiée que par les femmes, depuis trop longtemps opprimées et réduite à la souffrance silencieuse. Ces filles de mauvaise de vie, jugées comme tel, affirment avec plus de véhémence leurs convictions, condamnent plus ouvertement leurs bourreaux quitte à se prendre des claques : « Tuer, toujours tuer, vous ne savez faire que ça, vous les intégristes !». Mais la parole divine réclame qu’on tue les déviants, les mécréants qui se sont écartés de Dieu. Tel est l’interprétation des textes sacrés faite par les barbus. Or le coran n’a jamais dit ça. C’est encore une femme qui s’imposera pour prendre la place du premier condamné à la mort: « C’est moi qui décide de ma mort, pas toi » dit-elle au ravisseur.

En alternant régulièrement les points de vue, tantôt avec les otages de cette guerre sainte, tantôt avec les preneurs d’otage, on voit dans chaque groupe, le doute s’immiscer. L’un des comédiens songe un moment que les intégristes sont peut-être dans le vrai. En face, on comprend que l’un des engagés dans cette guerre sainte ne l’a pas fait par conviction mais simplement en réaction à son père alcoolique qui a tué sa mère dans un accident de la route. Ce choc psychologique ajouté à une situation matérielle précaire et l’on devine qu’il devient aisé d’être manipulé et engagé dans un combat qui n’est pas la sien. Même le chef en vient à remettre en question ses convictions. Mais plus les jours passent, plus la situation devient électrique. Le stress gagne tout le monde. On creuse les tombes pendant que les comédiens répètent leur spectacle. Ils ont obtenu de la part de leur kidnappeurs de jouer leur pièce vendredi à midi. Telle est leur dernière volonté. Ils doivent la respecter. Que se passera-t-il à l’issu de la représentation ? Personne ne le sait même si à ce stade on envisage le pire. Les mots l’emporteront-ils sur les pistolets ? Peut-être, mais ce n’est pas sûr, même si l’art est sans doute la meilleure arme possible pour ouvrir les esprits et les consciences.
L'ENFANCE VOLEE
Plaisir gâché!

Le plus gros succès pour un film suisse depuis 5 ans déboule enfin dans nos salles. Figurez-vous que depuis novembre 2011, 225 000 alémaniques ont plébiscité L'enfance Volée de Markus Imboden, un film basé sur une histoire vraie. Pendant plus d’un siècle, entre 1800 et 1950, 100 000 gamins, la plupart des orphelins suisses ou des enfants de parents divorcés ont été entre guillemets vendus à des familles d’accueille, généralement paysannes. On voyait là une main d’œuvre très bon marché. Dans ces familles, il n’y avait pas de place pour l’amour. Non par contre, on tabassait les enfants. L’esclavagisme dans toute sa splendeur était de rigueur dans cette Suisse sourde, muette et aveugle. Parce que tout le monde était au courant de ces pratiques mais on préférait fermer les yeux et ne rien dire. Ce placement forcé fait partie des chapitres sombres de l’histoire suisse récente. Et c’est seulement depuis quelques années que les médias se sont intéressés de plus près au sujet. Markus Imboden s’inscrit dans cette volonté de briser l’omerta. Malheureusement, malgré son sujet le film ne pique jamais les yeux. La mise en scène est soignée. La photo est superbe, les cadrages bien pensés, la réalisation maîtrisées. Mais toutes ces qualités font le principal défaut de ce film. En effet, L’Enfance Volée est trop lisse, trop suisse, trop propre pour que l’on s’emballe réellement, pour rester bouche bée...

Le pire, c’est que dès le début, dès les 10 premières secondes, on assiste à une sortie de route, un faux départ, la faute à cette inscription sur l’écran, un commentaire qui annonce la couleur, toute la couleur. C’est comme si dans un film policier on vous donnait le nom du coupable au début, le nom du traître dans un film d’espionnage. Dans L’Enfance Volée on dit clairement qu’entre 1800 et 1950, des enfants placés en famille d’accueil ont été battu et violé. On sait donc qu’il y aura de la violence et du viol. Du coup, l’effet de surprise n’es plus et c’est ce qui est dommage. On anticipe toutes les étapes du scénario avec au bas mot 40 minutes d’avance sur le scénariste. Dès que Berteli la gamine placée dans cette famille arrive, on sait qu’elle sera l’objet sexuel de Jacob, le fils. Dès que Max l’autre orphelin joue de son accordéon, on devine que l’instrument va finir à la cheminée ou en miette- Dès que la gentille institutrice se pointe dans sa salle de classe, on est quasiment certain qu’elle va prendre fait et cause pour les mal traités Max et Berteli. Dès que le fils des paysans Jacob revient de la guerre, on sait qu’il va prendre le dessus sur son père alcoolique et, par jalousie, va dérailler...

Enfin bref, ces quelques mots de trop en début de film ternissent le tableau et c’est bien dommage. Il ne fallait pas balancer la sauce au début… parce que ça commence plutôt bien, un jour de pluie en rase campagne, avec la levée d’un corps dans une charrette. Des fossoyeurs arrivent dans une ferme. On embarque le cadavre d’un enfant sous une couverture. Immédiatement derrière, on est dans un orphelinat. On réveille les enfants en laissant glisser bruyamment une barre de fer sur les barreaux des lits. Un ramdam du tonnerre raisonne dans cette pièce immense. Tout le monde se lève sans broncher. Le film n’a pas commencé depuis 3 minutes que l’un des orphelins se prend une paire de baffe avant d’être expédier par le pasteur du coin dans sa famille d’accueil, celle qui vient d’enterrer son précédent locataire. Le pasteur donne ses recommandations et insiste sur le fait que cette fois, il faudra faire attention, tenter de garder cet enfant un peu plus longtemps car ça va commencer à se voir qu’on les maltraite! Très vite, Berteli arrive également en renfort dans cette famille pour aider la femme de la maison. Elle est un peu la chouchou. Elle a droit à du chocolat alors que l’autre doit se contenter de sa gamelle d’eau chaude en guise de soupe. Et l’on suit ainsi un bout de vie de cette famille avec Jacob le fils naturelle, en froid avec son père. Jacob qui sera le bourreau des enfants bâtards comme il les appelle, un frustré qui n’arrive pas à baiser avec la plus belle fille du village. Couvert par sa mère, Jacob va franchir la ligne. Qu’importe, de toute façon les apparences sont sauve dans cette famille qui trime et va à l’église tous les dimanche. A ce propos, les orphelins ont droit aux belles chaussures ce jour là, dans l’Eglise, mais pas pour s’y rendre ou revenir à la maison. Ah non, là on est pied nu. On s’explose les arpions sur le chemin caillouteux. Oui, il y a de la cruauté dans cette famille. Bien sur, y compris avec le lapin de Max qui finira à la casserole.

L’enfance Volée, un film malheureusement jamais émouvant ou révoltant, la faute à cette distance, ce filtre entre le spectateur et ce qu’il voit, beaucoup trop beau. Un grain dégueulas, une narration davantage bousculée, un manichéisme un peu moins appuyé auraient donné un peu plus de saveur à l’ensemble. Y avait peut-être matière à injecter un grain de sable, à accentuer le cynisme, à proposer un film un peu plus couillu, un peu moins scolaire. Pas question, on y va même d’une happy end détestable comme s’il fallait que la situation glauque vécue par ses enfants paraisse un peu moins glauque, comme si les enfants pouvaient malgré tout avoir l’espoir de s’en tirer, comme si faute avouée était à moitié pardonnée. C’est ça ! On cherche le pardon avec ce film en guise de mea culpa adressé à plusieurs générations de gamins dont on a volé l’enfance, la vie. Vous me direz que faire un petit film pour avouer l’inavouable est certes déjà un grand pas, mais on aurait préférer voir un grand film, par exemple celui qui précède L’ENFANCE VOLEE, celui que l’on ne verra jamais et qui a conduit à la mort de l’orphelin dont on lève le cadavre au tout début.
LES ADIEUX A LA REINE
Sublime,
à en perdre la tête!

Sorti cette semaine en salle, Les Adieux à la Reine avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Noémy Lovski et Virginie Ledoyen, avec aussi quelques apparitions de Xavier Beauvois. Les adieux à

L’action se déroule sur 4 jours, en huit clos, dans cette bâtisse imposante gangrenée par le délabrement, ou les moustiques autant que les rats ont élu domicile, Et dire qu’à quelques kilomètres de là, le peuple français vient de prendre d’assaut la Bastille en ce

Les Adieux à la Reine s’apparente donc à un film d’angoisse ou le suspens bien présent, va monter crescendo tout au long de ces 4 jours, 4 jours racontés du point de vue de la liseuse personnelle de Marie Antoinette. Malgré que l’on connaisse l’issue fatale pour la famille royales et leur courtisans, malgré que l’on sache que des têtes vont tomber, l’intérêt réside dans le changement d’état d’esprit. Le peuple, n’en déplaise au roi, ne réclame pas seulement du pain. Il vaut aussi le pouvoir. De quoi révulser Louis XVI, lui qui a toujours considérer le pouvoir comme une malédiction! Alors que la révolution secoue Paris, que la capitale s’embrase, que le peuple cette matière inflammable met la ville à feu et à sang, Louis XVI sent la fin de la monarchie absolue arriver et l’accepte avec dignité. Pendant ce temps là, Marie Antoinette, elle, recluse dans son Petit Trianon s’ennuie et se languit de sa maîtresse, Madame de Polignac. La Reine a délaisser son homme au profit de cette femme. Leur relation homosexuelle n’est un secret pour personne à

UN ETE BRULANT
Pas chaud mais chiant!

Oh punaise! Tous aux abris, voici le nouveau film de Philippe Garrel! Il met en scène son fils Louis et son père Maurice qui apparaît à la fin du métrage dans le rôle de l’antinazi qui, au chevet de son petit fils, à l’hôpital, sur le point de mourir, lui raconte une ultime histoire avant que celui-ci ne le rejoigne au royaume des cieux. Pour l’anecdote, le grand père Garrel est décédé peu après le tournage de Un Eté Brulant, un film qui ne respecte pas la promesse faite, celle d’un film hot, chaud. Non Un Eté Brulant n’est pas un film incandescent, tout juste l’histoire d’une flamme qui s’éteint, d’une passion amoureuse sur le point de disparaître à Rome. Et la présence au générique de Monica Bellucci trouble encore d’avantage les cartes. Elle incarne ici le fantasme masculin de la maman et de la putain. Dans ce film, elle est une femme trop belle pour être épouse et trop insoumise pour appartenir à un seul amant. Elle est en fait une actrice vedette, qui vit avec un peintre rentier Louis Garrel. Ce couple dans l’aisance, bat de l’aile. Il faut dire que lui, il ne peint plus sa femme, ne la touche plus non plus et préfère se rancarder avec des prostituées. De son coté, elle, elle prend un amant. On est à Rome, là ou débarque dans leur vie, un autre couple, deux jeunes tourtereaux qui se sont rencontrés sur un tournage alors qu’ils faisaient de la figuration.

Et Un Eté Brulant de fonctionner comme un miroir, chacun des couples renvoyant une image à l’autre couple, mais opposée. Le temps d’un été, on suit donc les aléas amoureux de ces 4 personnages et ça devient vite pénible, tant il ne se passe pas grand chose, comme souvent dans les films de Philippe Garrel. On ne change pas une tactique qui perd! 50 ans qu’il s’évertue à faire du cinéma opaque et intimiste, 50 ans qu’il divise la critique et les spectateurs. Avec lui, c’est toujours pareil. Les journaliste de Libé ou des Inrock adorent, alors que le public déteste. Personnellement, j’ai bien aimé détester ces personnages qui susurrent mais ne parlent pas, comme dans tout film d’auteur qui se respecte. On bouge les lèvres sans trop articuler, en faisant gaffe à maintenir un volume sonore le plus faible possible, pour accentuer le coté tourmenté des personnages. Une escroquerie pour masquer le vide des dialogues! Il n’y a qu’une fois ou Monica Bellucci se sent autorisé à briser cette règle, se fendant d’un cri perçant alors qu’elle aperçoit un rat dans sa penderie. Là, le niveau de décibel atteint son paroxysme. J’ai détester adorer aussi Louis Garrel en peintre torturé, atteint d’une jalousie maladive exercée sur sa compagne Monica Bellucci toujours radieuse, pas comme l’autre femme, Céline Sallette de son vrai nom. Elle campe une suicidaire qui tire la gueule, elle aussi un peu jalouse de Monica car son mec en pince secrètement pour elle. A part ses marivaudages, on parle aussi un peu politique, engagement en tout cas. On épingle le temps d’une ou deux réplique de ci de là, l’état policier instauré par Sarko. On dénonce la volonté de ficher les nomades en Italie. Mais pendant que les jeunes figurants rêvent de révolution et de changement, les deux autres bobos se complaisent dans leur confort, surtout le peintre. Tant, comme il le dit qu’il a l’amour, l’art, la peinture et sa femme, tout va bien et la révolution peut attendre. Seulement, à trop se conforter dans sa paresse, à refuser d’écouter les désirs de sa moitié, elle pourrait bien finir par se tirer. La morale de Philippe Garrel tombe donc sans surprise à la fin du film comme un couperet : En amour, c’est chacun pour soi ! Et j’ajouterais Mais la capote pour tous car il est important de se protéger! Même si avec un été brûlant, c’est certain, vous banderez mou !
MIRROR MIRROR
Dis moin que je suis une belle adaptation ciné?
oui!

C’est curieux cette manie hollywoodienne de remettre au goût du jour les comtes pour enfants. Vous me direz que depuis les premiers balbutiements du 7ème art, cette littérature a inspiré les cinéastes. Méliès en premier a donné vie à Cendrillon ou Barbe Bleue. D’autres ont suivi comme Pinocchio, La Belle et la Bête, Le Petit Pas Poucet, ce gros délire rigolo avec Omar Sy, Fred Testod, Jonathan Lambert. Dans un autre registre, la rencontre entre l’univers de Tim Burton et celui de Lewis Carol a donné naissance à une version d’Alice au Pays des Merveilles éblouissante. On ne peut pas en dire autant pour Le Petit Chaperon Rouge de Catherine Hardwicke. La maman des vampires de Twilight a offert un reloocking propre en ordre mais détestable à la fille à la capeline rouge. Enrobé dans une réalisation clipesque, un vilain loup numérique venait chercher des crosses à tout un petit village tranquille, endormi sous la neige carbonique. La mère-grand avait disparu, sacrifiée qu’elle fut sur l’autel de la sorcellerie, élément autrement plus vendeur auprès du jeune public, que de simple galettes et autres petits pots de beurre. Dans les hautes sphères d’Hollywood, on se disait peut-être à cette époque, qu’après le carton des vampires de Twilight, il y avait un nouveau train du succès à prendre. Heureusement, le public a tranché et le chaperon est resté à quai, s’offrant un joli gadin en ne rentabilisant même pas les 42 millions de dollars investis! Et oui, il ne suffit pas de miser sur des effets spéciaux numériques et de retordre dans tous les sens une histoire graver dans l’inconscient collectif pour plaire. Encore faut-il avoir une vision de son film, proposer un spectacle, un vrai, inventif, divertissant, un peu intelligent, pour s’assurer de séduire le public. C’est justement le cas de Mirror Mirror, le comte de Blanche Neige revisité par Tarsem Singh.

Le cinéaste a préférer reléguer au second plan les effets spéciaux, n’y ayant recours qu’en cas de besoin, pour miser sur un casting de choix, sur des dialogues humoristiques, et surtout, sur des décors peu nombreux mais bien choisis et bien finis. On en voit 3 ou 4 tout au plus: une clairière dans la forêt, une place de village ou l’on placarde les édits royaux, le tronc d’arbre qui abrite les nains, et le château et ses intérieurs somptueux. Les colonnes, sols en marbre, lustres généreux, portes immenses, balcons gigantesques avec vue sur la misère du peuple, fenêtres aux larges formes ovales garnies de liserais magnifique donnent à cette version cinéma de Blanche Neige toute la dimension du comte de Grimm. On s’y croirait!

Même l’option de choisir une Blanche Neige à la beauté banale est bonne. En effet, la princesse a pris les traits de la fille de Phil Collins. Oui, Lily Collins, aperçu dans Identité Secrète, l’incarne et plutôt pas mal. Avec ses gros sourcils et ses sept nains géants rigolos, en réalité des voleurs batailleurs montés sur des échasses télescopiques, la voilà qui va tenter de contrecarrer les plans de la diabolique reine, incarnée par l’excellente et sublime Julia Roberts. Elle n’a pas une ride. Il faut dire qu’elle possède le secret de la beauté et de la jeunesse éternelle. Mais cette dernière, qui s’est emparée du royaume du papa de Blanche Neige en transformant ce roi bobet en bête méchante qui hante les bois, s’ennuie. Elle aimerait bien s’occuper avec un homme, un vrai, jeune et endurant, si possible. Comme dans les comtes de Grimm, la vie est parfois bien faite, voilà qu’un prince se pointe au château. Mais comme dans les comtes de Grimm, la vie est parfois mal faite aussi, le prince reste insensible aux charmes pourtant évident de cette reine mur. Ce prince un peu con semble plus attiré par la belle Blanche Neige. S’en est trop pour la reine qui envoûte le jeune homme et condamne sa belle fille à une mort certaine mais discrète. Pendant que le jeune prince victime d’un sort qui le transforme en chiot amoureux fou se frotte sur sa nouvelle maîtresse, Blanche Neige, elle, la jeune princesse déchue, échappe à son bourreau et est recueillie dans la forêt par 7 bons hommes de petite tailles mais au grand cœur. Pas question de se morphondre sur son triste sort et de jouer les nunuches passives. On est en 2012, bordel! Alors Blanche Neige se rebelle, passe à l’action, et se métamorphose en néo-féministe ultra combative. Cette gauchiste révolutionnaire prend les armes pour venir à bout de sa tyrannique belle mère qui ne pense qu’à saigner son peuple pour payer ses fastueux banquets. Blanche Neige renverse le tyran et redonne enfin à son peuple opprimée, sa liberté.

Séduisant, plutôt bien modernisé tout en respectant l’histoire originale malgré que l’épisode de la pomme ne soit pas exactement placé là où vous l’imaginez, voilà une aventure de Blanche Neige réussie. Les plus petits vont pouvoir rêver pendant que les plus grands qui croqueront dans ce fruit défendu empoissoné se laisseront envoûter par certains gags comme la séance de bien être lorsque la reine se fait belle avec les abeilles qui lui piquent les lèvres pour donner du volume, les poissons carnivores qui lui bouffent les peux mortes des doigts ou encore le caca d’oiseau badigeonné sur le visage pour ôter les rides. Pas sûr par contre que le récit de Brighton, le bras droit lèche fesse de la reine, après sa transformation en cafard ne fasse mouche auprès du jeune public. Il raconte avoir été abusé par une sauterelle! A une faute de goût près, on aurait pu dire de cette version de Blanche Neige qu’elle est parfaite. En effet, la fin bollywoodienne vient ternir un si joli tableau! Pourquoi Blanche Neige se met à chanter et danser avec ses nains et son peuple comme dans une production indienne? En plus, le play-back est très mal synchronisé! Sans doute que la guerre des Blanche Neige va se jouer aussi sur le front des ventes de single chez les disquaires. Car vous ne le savez peut-être pas, mais dans deux mois, Charlize Theron déboulera à son tour sous les traits de la reine démoniaque dans Blanche Neige et Le Chasseur. Sauf qu’au vu de la bande annonce, on peut déjà affirmer que le cœur de cible n’est pas le même.
Ici, on vise plutôt les amateur d’héroïc fantaisy, les adorateurs de bébettes moches et méchantes, de combats à l’épée dans des clairières et d’effets spéciaux pour matérialiser des miroirs qui parlent avec un grosse voix. Non, on n’a pas hâte de voir la Bella de Twilight (Kristen Stewart), le guerrier musclé de Thor (Chris Hemsworth) et Charlize Theron dans Blanche Neige et Le Chasseur, le 13 juin en salle !
TWIXT
Le nouveau songe
de Coppola

Il était une fois un film de Francis Ford Coppola à tout petit budget, tourné essentiellement sur son domaine viticole, dans une vieille cave à vin. Twixt, tel est son titre, est un film statique, ou presque. Coppola avoue avoir voulu jouer l’économie de mouvement. Dans Twixt, la caméra ne bouge pratiquement pas, à l’exception de 5 panoramiques. Partant du principe que les spectateurs se moquent éperdument de la mise en scène, il a donc fait en sorte que les personnages soient en mouvement et évoluent dans l’espace à l’intérieurs du cadre défini pour chaque plan fixe. D’aucun penseront sans doute que le papa du Parain ou d’Apocalypse Now se ramolli, que sa maestria n’est plus qu’une légende, qu’il est bon pour la retraite. Ce serait mettre au rebut trop rapidement ce Twixt qui s’inscrit comme son précédent Tétro, dans cette volonté de revenir à des tournages à taille humaine pour développer des histoires personnelles, en l’occurrence ici la culpabilité qu’il a toujours éprouvé à la suite du décès accidentel et prématuré de son jeune fils. Cette envie couplée à un rêve étrange fait à répétition a donc donnée naissance à Twixt. Coppola raconte en effet que pendant plusieurs nuits, une jeune fille lui est apparue en songe. L’ambiance de ces rêves était inquiétante et éthérée, la faute aux vampires, ainsi qu’à Allan Edgar Poe venu le hanter pour discuter avec lui pendant son sommeil.

Et voilà comment, Francis s’est mis à l’écriture de Twixt, une histoire d’auteur en panne qui rencontre Edgar Allan Poe en rêve, une histoire avec un shérif bizarre, un vampire, un massacre d’enfants, une fantôme au visage pâle comme la mort, un clocher à 7 cadrans dont aucun n’indique la même heure, une histoire somme toute gothique qui rappelle les premiers balbutiements de Coppola en 1963. Alors qu’il travaillait à la solde de Roger Corman, il réalisa son premier long métrage sous son vrai nom, Dementia 13, un film gothique tout pourri à l’époque et qui n’a pas bien vieilli avec le temps. Pour tout dire, Dementia 13 n’a de dément que son titre. Ici, William Campbell, Luana Anders évoluent dans une histoire toute simple se déroulant en Irlande, au sein d’une famille aristocratique, ne parvenant pas, 6 ans après la disparition d'une des leurs, à faire leur deuil. Tous les ans, la famille se retrouve pour une cérémonie du souvenir. Mais cette année, au château familial, un mystérieux homme à la hache s’est invité pour zigouiller tout le monde. A travers cette histoire, Coppola cherchait à faire son "Psychose". Malheureusement trop verbeux, peuplé de faux-raccord en rafale, Dementia 13 pu l’amateurisme. Les passages qui se veulent horrifiques ne le sont jamais et quand bien même il parvient à installer un semblant d’ambiance terrifiante lors de la plongée de l’héroïne dans l’étang du château avant que le tueur à la hâche ne s’occupe de son cas, la photo est tellement mauvaise que l’on ne sait pas ce qu’elle aperçoit au fond de l’eau qui la perturbe à ce point ! En 63, rien ne laissait présager que Coppola deviendrait un cinéaste de légende. Pour l’anecdote, Dementia 13 était tellement minable que même Roger Corman le producteur demanda à l’un de ses assistants de rajouter une scène de décapitation pour étoffer le film. Ça n’a pas suffit. Mais revenons à Twixt autrement plus brillant que ce sinistre Dementia 13.
Il était une fois un Shérif sculpteur de niches à chauve souris, des jeunes gothiques installés de l'autre cote d’un lac et considérés comme les pestiférés du village de Swann Valley, Swann Valley, quel bled bizarre. C’est ici que Hall Baltimore, auteur de roman de sorcellerie à succès, débarque pour une séance de dédicaces. Problème, lorsqu’il demande à un passant où se trouve la librairie, on lui répond qu’il n’y en a pas. C’est donc, dans une quincaillerie qu’il installe ses deux tréteaux et sa montagne de livres. Les heures passent et personne n’a fait attention à lui. Arrive toutefois, en fin de journée, le shérif du coin, visiblement son seul fan, ce qui ne l’empêche pas de lui balancer une petite saloperie à la face du style : «Ça fait quoi d'être un Stephen King au rabais?». L’auteur relève à peine les sarcasmes de ce vieux schnock, un shérif qui parvient toutefois à l’attirer à la morgue. Il faut dire qu’il lui a raconté qu’un massacre a eut lieu dans ce village il y a quelques années. Voilà qui pourrait l’intéresser pour écrire un bouquin digne de ce nom. Mais arrivé à la morgue, on lui montre le corps d'une fille récemment assassinée, Elle a un pieu planté dans le thorax. Le shérif relance l'auteur et lui propose de co-écrire avec lui un bouquin sur cette jeune morte.

D’abord réfractaire, l’auteur se décide. Ça lui permettrait de sortir enfin de ces récit de sorcelleries qui ne l’inspirent plus. Il commence alors à cogiter dans sa chambre d’hôtel. D’un coup, la brume se lève. La nuit tombe. Il s’enfonce dans une clairière et se retrouve au bord d’une rivière. Soudain, le fantôme d’une fillette en robe blanche lui apparaît. Ils discutent. Elle s’appelle Vampyra. Elle a 12 ans. Alors qu’ils arrivent devant un motel, il l’invite à prendre un verre à l’intérieur. Elle refuse. Elle a peur. Elle attend sur le perron alors qu’il s’engouffre dans l’établissement. Là, un homme qui règle des horloges et la tenancière mélomane l’accueillent. L’Image en noire blanc superbe est tachée par un tapis rouge vif, écarlate alors qu’une conversation étrange s’engage sur Hitler l’inventeur de l’heure d’hivers et sur le massacre dont le shérif lui a parlé. Par la fenêtre, le fantôme de Vampyra pleure à chaude larmes en écoutant la tenancière chanter et jouer de la guitare. Soudain, la patronne s’interrompt, saute sur le fantôme. Mais Vampyra, agile, se libère et mord la femme jusqu’au sang. Baltimore sort du motel en furie et là, il aperçoit les 12 enfants massacrés en train de jouer et rire avec un monsieur. Très vite, cet homme invite les enfants à passer par une trappe dans le salon du motel. direction le sous sol. Il faut se presser de décamper car la lune va se coucher. Perdu, Baltimore commence sa course. Il suit Vampyra le fantôme dont l’image disparaît finalement dans un reflet de la rivière. C’est alors que Allan Edgar Poe apparaît et le guide. Étrange rêve! Oui, il s’agissait d’un rêve. Dès lors, l’auteur n’a plus de doute. Il doit écrire cette histoire. Mais pour cela, encore faut-il trouver un début accrocheur. Et si on commençait comme dans Balance Maman Hors du Train lorsque Billy Crystal cherche sa première phrase. Vous vous souvenez ? La nuit était humide.. non la nuit était limpide. La nuit … la nuit était… claire et humide, ce sera ça et rien d’autre! Un clin d’œil de Coppola à Balance Maman Hors du Train de et avec Danny DeVito, c’est rigolo. Ceci dit, Baltimore va renouveler l’expérience et renouer le contact avec Poe, le seul à posséder la solution pour écrire un bon livre. Il faut partir de la fin et remonter le courrant, choisir le ton et l'élément récurent. Un corbeau qui parle au lieu d'un perroquet, ça donne le ton. S’il répète sans cesse plus jamais… plus jamais, on a notre élément récurent. Reste à se débrouiller avec ça, avec ça et avec le massacre, le shérif, la morte à la morgue, les ados gothiques, les filles de Satan qui ne songent qu’au sexe et à la mort. Il faut écrire ce livre. Il doit écrire ce livre…

Twixt, un gros délire de Coppola pour un film dont on sait déjà qu’il ne rencontrera pas son public. Pour sur, l’objet, aussi maîtrisé et beau soit-il, surtout les rêves en noir blanc, n’affolera pas le box office. Notez que ce n’est pas ce but que poursuit Coppola. Clairement, il se fait plaisir, fait plaisir aux cinéphile. Val kilmer incarne à merveille Baltimore cet auteur alcoolo, emmerdé par sa femme, par son éditeur, par le shérif, par son rêve, par cette irrésistible envie de changer de registre. Cet homme qui n’a jamais fait le deuil de son enfant incarne l’alter ego de Coppola. A ses côtés, le fantôme Vampyra est campé par l’ado de Somewhere réalisé par Coppola fille. Oui, Elle Fanning a été adoubée par papa et fait désormais partie de la famille. Idem pour Ben Chaplin, acteur anglais qui campe un Edgar Allan Poe plutôt brillant. Quant au shérif, il n’y avait sans doute pas mieux que Bruce Dern, un vieux pote de Corman, pour donner vie à ce personnage haut en couleur. Si vous aimez les films un peu tordus, un peu bizarre, ne ratez pas TWIXT, de Francis Ford Coppola, un long court métrage ou un court long métrage, moins d’une heure trente,. pour rêver tout éveiller.
RADIOSTAR
Les bofiots parlent
aux bofiots!
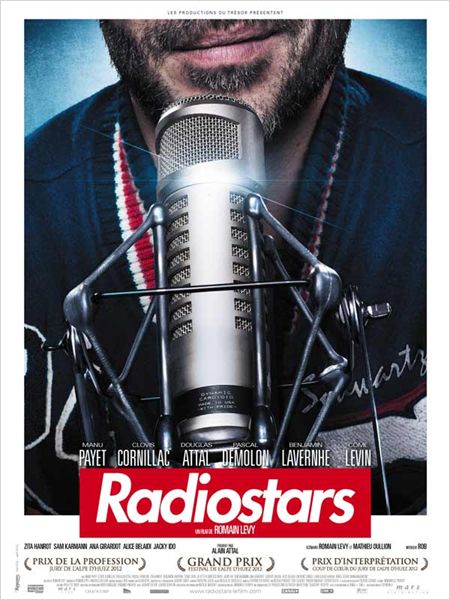
Radiostar est sorti cette semaine, un film présenté comme la comédie radiophonique de l’année, hilarante, drole, efficace… bref, le film à voir à tout prix… Je confirme… Effectivement, si vous êtes un auditeurs des radio Fm privées, ça va vous plaire. Vous retrouverez dans le film le même humour grivois et la même inconsistance que sur ces radios FM. Pour les autres, zappez ça tout de suite ! Ici, Clovis Cornillac joue le roi de la matinale sur la Radio numéro 1 préférée du public. Entouré de sa cours, il fait ce qu’il veut à l’antenne, sauf qu’un jour, sa matinale rétrograde à la deuxième place et pour son directeur des programmes, c’est inacceptable. La punition est à la hauteur de son résultat d’audience. Le voilà avec sa team obligé de sillonner les routes de France et de Navarre, de partir à la rencontre des vrais gens pour mieux les reconquérir. Le temps d’un demi été. Magie du cinéma, il va récupérer 800 000 auditeurs, ce qui est juste impossible, … surtout quand on se contente de balancer des vannes pas drôle, pas écrites, de se foutre de la gueule des gens qu’on accueille sur l’antenne. Et l’on suit donc ce RadioStar On Tour. On monte à bord de l’autobus en compagnie du roi Clovis et de sa troupe de paltoquets. Notez que Manu Payet s’en tire plutôt pas mal à ce petit jeu. Avec son air de ne pas y toucher, c’est lui le moins mauvais de la bande. Mais tout de même, dans le registre épopée radiophonique en province, Tandem de Leconte avec Rochefort et Jugnot était vraiment mieux. Je cite pas Tout le monde il est beau de Jean Yanne, beaucoup trop critique pour ramener Radiostar à ce niveau…

Honnêtement, Le seul moment de franche rigolade est lorsque l’équipe désespéré, parce qu’ils ont planté leur bus, se retrouve sans invité pour le lendemain matin. Ils sont obligés de se rancarder avec un rappeur… le gangstar se fait jeter par sa meuf. lui et les 4 matinaliers se réfugient dans sa bagnole, pour écouter son nouveau single intitulé : Ici gît ton cadavre dans les orties….
Je vous la chante
Je te viole le lundi et le mardi
Je te viole le mercredi et le jeudi
Je te viole le vendredi et le samedi
je te viole le dimanche aussi, mais en famille!
A la question posée par le rapountet: "vous en pensez quoi de ma chanson?", Manu nPayet a cette sortie formidable: "et ben dis donc, tu as des semaines sacrément chargées, toi!
La scène d’après, on les voit investir un macmerde et l’aménager en studio de radio. On s’attend à ce que le rappeur interprète son nouveau tube et pas du tout. Il nous joue une balade gentillette et poétique digne d’un chanteur folk à texte à la Benjamin Biolay ! Tout cette séquence délirante dure 15 minutes tout au plus. Vous enlevez tout ce qui précède, tout ce qui suit et vous obtenez un court métrage prodigieux ! Malheureusement, ce n’est pas le cas. Dans Radiostar, il faut se fader des vannes à deux balles, du sur-jeux, des mauvais acteurs, une histoire d’amitié naze et de co-habitation forcée le temps d’un été, dans des hôtel pouilleux et des boites de nuit merdiques…. Bref, ça pue !
BALKAN MELODIE
Sur la piste de Zamfir

Si vous souhaitez vous offrir une balade à travers 40 ans de musique et de politique balkanique, BALKAN MELODIE, un documentaire de Stefan Schwietert qui relate l’aventure extra ordinaire du couple Cellier Marcel et son épouse Catherine, va vous enthousiasmer. Marcel Cellier est connu pour avoir fondé dans les années septentes à Lutry, en Suisse, les Disques Cellier. Ce grand voyageur a acquit au fil du temps une renommée à travers le monde entier parce qu’il a eu le culot de franchir le rideau de fer et d’enregistrer, au gré de ses rencontres des musiciens jusqu’alors inconnu en occident. Sans Cellier, on n’aurait jamais entendu parler de la vedette de la flûte de pan de l’époque, le grand Zamfir. Il est venu ici à Lutry pour enregistrer des disques avec Cellier qui se sont vendus ensuite à des millions d’exemplaires. L’association orgue d’église et flûte de pan a fait un tabac à l’époque. De même, sans Cellier, Le Mystère des Voix Bulgare, ce chœur de femme reprenant des technique de chant ancestrales moyenâgeuse ne serait jamais devenu célèbre dans nos contrées. C’est lui qui les a dégottés.

L’intérêt du film, c’est de se plonger dans ces musiques, racontées par Cellier lui même, tout en visionnant des images d’archives d’une valeur inestimable. On découvre des paysages, des villes, des défilés, des plateaux de vieilles émissions de télé. On assiste à des rencontres folklorique digne du Kiosque à Musique et sur le fond, on se rend compte surtout de l’importance jouée par les autorités communistes de l’époque dans ces pays qui aidaient à la promotion de la musique. Aujourd’hui évidemment, tout ça a bien changé. Des membres de groupes encore en activité en parlent très bien. Témoin cette formation roumaine, assez proche de la pop tzigane que l’on peut entendre régulièrement dans les films du serbe Kusturica et qui dit qu’un jour, son groupe était invité à un festival de musique des balkan en Belgique et les autorités roumaine ont refusé de les aider à payer le voyage au prétexte que la Roumanie ne fait pas partie des Balkan… Evidemment, une aberration. Enfin bref, si vous aimez la flûte de pan et la musique entraînante des Balkans, vous serez rassasiez en allant écouter et même voir au cinéma BALKAN MELODIE un documentaire de Stefan Schwietert.
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
Houba! Houbien! Drôlement bien même!

Depuis le temps qu’il en rêvait de son Marsupilami, il a enfin pu passé à l’action. Cela fait en effet des années qu’Alain Chabat en parlait avec à chaque fois une étincelle dans le regard. Amoureux de la bestiole à longue queue depuis le moment ou il l’a découverte dans le magasine de Spirou, l’ex Nul a enfin pu se faire plaisir et donner vie numérique à l’insaisissable Marsupilami. Et parce qu’Alain Chabat a conservé son âme d’enfant, il a donc écrit, pensé, imaginer une aventure pour les 12 ans et moins qui s’appuie sur un classique budy movie, avec des gentils et des méchants clairement identifiés, des héros pas toujours très clairs mais qui possèdent néanmoins un bon fond. Le tandem que Chabat forme avec son ami Jamel ne manquera pas de faire des étincelles et devrait atteindre sans difficulté sa cible. Fred Testod en vieux botaniste à la recherche de la jeunesse éternelle et le général président de Palombie Lambert Wilson en en fan de Céline Dion à moustache et robe à paillette vont également illuminer le visage de plus d’une de vos têtes blondes. Sûr que certains gags échapperont aux plus petits, comme celui ou un chiwawa glisse son mini kiki dans l’oreille de Jamel et le baise, mais dans l’ensemble, les mimiques et les grimaces de Chabat, les escroqueries de son fourbe compagnon d’infortune, les déguisement du président de Palombie, les fausses publicités, le super balaise qui parle avec un petite voix gonflée à l’hélium, les coups de taser à répétition, remporteront tous les suffrages.

Palombeux, mais palombien ! Sur la Piste du Marsupilami est un vrai bon divertissement qui débute en France alors que Chabat, grand reporter animateur d’une émissio0n de télé voit son audience dégringoler. Sa directrice lui intime l’ordre de remonter ces chiffres désastreux. Pour se faire, il va reprendre ses enquêtes de terrain. Première mission, la Palombie pour y rencontrer une tribu mystérieuse qui possèderait le secret de l’éternelle jeunesse. Sur place, un escroc vétérinaire, qui doit de l’argent au bandit local, papa d’une famille très nombreuse, l’accueille pour lui servir de guide et accessoirement, le pigeonner. Après avoir monter un attrape touriste avec sa fille et le perroquet Tropico soit disant à l’article de la mort, le voilà qu’il va jouer les guides pour le journaliste. Bien sur, il compte bien ruser au milieu de la jungle avec sa troupe de gredin pour là encore, monter un canular autour de cette soit disant tribu que personne n’a jamais vu. Mais avant de partir, le journaliste doit faire un crochet par le palais du général. C’est le protocole. Ici, vit cet homme qui n’en a rien à fiche du pouvoir. Son truc, c’est la chanson à texte et les chanteuses à voix. Il rêve de rencontrer un jour Céline Dion dont il est le plus grand fan. Mais tapis dans l’ombre, le botaniste du général prépare un mauvais coup, un putch! Du haut de ses quatre vingt ans bien tassé, il va découvrir complètement par hasard le secret de la jeunesse éternelle, grâce à une plante nouvellement découverte dans la jungle. Cette plante est aussi convoitée par le Marsupilami qui va venir la lui dérober! Et voilà comment, en se mettant sur la piste du Marsupilami, il va pouvoir retrouver sa plante et pourquoi pas, de nombreuses autres fleurs aux pouvoirs magique. Mais cette traque sera aussi menée par le journaliste et son guide. Sur La Piste du Marsupilamai est un vrai film d’aventure pour enfants, une réussite totale, un spectacle haut en couleur, drôle et potache, avec du rythme et du suspens et qui respecte parfaitement la BD. Quoi de plus normal de la part d’un grand amateur de bulle. Chabat en s’emparant d’Astérix avait déjà prouver toute sa force, signant la meilleure adaptation cinéma de la série Astérix. Avec la Marsu, il récidive. A ne pas bouder.
L'ENFANT D'EN HAUT
un Ours d'Argent(illet)

Le festival de Berlin a ceci de remarquable que chaque année, quand on découvre le palmarès, on se dit qu’on a bien fait de na pas aller fouler la Potsdamer platz! A peine la Berlinale achevée que certains des films primés sortent déjà en salle et l’on se rend compte que le jury a du se fader une sélection de films d’auteurs tous plus chiants les uns que les autres avant de se mettre d’accord pour distinguer les primés. La preuve avec la sortie cette semaine de l’un d’eux, l’Enfant d’en Haut de Ursula Meier qui s’est vu remettre un Ours d’Argent par le président du jury Mike Leigh (Naked, Secrets et Mensonges). On imagine bien que le cinéaste britannique a été sensible à l’aspect social de ce long métrage, ainsi qu’aux rapports humains assez troubles entre une sœur et un frère. Mais tout de même…. N’est pas Pialat qui veut! C’est immédiatement la réflexion que l’on se fait après la vision de L’Enfant d’En Haut, deuxième long métrage de cinéma de Ursula Meier. Voilà qui laisse pressentir comme un parfum de déception! Ce n’est rien de le dire. En effet, si Home et son personnage principal de mère folle (Isabelle Huppert), jusque-boutiste, prête à mourir emmurer vivante avec sa famille pour ne jamais abandonner sa maison au bord de l’autoroute possédait une réelle force, L’Enfant d’en Haut, lui, est trop mal écrit pour emballer le spectateur. Plusieurs défauts viennent perturber ce spectacle qui se veut réaliste, malgré la pirouette de la réalisatrice qui parle de fable réaliste. Elle a bon dos la fable! Quand on choisi de dépeindre une situation précaire, celle d’un garçon de 12 ans qui prend en charge financièrement sa sœur adulte, il y a tout de même des éléments de la réalité que l’on ne peut négliger à ce point. Le premier, c’est qu’on est en Suisse. Un petit voleur qui chaparde des skis de marque (le placement produit est insupportable) en station ne peut pas officier tout au long d’une saison sans jamais se faire pincer par les gendarmes! On est en Suisse, un loyer qui n’est pas payer au bout de 2 mois et c’est déjà l’expulsion! On est en Suisse, un gamin qui ne va pas à l’école pendant toute une saison de ski est immédiatement repéré par les services sociaux! On est en Suisse, le prix d’un forfait pour atteindre les pistes est inabordable pour un pauvre môme qui vit de ces petits larcins. Vous l’avez donc compris, ces éléments important sont absents de cette fable!

Voilà pourquoi Ursula Meier ne parvient jamais à nous émouvoir avec son film qui met en scène Kacey Mottet Klein, petit caïd fragile qui prend en charge se pute de frangine. Même si on est en Suisse et qu’on n’appelle pas une pute, une pute, n’empêche que s’en est une! Et une belle. Il est vrai que Léa Seydoux, engoncée dans sa parka possède bien des charmes qui ne laissent pas insensibles les hommes du coin. Si elle parvient à en attirer, elle peine à en retenir un à tout prix dans ses filets. La faute à son frère encombrant, avec qui elle habite. C’est lui le petit mec de la maison, celui qui se débrouille avec ses petits trafics pour ramener de quoi acheter des pâtes. Ces deux là sont dans la panade. Ils vivent en bas, dans un immeuble planté au bord du bitume. Régulièrement, la réalisatrice plante sa caméra sur le parking. Après Home, on va finir par cataloguer définitivement Ursula Meier comme étant la cinéaste du goudron! Une cinéaste qui insiste lourdement, trop peut-être, sur le fossé qui s’est creusé en Suisse entre riches et pauvres, entre le soleil d’en haut et la grisaille d’en bas, la belle nature et la moche friche industrielle. Oui, L’Enfant d’en Haut, c’est lourd et ça ne pique jamais les yeux! Il est là le vrai problème de ce film. Il est lisse. Il est Suisse ! Il ne suffit pas de perturber le spectateur à mi parcours avec une grande révélation pour faire un chef d’œuvre. D’ailleurs, cette option est là encore malhabile, car on ne peut même plus évoquer le cœur même de son film si on ne veut pas priver le spectateur de la surprise que la cinéaste lui réserve. Autant annoncer clairement la couleur d’entrée et développer ensuite, une histoire bien glauque, bien réaliste sur le rapport à la maternité, et éviter de pondre une fable à deux balle ou Scully apparaît au beau milieu! On se croirait dans un épisode de X-Files à la montagne, mais sans Mulder! Ici, Gillian Anderson se fait emberlificoter par un petit martien fauché qui s’est infiltré parmi les riches. Mais son sens de la déduction et son intuition légendaire ne la trahiront pas et elle saura démasquer l’usurpateur! La seule bonne idée de L’Enfant d’en Haut, c’est d’avoir signé un film vertical. En effet, après Home, un film horizontale au bord de l’autoroute, on se déplace désormais de bas en haut dans L’Enfant d’en Haut. Vivement pas le prochain qui risque bien d’être en diagonal, à moins que Ursula Meier ne finisse par tourner en rond!
AVE
Sans Maria
mais avec Anjela
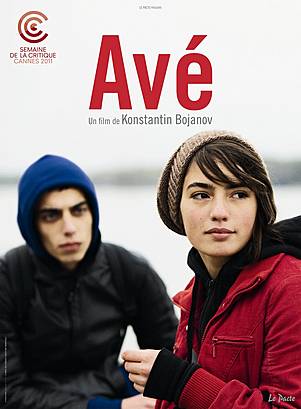
La mythomanie et le suicide chez les jeunes, voilà les deux thèmes légers développés dans Avé, un film sans Maria mais avec Anjela Nedyalkova. Cette jeune adolescente incarne Avé, une fugueuse de 17 ans qui fait de l’auto-stop et va s’imposer auprès de Kamen. Ce jeune garçon est également auto-stoppeur. Avé, le film, débute d’ailleurs par un duel au bord du bitume. Les deux personnages se tirent la bourre pour essayer d’arrêter une voiture. Soudain, après un long moment, un couple d’automobiliste s’arrête et prend à son bord les deux jeunes gens. Et voilà qu’on s’embarque pour un road movie ou l’on passera d’une voiture à une autre, d’une cabine de camion au fauteuil d’un autobus. On suit donc ces deux paumés, en mal de tendresse, de chaleur et d’amour, deux jeunes gens solitaires qui poursuivent chacun un but précis. Elle, elle voudrait tant retrouver son frère junky. Il a quitté la maison familiale. Elle ne sait pas exactement où il se trouve mais elle a une piste. Elle voudrait tant le voir et le convaincre de la suivre jusqu’en Espagne pour y faire une cure de désintoxication. Kamen, lui, poursuit un autre but. Il est en route pour Roussé, un petit village loin de Sofia. L’un de ses copains s’est suicidé récemment. Il vient présenter ses hommages à la famille en deuil. Les deux ados font donc un bout de chemin ensemble, chemin chaotique car Avé est mythomane. Elle aime raconter des bobards en permanence. Dès là première automobile qui les prend, alors que le spectateur sait bien qu’ils ne se connaissent pas, elle fait croire qu’ils sont copain et copine, que c’est à cause de lui qu’elle fume des cigarettes. Et Kamen, au lieu de contre dire cet inconnue, laisse faire. Bien sur, il y a des mensonges sympathiques, mais d’autres plus dangereux. Avec le chauffeur routier, le film pourrait sombrer dans le sordide. Plus tard, avec cet autre automobiliste qui les prend par pitié, le coup du frère de Kamen tombé en Irak ne passe pas. Surtout lorsque Kamen, qui n’était pas au courant de ce bobard, brise enfin le silence. Il ne supporte plus ces mensonges et les supportera d’autant moins lorsque dans la famille de son copain décédé, Avé va continue à baratiner, se faisant passer pour la petite amie du garçon décédé. Malgré tout, un lien se créer entre ces deux jeunes zonards solitaires mais avant que l’aventure n’aille trop loin, l’insaisissable Avé pourrait bien emprunté un autre chemin en douce, sans prévenir Kamen.

Avé un film tout simple qui a le mérite d’être très court. En 1h26 générique inclus, la messe est dite dans ce premier long métrage de Konstantin Bojanov inspiré de sa propre vie ou tout du moins de deux évènements majeurs qui ont secoué son adolescence. A cette période, il a entrepris en long périple en stop pour assister aux funérailles d’un de ses amis qui s’était suicidé. Toujours à cette époque, il éprouvait une fascination secrète pour une jeune fille de son age. Il a donc réuni les deux histoires et réalisé ce film qui repose sur la performance incroyable de la jeune actrice. Anjela Nedyalkova a une présence incroyable. Elle imprime réellement la pellicule. Pour l’anecdote, dégotter cette jeune comédienne dont c’est ici le premier film, n’a pas été très simple. Après 3 rendez-vous manqués ou elle a posé 3 lapins au directeur de casting, le réalisateur l’a croise par hasard 6 mois plus tard dans un café de Sofia. Il réussi à la convaincre de jouer le rôle principal. Elle accepte et dès le premier jour de tournage, vu sa capacité à disparaître sans laisser de trace, il lui attache un bracelet électronique GPS à la cheville! Comme ça, il était sûr de commencer et de finir Avé avec elle, un film qui s’appuie sur très peu de plan : 250 tout au plus. En général, on en compte 1000 dans un film standard. Si peu de plans, voilà une bonne idée car on ressent effectivement une certaine fluidité dans ce métrage ce qui pour un road movie est plutôt bien vu, un road movie intitulé AVE et à voir au cinéma.
UFO IN HER EYES
Délire Made In China

... ou comment parler sans plomber l’ambiance des petites gens laissé sur le coté, ceux et celles qui ne bénéficient pas du développement frénétique économique de la Chine? Et bien en signant un film de science fiction, sorte de comédie loufoque qui dérive gentiment vers le drame sociétal. Le film en question s’intitule UFO IN HER EYES et est l’œuvre d’une réalisatrice chinoise basée à Londres. Réalisatrice confirmée, elle a pour cette fois adapté son propre roman éponyme. Le film débute sur un plan étrange. Dans une rizière, un gamin à poil tire sur le sol une poupée avec une ficèle… Ne me demandez pas quelles est la symbolique derrière cette image, je n’en sais rien. J’imagine juste une manière de dire que

Ce même jour, Kwok Yun a en plus eut la bonne idée de sauver un riche américain mordu par un serpent. Bien sur que cette vision, plus cet acte de bravoure vont avoir des conséquences sur la vie de Kwok Yun, mais aussi, sur son village. Ni une, ni deux, la cheffe décide de capitaliser sur l’apparition des Ovni dans son bled. On construit un mémorial de l'ovni pour que des cars de touristes affluent de toute part. L’américain fait un don de 3000 dollars pour remercier Kwok Yun de l’avoir secouru, 3000 billets vers, une fortune pour ces paysans chinois sans le sou… Immédiatement, la boss du village lance un plan quinquennal. Elle projette de construire des building et autres parc d’attraction, bien décidée qu’elle est à faire la nique à Disney World. Pendant ce temps, la cote de Kwok Yun monte en flèche. Elle qui était jusqu’à présent le vilain petit canard du village, parce que pas mariée à 30 ans, ce n’est pas normal, elle qui a sauvé l’américain, a les honneurs de Life Magasine au travers d’un article. Elle devient La villageoise de l'année et obtient une bourse pour aller a l'école, ce qui est parfait pour cette femme illettrée. Avant cette bourse, la seule solution de se cultiver était de se marier avec un intellectuel, en l’occurrence son amant du début, le directeur de l’école, qui se trouve être déjà marié…C’est pas de bol… De toute façon, Kwok Yun est attirée par un homme plus jeune, plus beau, le réparateur de bicyclette, le muet, l’étranger, celui qui sera bientôt expulsé, celui dont on détruira la cabane car elle fait tache dans le paysage. C’est que l’expansion du village se poursuit à une vitesse folle. On inaugure un terrain de golf. Un hôtel 5 étoile sort de terre, hôtel ou en devanture une pancarte en pvc d’Obama vous accueille en vous souhaitant la bienvenue. Mais cette poussée, cette fièvre du développement a ses revers. Il n’y a pas que les étrangers que l’on expulse. Les rizières sont désormais polluées. Les pêcheurs sont au chômage et les paysans sont spoliés de leur terre par des industriels peu scrupuleux qui les exproprient. Bref, c’est le chaos, et la seule solution de sortir de là pour Kwok Yun, c’est encore de s’envoler avec son étranger à bord d’une soucoupe volante sorte d’arche de Noé fait de bric et de broc….

UFO IN HER EYES, un film réjouissant, surprenant, intriguant, passionnant, déroutant, un film chinois pour dénoncer l'industrialisation galopante qui frappe
MINCE ALORS!
Merde Alors!!!!

Pourquoi Charlotte de Turkheim s’entête à écrire et réaliser des comédies pas drôles? Pourquoi surtout, trouve-t-elle encore des ‘risquestout’ pour financer ses films à flop? Il est surtout là le mystère! Après l’innommable bouse Les Aristos sur les tracas financiers de châtelains, on pensait bien que la standardiste de Memphis alias la Pétronille des Sous Doués en Vacances se résignerait à ne plus diriger un film! Que nenni ! La voilà qui revient aux commandes d’un 3ème long métrage lourdingue et pour le coup, le terme lourdingue est bien choisi. Le film se veut une comédie avec pour toile de fond, la perte de poids dans les cures d’amaigrissement. Dommage que seul le scénario soit léger dans ce film ou l’on anticipe tous les évènements. Aucune surprise, ni bonne ni mauvaise. Aucun style dans la mise en scène ou la direction d’acteur. Aucun dialogue. Il n’y a rien qui mérite d’être sauvé dans ce métrage ou une troupe de plus ou moins gros se retrouve en cure avec la ferme intention de perdre quelques bourrelets.

Avec ce régime, vous avez perdu combien ?
3 semaines
Non sérieusement ?
1000 euros
Ceci dit, il y a tout de même un dialogue qui m’a bien fait rire. Je vous le livre, c’est le seul du film. Alors que Catherine Hosmalin fait connaissance avec un type. Il se présente ainsi :
Je m'appelle Jean Paul.
Comme mon mari! Je vais pas vous appeler Jean Paul 2 quand même
Oui, vous avez raison. En 1h30 de bobine, c’est maigre !
2 DAYS IN NEW YORK
Cette Delpy est un Roch!

Il y a tout juste 6 mois, sortait en salle le Skylab de Julie Delpy, petit film d’époque sur un été mouvementé au cœur de sa famille dans les année 70. Voilà que sort déjà le nouveau Julie Delpy, actrice réalisatrice qui se Woody Allenise en quelque sorte. Et ce n’est rien de la dire puisqu’elle semble en effet avoir adopté le même rythme de travail effréné que le binoclard new yorkais. D’autre part, elle partage sa vie entre Paris et New York, d’ou la sortie cette semaine de la suite de 2 Days in Paris, à savoir 2 Days in New York, une comédie familiale savoureuse avec des névrosées torturés comme dans un film de Woody Allen.

Ici, on appelle une chatte, une chatte et une bite, une bite. Ils sont comme ça les dialogues des films de Julie Delpy, comme elle, sans chichi, sans fioriture. Voilà pourquoi ses longs métrages possèdent ce que l’on appelle une âme! Et ça, ça n’a pas de prix… Ou plutôt, si ! Dans un film de Julie Delpy, on peut vendre son âme à Vincent Gallo pour quelques milliers de dollars si on le désire. Oui, dans 2 Days in New York, Julie Delpy qui a repris son rôle de photographe de 2 Days in Paris, solde son âme, un geste artistique, un acte conceptuel de la part d’une artiste photographe en mal de publicité. Petite parenthèse. Au cours de son exposition qui fait un flop, elle a le bonheur de toussoter et de parler maladie au téléphone. Immédiatement, la rumeur se répand dans la salle. Il faut acheter les œuvres de cette artiste inconnue, des fois qu’elle devienne célèbre après sa mort. La spéculation sur l’art et la débilité voir le cynisme des spéculateurs est clairement épingler dans ce film ou Vincent Gallo, comme je le disais, achète l’âme de Julie Delpy. Cet acheteur, qui ne croit pas spécialement au concept de l’âme, est bien décidé a conserver son acquisition, malgré l’insistance de la vendeuse à vouloir récupérer son bien. Pas question de revendre l’âme de cette femme, car même si il ne croit pas au concept de l’âme, celui d’acheter un truc qui n’existe pas l’intéresse bigrement. C’est plus l’idée de posséder 2 âmes qui le séduit. Si il perd sa première âme qui n’existe pas, il pourra toujours la remplacer par celle qu’il vient d’acheter. On ne sait jamais, des fois qu’un jour on découvre que finalement, l’âme existe ! Autant investir… Vous en conviendrez, ce raisonnement est un peu tordu! Voilà surtout une histoire d’âme qui rappelle un autre film d’une autre française talentueuse installée aussi dans la grande pomme, Sophie Barthes et son Âme En Stock avec Paul Giamatti, artiste torturé à l’idée de perdre son âme. Apparemment, ces d’histoires d’âme, ce serait un truc de française exilée à New York. N’empêche que sans âme, l’artiste est complètement déboussolé, perturbé. A moins que dans le cas de Julie Delpy, la raison de ses tourments provienne plutôt de sa famille.

Il faut dire que 2 Days In New York débute alors qu’une tornade déboule dans son appartement. En couple avec Chris Rock, cette famille recomposée va être bousculée par l’irruption du père branleur de Julie Delpy, et de sa sœur ex-nymphomane pas complètement guérie, accompagné par son mec adulescent fumeur d’herbe qui se trouve être l’ex de Julie Delpy. Vous voilà fixé. Avec une telle ribambelle de personnages, le décors de ce tableau foutraque est planté. A peine posé ses valises, le vieux se plaint car il va dormir au milieu de la salle à manger dans un canapé ce qui n’est pas très discret pour se masturber. Sa sœur, qui a tendance à se trimbaler à poil commence à lorgner un peu trop sur son beau frère Chris Rock. Très vite, le film devient hystérique. Il n’y a pas de temps mort, beaucoup de quiproquo entre l’anglais et le français. Quand on parle de ‘crabe’, on pense bébette à pinces alors qu’en anglais, le ‘crab’ est un morpion! Les dialogues fusent de toute part. Par exemple, pendant que les deux sœurs font la bouffe, l’une demande à l’autre pourquoi elle pleure. « A cause des oignons », lui répond-elle ! « Mais enfin, tu coupes les patates! ». Plus tard à table, on disserte sur la viande sur un steak pas tendre taillé dans la semelle. Et le papa sort ce verdict définitif : « Une semelle ça peut avoir du goût. Tout dépend dans quoi on a marché! ». Evidemment, tout ça est très cocasse. Autant que ce moment ou Julie Delpy perd son sang froid au téléphone alors qu’elle doit épeler son nom à une secrétaire d’une boite de dépannage d’interphone qui l’excède. « Je m’appelle : D comme Dick. U comme utérus, P comme punis… Non je suis pas grossière! J'épelle mon nom, conasse ! »..

2 Days in NY, c’est très frais, le genre de film ou ça n’arrête pas une seconde. Au cours de cette plongée en apnée au cœur d’une famille de malades, on parle de mixité et rencontre culturelle, puisque Julie Delpy vit en couple avec Chris Rock. L’acteur noir américain catapulté dans ce tourbillon, va complètement se noyer au milieu de cette troupe d’allumés. Dépassé par ces frenchies, il regrette d’avoir ouvert les portes de son intérieurs à la famille de dingos de sa femme. Son couple est en péril surtout après que la sœur de Delpy ait balancé quelques saloperies sur Obama dans un restaurant alors que Chris Rock était en train de draguer un ancien copain d’école, devenu conseiller du futur président en campagne. Lui qui voulait décrocher une interview exclusive devra se contenter d’interroger un Obama en carton dans son bureau! 2 Days in New York, un film qui tape tous azimuts mais dont le thème principal reste tout de même celui de prédilection de Julie Delpy : la famille. Il est important d’en fonder une et de ne pas renier celle à laquelle on appartient même si elle est complètement barrée. Car, en tant que couple, lorsque le premier des deux partira, le second se retrouvera seul et quoi de pire que de ne pas être entouré par des gens que l’on aime à ce moment là. 2 Days in New York, si vous voulez vous marrer à en faire pipi au culotte, c’est ce film là qu’il faut courir voir au cinéma.
.
HUNGER GAMES
Faites vos jeux!

Si l’on en juge de part le nombre de pré-locations de places de cinéma pour la sortie américaine de Hunger Games, la nouvelle héroïne des ados est bien parti pour marcher sur les traces du couple de vampire le plus célèbre d’Hollywood, Bella Swan et Edward Cullen. Même si Katniss Primerose n’a pas les mêmes canines et le même goût prononcé pour le sang que les amoureux de Twilight, n’empêche que les 14-15 ans qui ont déjà dévoré la trilogie Hunger Games inventée par Suzanne Collins. Ils attendent en ce moment fébrilement le 23 mars, date de sortie en salle du premier volet de cette nouvelle saga qui en comptera 4. C’est en effet vendredi, 2 jours après l’Europe, que le public US découvrira sur grand écran Jennifer Lawrence et Josh Hutscherson, les 2 ‘tributs’ du District 12, participants malgré eux aux 74ème Hunger Games.

Depuis que Harry Potter a tiré sa révérence, voilà donc le nouveau phénomène à la mode dans les cours de récré et sous les préaux. 30 millions de lecteurs se sont déjà passionnés pour les romans, qui pourtant, n’ont pas grand chose de renversant. Certes, Stephen King ou Stéphanie Meyer, l’auteur de Twilight, vous affirmeront le contraire. Et dire que l’idée de cette heroïc aventure pas fantaisiste pour deux rond serait née dans la cervelle de Suzanne Collins lors d’un soir de désœuvrement devant sa télé. Comme quoi, larver benoîtement devant la boite à con peut parfois avoir du bon. En fait, ce serait en zappant d’une émission de télé réalité à la gomme à un reportage de guerre, que Suzanne Collins aurait pensé à Hunger Games. Elle songe en effet que, dans un avenir proche, la télé proposera un divertissement d’horreur. Mais plutôt que d’imaginer une version de Secret Story avec un couple de psychopathes sanguinaires cannibales planqués au milieu d’une meute de bons bobets ballots, elle pense George Orwell, 1984, Big Brother qui rencontrerait Jim Carrey dans une version du Truman Show plus sanglante! Elle se dit que Gladiator qui déboulerait à Pleasantville, ça pourrait être pas mal, à condition que Russell Crowe se rase la barbe, se féminise et rajeunisse, devienne une Lara Croft des bois, sorte de Robin du tir à l’Arc capable de viser et tuer Bambi pour se nourrir. Oui, parce qu’on serait dans un monde totalitaire ou les pauvres en guenille seraient parqués dans des districts, mais sans crevettes de l’espace! On a déjà eut District 9, ça suffit comme ça avec les homards martiens! Suzanne Collins se dit qu’il faudrait néanmoins conserver cette notion de banlieues ou les habitants seraient regroupés en fonction de leur classe sociale ou de leur ethnie. Pomper Fritzlang et Godard en même temps, pourquoi pas ! De toute façon les jeunes n’en ont jamais entendu parlé alors elle se convainc qu’elle aurait tord de se priver de recréer un Métropolis à l’horizontal, un Alphaville sans Alpah60, ou l’amour n’existerait pas et seule la logique, basée sur la répression, la peur, l’angoisse, logique dictée par un pouvoir totalitaire, triompherait. Séparés par des frontières de béton comme dans In Time de Andrew Nichols, certains de ces district pourraient aussi rappeler Nuits et Brouillard dans l’autre sens. Ah ça, ce serait génial! C’est à bord d’un Shinkansen sorte de TTTTGV, train à très très très grand vitesse que l’on quitterait des baraquement.

Avant de s’installer dans un wagon, des prisonniers en costume gris, en rangs d’oignons, surveillés depuis des miradors par des militaires qui tireraient parfois dans le tas pour maintenir l’ordre, seraient tétanisés par la peur! Pas d’étoiles jaunes sur les habits de ces gens mais un petit pin’s rouillé discrètement épinglé sur la poitrine de l’héroïne! Un rappel discret de la Shoah, ça ne pourrait pas faire de mal. Mais l’Holocauste en 2012 sans écrans géants dans le camp, ce ne serait pas crédible.

Et voilà comment Suzanne Collins rajoute un podium, des écrans LCD, une animatrice de télé vedette venue exécuter le tirage du loto en direct devant les caméras de télévision. Les gagnants, un garçon et une fille âgés entre 12 et 18 ans, sont expédiés sur The Island de Micheal Bay pour y vivre une aventure de Kolanta plus proche du Délivrance de John Boorman que de Camping de Franc Dubosc. Ah pour sûr, ça a cogité pas mal dans la tronche de Suzanne Collins ce soir là devant sa télévision. Elle a ensuite pris le temps de mettre en forme toutes ses idées et après un long travail d’écriture, a accouché de Hunger Games, un teenage movie à priori nunuche mais pas si crétin qu’il n’y paraît.

En effet, contrairement à Twilight, Hunger Games aura le mérite de faire réfléchir vos ados, ce qui est déjà pas si mal ! Vos têtes blondes régulièrement scotchées devant les programmes avilissant de télé réalité vont enfin ouvrir les yeux sur l’envers, pour ne pas dire l’enfer, du décors. Et oui, Hunger Games leur montrera que ces émissions sont toutes truquées. On sert au téléspectateur ce qu’il veut voir. Il existe des combines pour le séduire et l’obliger aussi à être sous le charme d’un candidat que l’on aura choisi de mettre en avant pour ses qualités, ou ses défauts. Dans la cas de l’héroïne du district 12, ce sera plutôt ses qualités humaines et esthétiques. Jennifer Lawrence la jeune et belle actrice plus connu pour sa participation à des films à petit budget façon Winter’s Bone goûte ici aux joies du blockbuster, pas si buster que ça! Même si l’intrigue est livrée d’un bloc, l’enrobage, lui, lorgne plutôt sur le cinéma indépendant, en tout cas au début, avec une image pas très propre qui n’arrête pas de trembler. Ces images saisie depuis des caméras tenues par des hystériques parkinsoniens, images montées par des malade du sécateur, sont censées communiquer le stress des futurs candidats au spectateurs alors que ça refilera tout juste une bonne envie de gerber. Rassurez-vous, plus on s’éloigne du district 12, plus les cadreurs et le monteur se calment.

On se pose le temps de la préparation physique des candidats dans les luxueux appartements du Capitole, avant de retrouver du mouvement lorsqu’ils sont lâchés en pleine nature. A ce propos, le bain de sang au début des jeux est plutôt réussi. Pas de fanfreluches dans la mise en scène. Même si ces jeux rappellent ceux du cirque, on n’est pas dans 300! Il n’y a pas de ralentis exagérés et encore moins de gros plans sur des geyser de sang lors de démembrements. La réalisation se veut brute de décoffrage, rapide et incisive, à l’image des 24 barbares qui se tailladent et se transpercent à l’arme blanche. La scène est filmée avec un tel réalisme que les censeurs britanniques ont imposé une coupe de 7 secondes, sans quoi le film aurait été interdit aux moins de 15 ans! Autant dire que chez Lionsgate, on n’a pas pinailler longtemps avant de miser au chutier les 7 secondes incriminées. C’est que la planche à billet doit tourner à plein régime, y compris au Royaume de Sa Majestlé. Et puis après tout, si le public veut voir de la vraie violence avec des ados qui s’entretuent sur une îles déserte, qu’il regarde en dvd Battle Royale du japonais gore pur jus signé Kinji Fukusaku et qui reprend exactement cette idée. A moins que ce ne soit le contraire! Battle Royale est sorti au cinéma en 2000 et racontait, dans un japon futuriste que pour calmer des ados devenus ultra violents et indisciplinés, les adultes avaient voter une loi, la Battle Royale dont le principe consistait à tirer au sort une classe de collège et à l’expédier sur une île déserte pour que les mômes s’écharpent le temps d’un jeu, un survival surveillé par Kitano et autrement plus couillu que ce Hunger Games hollywoodien.
N’empêche que Hunger Games, reste tout de même un peu violent. Pour la 74ème édition de ces jeux, la jeune Katniss (excellente Jennifer Lawrence), 16 ans se porte volontaire. Issue du district 12, celui des mineurs, Katniss évite ainsi à sa plus jeune sœur, tirée au sort, une mort certaine. Il se trouve que Katniss a tout de même quelques prédispositions pour la survie. Archer hors paire, elle chasse, grimpe aux arbres, crapahute dans la forêt comme personne. A cause de son sens du sacrifice, elle laisse derrière elle son copain, mais aussi sa maman, pauvre veuve pleurer depuis la mort de son mari qui a bien de la peine à tenir la maison. Bref, notre Cosette des bas quartiers rejoint la capital, goûte aux luxe lors de sa préparation physique de ces jeux. Managée par un alcoolo ex vainqueur des Hunger Games, elle devra faire équipe avec un jeune mec amoureux d’elle en secret depuis toujours. Pour espérer revenir en vainqueur dans son district et revoir ceux qu’elle aime, Katniss n’aura d’autre choix, une fois pénétré dans l’arène, que de tuer pour ne pas être tuer. Mais attention, pour mettre toute les chances de son coté, l’instinct de survie ne suffira pas. Il lui faudra aussi séduire le public et les sponsors de l’émission, sans quoi les jeux se termineront mal pour elle. Courage, honnêteté, abnégation, compassion, solidarité, fraternité, fidélité, sens du devoir sont autant de qualités qui animent l’intègre Katniss. Elle devra cependant se méfier de tous si elle veut sortir vainqueur de ces 74ème Hunger Games.

Hunger Games, un film réalisé par Gary Ross. Ce type est partagé depuis plusieurs années entre la production, l’acting, la réalisation et l’écriture de scénario. Si l’on ne devait retenir qu’un film de lui, ce serait Pleasantville, sorti en 99 et qui traitait déjà de la télévision et de son influence sur le téléspectateur. Dans Pleasantville, un mec et sa soeur se retrouvaient comme par magie catapultés dans une série télé en noir blanc des années 50, de quoi perturber la vie des héros de la série. Belle idée, beau film, sympa, drôle, touchant. La petite lucarne est cette fois encore au cœur de Hunger Games, sauf qu’on oublie la gaudriole et on se concentre sur une aventure barbare et futuriste également mise en image par Steven Soderbergh. Monsieur Ocean Eleven, producteur de Pleasanville, a en effet dirigé la seconde équipe de Hunger Games, donnant un coup de main à son pote Gary. Pour la petite histoire, monsieur Ross s’est déjà mis au travail pour réaliser la suite. Sortie prévue de Hunger Games, L’Embrasement en 2013. En 2015 ou 16, on aura sans doute Hunger Games la révolte partie1 et avant 2020, la partie2 !
OSLO 31 AUGUST
Portrait d'une jeunesse norvégienne dépressive

Un succession d’images d'archives en super 8. On se balade à Oslo en même temps que des gens s’expriment en voix off. Ils parlent de la ville, de quelqu’un qui a habité là. Ils évoquent leur souvenir jusqu’à ce que ces archives s’arrêtent sur la démolition d’un bâtiment, explosé à la dynamite. Qu’est-ce donc que ce film ? Un blocpic ou biopic sur un bloc de béton ? La vie et l’œuvre d’un immeuble ? Pourquoi pas ? Ca n’a jamais été fait et avec les norvégiens, on n’est jamais à l’abris d’une surprise. Car Oslo 31 August est effectivement un film réalisé en Norvège par un certain Joachim Trier, aucun lien de parenté avec Lars Von… N’empêche que la question est loin d’être complètement stupide car avec cet entame surprenante, il nous dresse en fait le portrait d’une ville, Oslo, et de ses habitants, vue par le regard de Anders, un jeune homme en pleine dépression, bouffé par la mélancolie, un ancien junky sur la voix de la guérison, ou de la rechute…

En effet, après les images en super8 du début, on pénètre dans la chambre de Anders. Il se lève, s’habille après avoir contemplé l’autoroute depuis sa fenètre. Anders se dirige d’un pas sûr vers un petit lac. Anders se saisi d’un gros cailloux, le porte et s’enfonce dans l’eau froide. Sa tentative de suicide par noyade se solde par un échec. Une douche plus tard, Anders obtient une permission de sortie. Cela fait parti du processus. Il a le droit de sortir de cet hôpital pour se rendre à Oslo, afin de passer un entretien d’embauche. Avant ce rendez-vous important, Anders fait un détours. Il revoit l’un de ses anciens camarades de bringue. La trentaine bien tassé, les deux hommes évoquent quelques souvenirs, mais surtout font le bilan de leur vie. Anders, du haut de ses 34 ans est convaincu qu’il pourrait mourir aujourd’hui. Il n’a rien construit, pas de famille, pas de carrière et est persuadé qu’il ne manquerait à personne, ni à ses parents, absent, en voyage, ni à sa sœur qui refuse de le voir, ni à son ex copine, elle aussi aux abonnés absent. Cet ami le console. Même si il vit en couple, est père de deux enfants, il lui fait comprendre qu’il passe son temps à jouer à la Playstation ou à s’engueuler avec bobonne. Ils n’ont plus de vie sexuel et leur vie sociale se limite à passer du temps avec des gens, des connaissances qu’il n’a pas choisi et dont il n’a rien à fiche. Bref, cet ami, est comme Anders, enfermé dans sa petite vie triste. A la différence que les gardiens de sa prison ne sont pas l’héroïne ou le crac, tout juste, la routine. Et Anders va ainsi poursuivre sa déambulation au cours de cette journée, de cette soirlée, de cette nuit, de cet aube du 31 août, dans cette ville d’Oslo à la rencontre d’autres vieilles connaissances ou de nouvelles têtes, l’occasion pour le spectateur de mesurer à quel point la jeunesse de ce pays est comme qui dirait désabusé, une génération devenue la proie d’un profond mal être. Oslo 31 August, un petit film sans prétention, de Joachim Trier qui continue son exploration du mal être des jeunes après un premier long métrage Nouvelle Donne ou il dressait déjà le portrait d’une jeunesse désabusée et déprimée. Oslo 31 August, un film à découvrir.
L'ONCLE CHARLES
A éviter !
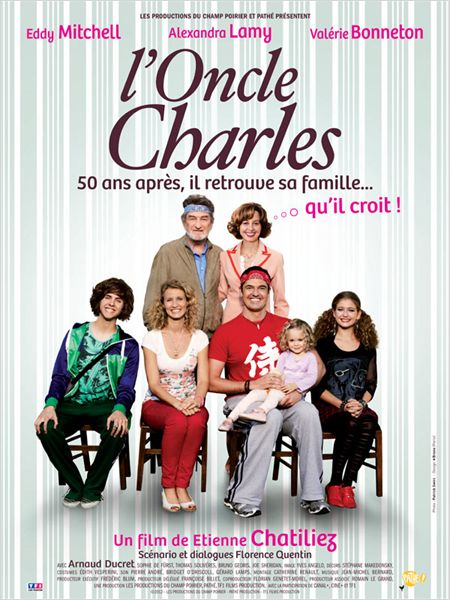
Si je vous dit, La Vie est un long Fleuve Tranquille, Tatie Danielle, Le Bonheur est dans le Pré, Tanguy… vous me répondrez : débarrasse ! Poil de Cul !!! Non pas exactement. On va pas paraphraser cette célèbre réplique prononcée par André Dussolier, le fameux papa du trentenaire Tanguy. Non, théoriquement vous devez me répondre Etienne Chatilliez et vous pouvez même enchaîner avec un « y a un baye qu’il n’a plus fait quelque chose de réellement percutant, le Chatilliez! ». Je vous le concède. En effet, ses deux précédents films, La Confiance Règne, comme Agathe Cléry manquaient cruellement de peps, un peu comme si la source du fleuve s’était tari, comme si Etienne Chatilliez et sa scénariste attitrée n’avaient plus rien à raconter. Et ce n’est pas cet ONCLE CLHARLE qui va me faire mentir. Ce nouveau film repose en effet sur un scénario d’une in-originalité crasse, s’appuie sur une manque d’inspiration effarant dans les dialogues, et est emballé dans une mise en scène fainéante. Jugez plutôt. L’Oncle Charles, c’est le mari de Tatie Danielle ou plutôt un cousin germain de mon oncle d'Amérique qui habite en nouvelle Zélande et découvre une supercherie dont il est victime. Depuis son imposante demeure, ce vieux célibataire à l’article de la mort diligente la recherche d’une héritière potentielle, histoire de léguer sa fortune à une descendance. En France, une clerc pas claire de notaire monte un traquenard et fait croire à cet homme seul qu’elle a retrouvé ce qu’il cherchait. En réalité, la copine d’enfance de la clerc va jouer à être la petite fille de cet homme. Bien sur que le Tonton Charles, appâter par l’idée de rencontrer la chaire de sa chaire, va débouler par surprise dans l’hexagone et forcément, taper l’incruste auprès de sa soit disant famille, devenant encombrant, au point de contre carrer le plan des escrocs

L’ONCLE CHARLES, un film dans lequel Chatillez ressasse ses thèmes de prédilection. La famille, l'argent, le manque d’argent, l’envie d’argent, la supercherie, le mensonge, l'opposition entre riches et pauvres. Il est question aussi du bonheur qui ne rime pas forcement avec accumulation de biens matériels. Le film se veut comme un instantané de notre époque, la fameuse, celle ou le bling bling l’emporte sur tout le reste, celle ou nos congénères semblent prêt à tout pour gagner un peu de fric facile et goûter à leur petite part de bonheur. Malheureusement, ce scénario éculé ne propose aucune situation réellement cocasse. Les dialogues, insipide, ni drôles, ni tristes sont balancés par des acteurs et des actrices en roue libre. Dès le début, le Schmoll Eddy Mitchell joue faux. Bourré parce qu’il vient de percer un secret le concernant, en l’occurrence une maladie incurable qui le frappe, il envoie balader son homme de confiance, son souffre douleur, un major d'homme belge Baudoin dit l'endive, appellation qui reviendra sans cesse, tel un running gag pas drôle. Pourquoi cette répétition à outrance de l’endive? Va savoir… Ca aussi, c’est un running gag du film. Va savoir, deux mots qui sortent régulièrement de la bouche d’une bonne sœur dans un orphelinat à l’abandon, quelque part, sur la pointe bretonne française. Pourquoi? Va savoir! En tout cas, pendant qu’Eddy se noie en Nouvelle Zéland, en France, Valérie Bonneton tente de sauver cette production du naufrage. Heureusement qu’elle est là, impeccable dans ses tailleurs orange ou saumon. Cette bourgeoise fauchée, coincée qui veut en croquer, monte sa petite escroquerie avec la complicité de son amie Alexandre Lamy, une jeune femme qui n’a pas les mêmes attentes et souffrira au fond de cette malhonnête manipulation. L’ONCLE CHARLE, à éviter !
CLOCLO
Sa vie, son oeuvre,
de sa première couche
à sa dernière douche
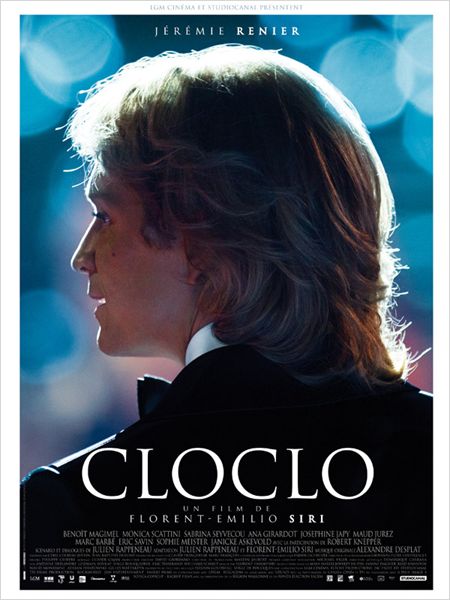
Que fiche Florent-Emilio Siri à la tête d’une telle entreprise? Voilà la première question qui frappe l’esprit pour quiconque a suivi les premiers pas de ce disciple de Rohmer au début des années 90. Après ses études sous l’œil avisé du maître, il est devenu pendant une décennie le cliper des bad boys, signant des vidéos clips pour I AM, Akhenaton, Alliance Ethnik, Expression direkt ou même les enragés de la 6 corde, Lofofora! Rien à voir avec le téléphone chougne! Coté cinéma, Florent-Emilio Siri a toujours aimé les flingues et le napalm. Il l’a prouvé dans ses précédents films, ayant eut recours à moult reprises aux armes à feu et aux situations musclées. Se refaire Nid de Guêpe avec Samy Naceri, Nadia Farès, Benoit Magimel prisonniers dans un dépôt ou s’affrontent cambrioleurs, GIGN et voyous venus libérer un ponte du banditisme. Revoir aussi L’Ennemi Intime ou comment Albert Dupontel gère ou pas, les états d’âme du jeune lieutenant Magimel qui ne supporte pas les séances de tortures infligées par l’armée française aux algériens, en pleine guerre d’Algérie. Florent-Emilio Siri s’est encore offert une incartade dans le cinéma ricain à la demande du sauveur du monde Bruce Willis, en réalisant Hostage, une prise d’otage cauchemardesque, un sous Panic Room de Fincher. Bref, avant même de se coltiner ce biopic sur Cloclo, voyez qu’on peut se poser la question de la légitimité d’un tel cinéaste en tête de générique de Cloclo. Et l’on se prend même à imaginer que le film va nous dévoiler une image sombre, méconnue, celle d’un Claude François malade de la gâchette ou amoureux secret des explosifs. Je vous rassure. Toutes ces supputations peuvent partirent en fumée. C’est de la poudre aux yeux. En guise d’amoureux des armes, Claude François était juste un sniper du verbe, et puis c’est tout. Florent-Emilio Siri a d’ailleurs été séduit par cet aspect de la personnalité de la vedette. Pour lui, je le cite, « il est important en tant que réalisateur d’avoir quelque chose à dire de personnel dans les films et une manière à soi de les dire. Je savais Claude François maniaque et manipulateur. Il a mis en scène son faux malaise lors d’un concert à Marseille en 1970. il y avait donc forcément une personnalité, derrière le chanteur à minette, qui pouvait m’intéresser ». Maniaque et manipulateur le Claude François, oui mais pas seulement ! On pourrait ajouter d’autres qualités largement explorées dans ce film: jaloux, entêté, complexé de part sa petite taille, ses jambes arquées et sa voix de canard, colérique, possessif, égocentrique, narcissique, paranoïaque, mégalomaniaque, souffrant du désamour de son père, entrepreneur infatigable très mauvais gestionnaire, copieur mais pas inventeur. Oui, les Claudettes lui ont été inspirées par Ottis Redding lors d’un concert chaud bouillant en Angleterre ou l’interprète de Hard To Handle était accompagné de choristes danseuses sexy en mini jupettes à paillettes.

Claude François est donc montré sous un jour que l’on connaissait un peu mais pas à ce point là. On comprend dès lors mieux pourquoi Josette François, la sœur de Claude, a quitté le projet très tôt. Intime de la star jusqu'à sa disparition, elle a indiqué en février dernier à l'AFP s’être embrouillée avec ses neveux au point de couper définitivement les ponts avec Marc et Claude Junior. Divergence de point de vu, mésentente sur la répartition des gains en cas de succès flamboyant du film, on parierait plutôt pour une fois, sur la première piste. En effet, l’image de Claude est largement écornée, de quoi faire bondir la frangine. De toute manières, il ne fallait pas s’attendre à un portrait édulcoré de la part des rejetons producteurs de Cloclo. Cet enfoiré malgré lui a caché pendant de nombreuses année à la terre entière, l’existence de Marc, son plus jeune fils, sans jamais se soucier des dégâts sur le psyché du gamin. Obligé de se planquer dans la chambre du haut lors des garden party au moulin de Danemois, contraint de se réfugier sous des couvertures lors de ses moindres déplacements en voitures, Marc, mais aussi Junior ont souffert de cette attitude soit disant protectrice. Pour ne pas écorner son image de séducteur, pensant que son public féminin pouvait admettre un écart, pouvait encaisser l’existence d’un enfant mais pas de deux, Claude François a privilégié son image, sa carrière au détriment de ses progéniture, leur imposant une souffrance impardonnable. Pour sur qu’en apprenant que le soir venu, après une journée de boulot, Cloclo était finalement comme tout le monde, un homme marié, père de deux gnards regardant la télé avec bobonne et les gamins en mangeant du saucisson, les gonzesses du premier rang auraient eut tôt fait de calmer leurs crises d’hystérie.

Cloclo le film, s’apparente donc à un portrait parfois acide, sans concessions de la vedette, mais un portrait longuet. Il dure près de 2h30. le film suit surtout une ligne parfaitement droite, one way, celle qui va conduire le gamin égyptien du Canal de Suez en 1939 à la capitale française en 1978. Oui, Cloclo de A à Z, de sa première couche à sa dernière douche, voilà ce que raconte ce film, sans jamais remettre en question la théorie de l’accident stupide pour expliquer sa mort. Dur à admettre tant Cloclo croulait sous les dettes. Le suicide aurait pu être une porte de sortie pour ce battant qui n’aurait plus eu la force d’affronter le fisc, de lutter contre la baisse des ventes de son journal Podium, de batailler pour éviter le gouffre que représentait son agence de mannequin Girls, ou encore de contre carrer le déclin de son parfum Eau Noire. Avec pas loin d’un milliards de franc de l’époque de dette, on aurait pu envisager le suicide plus que l’accident pour mettre fin au mythe, pour mettre fin au film. Notez que si ça se trouve, Claude François n’est même pas mort. Quand on a mis en scène sa vie comme il l’a fait, pourquoi ne pas mettre en scène son départ ! Pour sûr que Claude François est bel et bien vivant, tout du moins dans les mémoires. Ses chansons populaires ne sont jamais parties et avec la prestation époustouflante de Jérémie Reinier, les ventes de compilation devraient remonter en flèche!

Quel talent ce belge. Sans lui, le film n’aurait jamais pu se faire. Succèdant à un autre de ses compatriotes, Benoît Poelvoorde, le sosie de cloclo dans Podium de Yann Moix, film autrement plus rigolo, l’acteur fétiche des frères Dardennes est ici auteur d’une prestation éblouissante. Après 4 mois de travail intensif, encadré d’une armada de coach, 120 jours à pratiquer intensément le jogging et les séances d’abdominaux, à apprendre la batterie, les percussions, le chant et la danse, Jérémie Reinier a pu donner corps à un Claude François plus vrai que nature. Véritable pile électrique, il tient le film sur ses épaules. Le reste n’est que fioriture. On ne voit que lui, les filles autour de lui, et les perruques des autres personnages. Une fois n’est pas coutume, il faut rendre hommage au renforts coiffures qui ont travaillé sur ce métrage, une armée d’au moins cinquante coiffeurs et coiffeuses, rien de moins. Benoit Magimel en Paul Lederman à peine frisé ou Joséphine Japy en France Gall timide à cheveux lisse ne sont que deux exemples de réussite. Hommage aussi au directeur de la photo Giovanni Fiore Coltellacci, un fidèle du réalisateur, qui a su retrouver le grain de certaines images d’archives de l’époque. Résultats, de temps à autre, vraies et fausses archives retournées avec les acteurs ponctuent le film et se marient parfaitement sans que l’on fasse immédiatement la différence. Malgré cela, on peut regretter que ce biopic qui manque sérieusement de Claudette reste bien classique, trop sans doute. A tout vouloir résumer en 2 heures et demi, on fini par lasser un spectateur lambda pas spécialement accroc de la vedette. On risque aussi de ne pas contenter le fan ultime qui reprochera de nombreux raccourcis. La meilleur façon de raconter une star, c’est encore de focaliser sur ses démons comme l’a fait Joann Sfar avec Gainsbourg Vie Héroïque, ou de raconter un moment clé de sa vie, comme De Caunes l’a tenté avec Coluche lorsqu’il choisi de montrer la course du comique à la présidence française. On peut aussi s’intéresser à la personnalité avant qu’elle ne devienne connu, comme Anne Fontaine avec son excellent Coco Avant Chanel. Mais dans tous les cas, quand on veut tout dire, on fini par ne rien raconter du tout de réellement marquant! C’est malheureusement le piège dans lequel est tombé Florent Emilio Siri.
38 Témoins
La grosse claque
de la semaine
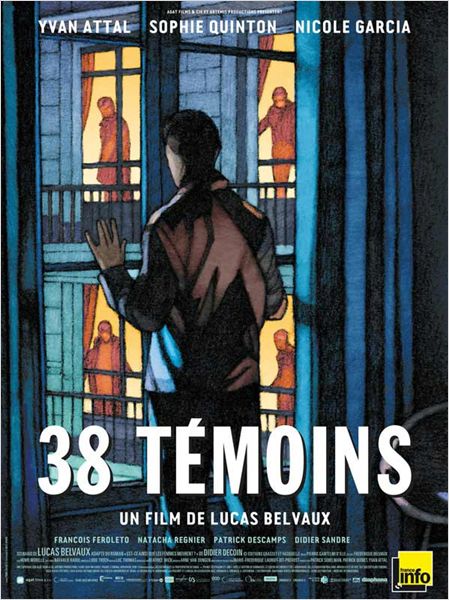
Si vous interrogez tous les cinéastes sur leur motivation à réaliser un film, vous constaterez que dans une majorité de cas, ils vous répondront que c’est pour mettre en image une scène, une seule. Comme une obsession, ce besoin devient viscéral. Ils ne pensent qu’à ça. On imagine dès lors parfaitement que Lucas Belvaux, à la lecture du roman de Didier Decoin, a immédiatement fantasmé sur le final de son film, une scène magistrale, glaçante devant laquelle on reste tétanisé, non pas à cause de ce que l’on voit, mais plutôt de ce que l’on entend. Des cris perçants, strident, insupportables, ceux d’une femme mimant une agression au couteau, brisent le silence profond de la nuit. La rue a été coupée par un important dispositif de sécurité. Quelques badauds et journalistes s’amassent derrières des barrières. Les policiers de la brigade criminel et le procureur de la république orchestre une reconstitution avec l’aide de tout le voisinage. L’un des témoins clé oriente les enquêteurs. « Ca va comme ça » demande un flic. L’homme fait signe de la tête que non. L’ordre de crier plus fort est transmis par talkie walkie à l’agente de police qui mime la victime. Elle s’exécute. Un cri, animal, bestial, guttural raisonne et transperce les murs épais des bâtiments du quartier. Les visages des locataires se figent, se crispent. Certains éclatent en sanglots. D’autres, béat, réagissent enfin.

Pourquoi ? Pourquoi n’avoir pas pris le temps de quitter le lit, de décrocher un téléphone pour prévenir la police? Pourquoi n’avoir pas bougé le petit doigt? Si seulement un seul des 38 témoins avait réagit, sans doute que cette femme aurait survécu à son assassin. Et l’interrogation se transmet alors au spectateur. Sans pour autant juger ces gens, on se dit que la peur panique n’explique pas tout. Il doit y avoir autre chose, un peu de lâcheté et beaucoup d’individualisme. Aujourd’hui, le malheur d’autrui, on s’en fout! Et la question revient. Pourquoi ce silence coupable? Si elle vous hantera longtemps après la vision du film, elle vous taraudera aussi pendant toute la durée du métrage. D’autant qu’aucune réponse ne vous sera jamais donné comme si finalement ce pourquoi importait peu à Lucas Belvaux, comme si le Comment était primordial. Comment vivre après un tel drame, avec cette culpabilité qui vous assaille parce que vous n’avez rien fait. Il est là, le cœur du film, symbolisé par Yvan Attal. Ce fantôme, ce mort vivant va briser l’omerta. Il est le seul témoin parmi les 38 qui va parler, pas tant pour se libérer de ce poids qui l’accable, mais juste parce que le silence est devenu impossible à tenir. Mais attention. Le personnage de Yvan Attal n’est pas un salaud. Ce serait trop simple de le catégoriser ainsi. Et le procureur en charge de l’affaire adopte ce même verdict. Il le dit à la journaliste locale (Nicole Garcia) qui cherche à comprendre, « un témoin qui se tait est un salaud. 38 témoins silencieux, c'est monsieur tout le monde. Il n’y a rien a comprendre. Les gens sont lâches et indifférents. Belle découverte! L'âme humaine est ainsi faite et aucun article de presse, aucun procès ne pourra y changer quoique ce soit ». La conclusion du procureur, d’une froideur absolue est d’un réalisme effrayant. Si vous aviez encore le moindre doute quant à la mocheté des hommes, ce film de Lucas Belvaux le lèvera définitivement : l’homme est une grosse merde et puis c’est tout. Et quand il s’en rend compte, il a tellement de peine à l’admettre, tellement de mal à affronter cette vérité qu’il sombre dans une profonde mélancolie, à la recherche d’une rédemption impossible. Ceci dit, le cinéaste ne veut pas faire avec ce film le procès de lâcheté. Se lancer dans un tel réquisitoire serait illusoire. Toute sa vie, le témoin qui n’a rien dit, qui n’a rien fait, devra vivre avec ce cri résonnant en boucle dans la cervelle, lui rappelant constamment sa lâcheté. Toute sa vie, il devra supporter le poids du remord. Toute sa vie, il restera seul avec son interrogation.

38 Témoins, un film impeccable pour lequel Lucas Belvaux a eut la très bonne idée d’adopter le point de vu des témoins muets, se servant d’un fait divers comme prétexte pour traiter d’autres thèmes. La lâcheté et l’individualisme, on l’a dit, mais aussi la peur, le mensonge, la justice, le couple qui vacille, incapable de surmonter une telle épreuve, la naïveté perdue. Sophie Quinton et Yvan Attal campent ces jeunes tourtereaux terrassés par ce drame. En revenant d’un voyage d’affaire, la jeune femme découvre ce qui s’est passé. Choquée par la nouvelle, elle a de plus en plus de peine à comprendre les changements d’attitude de son mari. Replier, taciturne, mélancolique, une tristesse envahi son regard. Il est l’ombre de lui même, un fantôme. Perturbé par la vision d’un type qui le fixe depuis le balcon d’en face, il n’a de cesse de tirer les rideaux de l’appartement, pour ne pas affronter cette étrange apparition qui le juge. Sans doute cette image représente sa conscience. Impossible pour lui de lui échapper, impossible également de fuir le regard interrogateur de sa femme. Il a beau lui dire qu’il était absent le soir du meurtre, elle sent qu’il lui ment. Elle le découvrira le temps d’un rêve, ou d’un cauchemar, une scène là encore remarquable. Yvan Attal assis face à Sophie Quinton, y va d’un long monologue. Dans son fauteuil, il confesse à sa femme endormie dans le lit ce qu’il a entendu. Ce n’est pas pour autant qu’il se sent libéré. La mise en scène sobre est d’une efficacité remarquable. De toute façon, dès le début du film, on pressent que Lucas Belvaux ne fera aucune faute de gout ou de grammaire cinématographique. On devine que 38 Témoins, ce sera du lourd avec ce cargo qui entre dans le port du Havre. Impressionnant par son gigantisme, ce bâtiment se traine avec majesté. Il fend les vagues d’une mer calme. En quelques plans rapides, Lucas Belvaux pose les bases de ce que sera l’atmosphère du film, pas un polar, pas un film noir, plutôt un film bleu nuit. Le bateau amarré, la nuit tombe en effet sur le port du Havre. La ville dort. Dans un quartier tranquille, un corps baigne dans son sang dans le hall d’un immeuble. Des taches d’hémoglobine tapissent la rue et les murs extérieurs de l’immeuble. Un périmètre de sécurité délimitant une scène de crime est dressé. Une enquête démarre. Une guitare lancinante, seule, raisonne. Les policiers interrogent le voisinage. Personne n’a rien vu, personne n’a rien entendu. On connaissait très mal la jeune femme agressée, une nouvelle venue dans le quartier. Tout le monde s’apitoie sur le triste sort qu’a connu la demoiselle. Des fleurs par kilos sont déposées à l’endroit du meurtre. La suite, vous la connaissez…
POSSESSIONS
Le massacre
du Grand Bornan
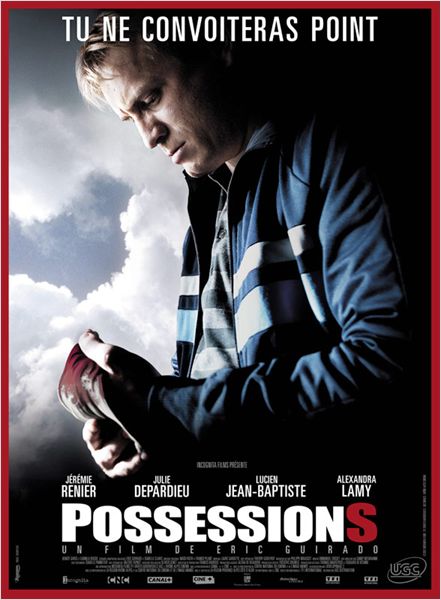
Décidément, cette semaine, les faits divers ont inspiré les cinéastes. Après le drame de la lâcheté dans 38 Témoins, voici celui de l’affaire Flactif, connu aussi comme la Tuerie du Grand Bornand. Souvenez-vous. En 2003, l’horreur prend le visage d’un couple d’anges apparaissant dans la petite lucarne. A la télévision au journal de 20h, un homme décrit l’intérieur du chalet d’une famille de riches propriétaires sauvagement assassinée alors que sa femme dénonce les rumeurs concernant la réputation sulfureuse d’escroc que se trimbalaient les victimes du carnage. Ce que l’enquête de police démontrera sans peine quelques semaines plus tard, c’est que ce couple était l’auteur du massacre du promoteur immobilier, de sa femme et de leurs enfants. Comme pour 38 Témoins de Lucas Belvaux ou la question qui traverse tout le film est comment. Comment en est-on arrivé là? Autant préciser d’emblée que Eric Guirado n’est pas intéressé par la barbarie du crime mais bien par les éléments qui ont conduit à cet acte sanguinaire. Il prend donc comme prétexte ce fait divers affreux pour disséquer la complexité de l’âme humaine. La jalousie, la convoitise, l’envie, la volonté de changer de classe sociale, la société de consommation, le surendettement, le désenchantement, le harcèlement moral d’une femme obsessionnelle qui conduit son mari sur la voix du crime sont autant de thèmes brassés dans Possessions.

Privilégiant la psychologie des personnages au détriment de la reconstitution, Eric Guirado compose ainsi un récit aussi lugubre, sombre et cruel qu’un compte de Grimm, façon le Riche et le Pauvre, une version ou Dieu n’exaucerait qu’une partie des vœux d’un couple dans le besoin, un dieu mesquin qui inciterait de fait ces pauvres gens à commettre le pire. La référence à Dieu n’est pas anodine. Il y a en effet du divin dans ce film, mais uniquement sur l’affiche. Déjà, Possessions renvoie au méchant malin malsain qui s’empare des âmes bonnes. Le regard posé sur l’affiche s’arrête ensuite sur l’accroche au dessus de ce titre qui rappelle l’un des Dix Commandements: « Tu ne convoiteras point », notamment la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mais convoiter revient à envier. Là encore, les textes saints sont clairs : L’Envie, l’un des 7 Péchés Capitaux, se défini par la tristesse ressentie face à la possession par autrui d’un bien, et la volonté de se l’approprié par tout moyen et à tout prix. Voilà donc ce qui anime Marilyne, l’envie de vivre une vie facile, l’envie de posséder la vie luxueuse des Flactifs. Parents d’une petite fille. Maryline et Bruno, ces gens du Nord, ont décidé de tout plaquer pour recommencer à zéro, à la montagne. Arrivé dans ce cadre idyllique, les propriétaires, qui leur ont signé un bail de location, leur annonce que leur chalet n’est pas tout à fait terminé. La déception est de courte durée car ils les installent dans une maison beaucoup plus grande et tellement bien agencée. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Monsieur Flactif propose d’employer au black Marilyne, en recherche d’emploi, pour faire le ménage chez eux. Pas d’erreur, ce nouveau départ à des allures de compte de fée. Maryline qui a toujours voulu mener une grande vie rêve toute éveillée. Mais Maryline oublie une chose : elle n’est pas riche. Comme le lui rappelle sa copine, elle doit se méfier car « quand tu es pauvre et que tu habites chez les riches, ça porte malheur », une parole divinatoire. En effet, très vite ce bonheur s’effrite. Trimballés d’hôtel en appartement de station, virée parce qu’elle fouinait dans les affaires des proprio, Maryline amorce une descente en enfer, silencieuse. Sa dépression grandit en même temps qu’elle côtoie le luxe et se rend compte que jamais elle ne pourra s’élever socialement. Progressivement, elle reporte sa haine sur son mari, le couvrant de reproches. Selon elle, il se laisse trop faire pas les propriétaires. Ces gens se moquent d’eux, et lui, ne réagit pas. C’est une fiotte. Harcelé moralement, humilié par sa femme sous les yeux de leurs amis, Bruno va finir par exploser.

Possessions, un film humain, à l’image d’Eric Guirado. Depuis toujours, cet ancien documentariste reconverti dans la fiction a choisi de porter à l’écran des histoires qui lui permettent d’explorer la complexité de la nature humaine et sans manichéisme. Dans Possessions, il n’y a pas les bons d’un coté et les méchants de l’autre. Si les victimes ont connu un tel sort, c’est que leurs bourreaux ont été eux-mêmes les victimes de la société de consommation dans laquelle on vit. Ils sont devenus en quelque sorte l’instrument, le bras armé, d’un modèle de société qui ne peut conduire les laissés pour compte que vers le meurtre. D’ailleurs, il est frappant de constater que tout au long du film, les vicieux écrans de télévisions renvoient régulièrement les images de spots publicitaires pour des instituts de crédits très tentant. C’est à cause de cette tentation permanente que l’on entre dans la spirale du sur endettement. Certes, ceci n’explique pas tout, sans quoi, chaque fauché serait un criminel en puissance. Il faut en effet avoir des prédispositions au meurtre pour tuer une famille entière et effacer toute trace. Il n’y a pas à excuser le geste commis par Bruno, tout juste matière à s’interroger sur le monde matérialiste dans lequel on vit. Si sur le fond, le film est impeccable, sur la forme, Possessions possède un défaut majeur et mériterait une petite retouche au niveau du montage. La scène ou Bruno envoie balader son patron et amorce sa crise de colère arrive avant qu’il ne constate de visu que son chalet est en chantier et ne sera jamais près. Du coup, il vrille trop vite, passe de l’état de calme à celui de fou furieux de manière un peu artificielle. Ca n’a l’air de rien, mais ce petit défaut fait toute la différence. D’autre part, Bruno n'est pas assez humilié par sa femme, par son pote, par son patron, ou les proprios pour tuer froidement sur une simple montée de sang. Dommage car la mise en scène est impeccable et la direction d’acteur, sans faille. Cloclo, enfin, Jérémy Reinier qui a grossi de quelques kilos pour le rôle est tout à fait crédible dans la peau de ce mari qui veut faire plaisir à sa femme, une compagne incarnée par Jullie Depardieu, toute en retenue. Oublié la fofolle que l’on connaissait jusqu’alors. Julie depardieu montre une nouvelle facette de son talent et c’est tant mieux. Idem pour , le looser de La Première Etoile, Lucien Jean Baptiste. Il est ici un escroc flamboyant, père de famille et mari attentionné. Alexandre Lamy complète idéalement ce portrait, une femme qui a réussi et qui, sans le faire exprès, le fait très bien sentir à ses nouveaux locataires. Possessions, un film d’Êric Guirado qui poursuit sur sa très bonne lancé après l’excellent film campagnard sur les épiciers ambulants, Le Fils de l’Epicier.
UN CUENTO CHINO
Un conte argentin hilarant
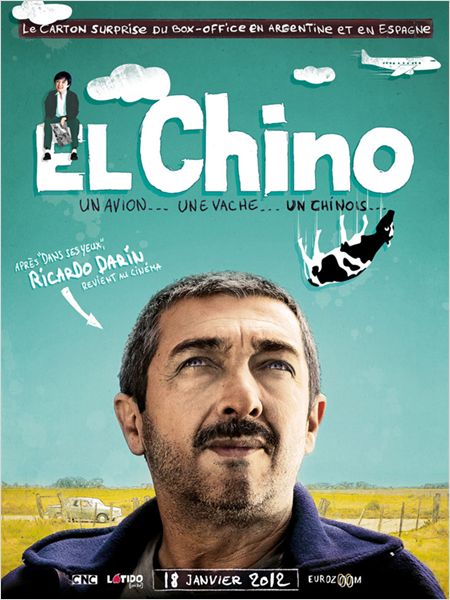
L’excellente surprise de ce premier trimestre 2012, la voici. C’est pour l’instant la meilleure comédie vue cet année au cinéma. Elle est l’œuvre de Sebastian Borensztein et s’intitule, UN CUENTO CHINO, un film qui repose sur un duo impeccable de drôlerie, de fantaisie mais pas uniquement, ce duo est aussi touchant et attendrissant. Dans UN CUENTO CHINO, Ricardo Darin, acteur argentin célèbre uniquement dans son pays donne la réplique à Ignacio Huang, acteur hyspano asiatique célèbre uniquement dans la cage d’escalier de son immeuble puisqu’il s’agit pour lui d’un premier rôle au cinéma. Et laissez-moi vous dire que cet homme plein de talent devrait faire une carrière à la Ricardo Darin. Il a de l’avenir ce Ignacio Huang. Dès le début du film, on remarque tout son potentiel.

On est en Chine. Du moins, on l’imagine de part la langue employée par les deux protagonistes de la scène qui se joue sous nos yeux. Un homme, une femme flottent au milieu d’un fleuve tranquille, à bord d’un barque. Il y a de l’amour et de la tendresse dans l’air. Le cadre bucolique est propice au romantisme. En effet, l’homme fait sa demande en mariage à cette femme. Mais au moment précis ou il tend l’anneaux symbole de leur future union, une vache tombée du ciel s’écrase sur leur barque, la cassant nette. La femme meurt tandis que l’homme rejoint la berge à la nage… Malgré la tragédie qui frappe ce pauvre couple d’amoureux, bien sur que le spectateur, goguenard se marre. Pensez donc ! Si jusqu’à présent on connaissait l’expression : il pleut comme vache qui pisse, imaginez que maintenant on pourra dire: il pleut des vaches! C’est en tout cas avec cette courte scène en mandarin sans sous titre que débute ce Cuento Chino, ce comte chinois. Immédiatement après cette réjouissante entame qui donne le ton de cette comédie, on se retrouve à Buenos Aires, dans l’échoppe d’un quincailler taciturne qui s’énerve. Alors qu’il est en train de compter le nombre de vis dans une boite, il remarque qu’il en manque une dizaine. Il s’est fait arnaquer une fois de plus, une fois de trop, et entend bien obtenir réparation en téléphonant à son fournisseur. C’est malheureusement à ce moment précis qu’entre dans son magasin le client bobo urbain chiant. Le rire s’invitera encore dans cette scène. Alors que le réalisateur s’attarde sur le quincailler, on découvre un homme, célibataire endurci, rustre et grognon, qui a le verbe franc et le coup de boule facile avec les flics, mais au fond, un type sensible qui collectionne les figurines animalières de verre et de porcelaine en mémoire à sa mère morte, une maman qu'il n'a jamais connu! Il collectionne également les faits divers les plus tordus qu’il lit dans la presse. A chaque article découpé, il imagine qu’il est à la place du malheureux qui va trouver la mort dans des circonstances stupides. Voilà comment il se voit par exemple en barbier égorgeant involontairement un client, ou alors en train de copuler avec une belle fille au volant de sa voiture, voiture parquée au bord d’une falaise et dont le frein à main sera libéré en plein orgasme. La mise en scène de ses rêveries est particulièrement drôle, idem pour le reste. Il faut dire qu’avec un quinquagénaire qui n'aime pas les gens, on a de quoi se laisser aller au niveau du scénario et donc, de la mise en scène. C’est vrai qu’il déteste les gens en général et particulièrement les crétins qui bouffent des surgelés. Allez savoir pourquoi ! De la même manière, on se demande bien aussi pourquoi il repousse les avances de Marie qui lui courre après depuis toute ses années… Enfin, il refuse.. .pas très longtemps! Allez savoir enfin comment ce type va réagir lorsque le chinois du début, qu’on commençait à oublier, va venir à sa rencontre… Ah..la rencontre ! Là encore, la scène est sur réaliste. Notre ami est en plein pique nique, devant sa voiture garé en bord d’une route à grande circulation, à proximité de l’aéroport. Le Chinois est jeté comme un sac à patate en dehors d’un taxi. Témoins de la scène, l’homme, qui a du cœur, lui tend la main même si il sent bien qu’il va le regretter. Comment en effet ne pas se fourrer dans les embêtement quand vous ne parlez que l’espagnol et que votre nouveau compagnon ne parle que le mandarin…

Dans ce conte chinois, on va de surprise en surprise, de situations coquasses en scènes gaguesques sans temps morts. Ici, la comédie est au service du drame, celui d’un étranger seul, sans argent, sans personne à qui parler, un homme perdu, isolé, veuf avant d’être marié et qui va rencontrer une autre âme solitaire., un cœur perdu meurtri réfugier dans le souvenir d’une maman qu’il n’a jamais connu. UN CUENTO CHINO, un film sensible, sur la communication, ou plutôt l’incommunicabilité entre les êtres. Il parle aussi de tolérance, de la connaissance de l’autre, d’acceptation des coutumes de l’étranger de passage et repose sur quelques dialogues bien écrits. Témoin lorsque notre ami argentin, à l’ambassade de Chine apprend dit que le type en charge des recherches d’identité du chinois inconnu est retourné en Chine pour 2 mois et ne sera pas remplacé. Le gars interloquer, choqué surpris répond du tac au tac : Comment ? Vous êtes un milliards de chinois et vous n’avez personne pour le remplacer? C’est dingue ! Le plus dingue, c’est que ce film est tirée d’une histoire vraie… un peu arrangée mais tout de même, une histoire de vache tombée du ciel qui s’est déroulée il y a quelques années en Russie. Non, je ne vous la raconterais pas. Allez plutôt la découvrir au cinéma, dans le générique de fin de Un Cuento Chino, la comédie de l’année.
ELENA
le retour du prodige
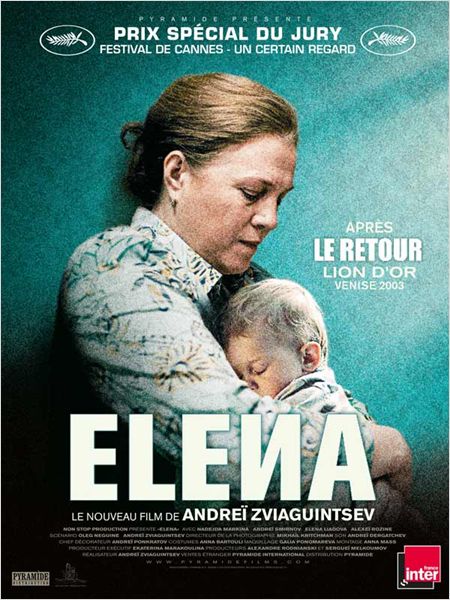
La nature dans ce qu’elle a de plus splendide et d’apaisant et la nature humaine dans ce qu’elle a de plus moche, telles sont les mamelles de Andrei Zviaguintsev, cinéaste à l’origine de 3 films, 3 longs métrages récompensés en festival. Lion d’or 2003 à la Mostra de Venise avec Le Retour, prix d’interprétation masculine au festival de Cannes pour Le Banissement en 2008, Eléna a également été salué sur la Croisette l’an dernier avec un prix spécial. De Niro et son jury ont été sensible à ce drame particulièrement sobre mettant en scène une femme prête à tout pour protéger sa famille du besoin. Si le film est séduisant par bien des aspects, il semble que son auteur ait eut envie de marquer une rupture avec ces deux précédentes réalisations. Ici, seule la nature humaine l’intéresse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constat est particulièrement pessimiste. La prise de position de Andreï Zvyagintsev est sans aucune ambigüité: nous sommes foutu, et il est illusoire de croire que les générations futures changeront le monde pourri dans lequel on vit. A quoi bon faire des enfants si c’est pour les élever, les façonner à notre image? Autant que la race humaine s’éteigne pour de bon. Pourquoi faire des enfants? Pour suivre un modèle que l’on nous impose depuis toujours! Mais qui a décrété que c’était une bonne chose que de perpétuer la race humaine? Ce discours radical est soutenu par Katia. Elle va même plus loin, image sa démonstration, prenant l’exemple des mouches à merde! Le caca n’est pas aussi mauvais qu’on nous le dit depuis toujours. Si toutes les mouches sont attirées par la crotte, c’est que la merde doit être bonne. Les mouches ne peuvent tout de même pas toutes se tromper! A moins qu’elles soient toutes complètement stupides, on peut effectivement se poser la question. Pourquoi les mouches sont autant attirés par les fientes?

Avant d’en arriver à ce questionnement essentiel, Andrei Zvyagintsev pose tranquillement ses jalons. Il ouvre son film sur un long plan fixe interminable. On a tout le loisir de contempler un lever de soleil qui se reflète sur la fenêtre d’un balcon. Un oiseau se pose sur une branche de l’arbre qui parade au premier plan. Avant qu’il ne s’envole, le spectateur pénètre dans l’appartement, un endroit spacieux, bien agencé, bien meublé, peut-être désert. Par cette succession de plan fixes, plus rapides, le cinéaste raconte la vie d’un homme et d’une femme en quelques images bien cadrée, particulièrement belles. Eléna, la soixantaine, est tirée de son sommeil par le réveil matin, en douceur, calmement. Elle prend son temps. Il règne une sensation de quiétude. Curieusement, elle et son mari Victor font chambre à part. Une chorégraphie ou chacun se croise sans trop se parler, se met en place juste avant le rituel du petit déjeuner. A ce stade, un premier dialogue s’installe enfin. On parle d’argent, d’une pension qu’il faut aller retirer à la banque. Eléna sort de l’appartement, rejoint, après avoir retiré son argent, un quartier pouilleux en banlieue à proximité d’une centrale nucléaire. Les cages à lapins qui font office d’immeuble tranchent avec les quartiers huppés où habite Elena. Elle rend visite à son fils. C’est à lui que se destinait sa pension. Marié, père de deux enfants, il est visiblement au chômage. Il a besoin d’aide, de piston et d’argent pour inscrire son fils Sacha à l’université afin qu’il évite l’armée. De retour chez elle, Eléna se prend un peu la tête avec son mari. On apprend alors qu’il est retraité, assez friqué. Il s’entretient en allant transpirer à la salle de sport. Un matin, son cœur s’arrête en plein effort dans la piscine du club. Hospitalisé, c’est là que Katia, sa fille nihiliste, camée en phase de désyntox surgit. Elle n’apprécie que moyennement Eléna, sa belle mère, autant que Victor déteste le fils de Eléna. Cette alerte médicale sonnera le glas de Vladimir. Alors qu’il se refuse à venir en aide au petit fils d’Eléna, cette ancienne infirmière de formation va prendre les choses en mains pour mettre sa famille de sang à l’abris du besoin.

ELENA, un film, comme toujours avec Andrei Zvyagintsev, extrêmement beau. La photo magnifique met en valeur des cadrages toujours précis. Cette beauté, accompagnée par les partitions sublimes de Philippe Glass, est au service d’une histoire qui pousse à la réflexion. Si le rapport à la descendance est au cœur de l’intrigue, l’égalité et la fraternité sont également des valeurs épinglées par le cinéaste. Ce sont des leurres. Fidèle à la culture russe, le cinéaste démontre ainsi que personne ne peut échapper à sa classe sociale. Eléna, issue d’une classe déshérité , malgré son union avec Victor d’une classe supérieure, ne va pas abandonner les siens. Elle ne peut pas et ne veut pas échapper à sa condition. Le mépris de Victor pour les progénitures d’Eléna, mais aussi celui d’Eléna pour Katia sont là encore le signe que l’amour, en Russie, ne peut triompher quand on vient de milieux aussi différents.
COMME UN CHEF
Master Niais

Quelle tambouille pour un 3 étoiles! A l'image de la cuisine moléculaire, le film COMME UN CHEF est plein de vide. C’est du vent. Et notez bien que pour une fois, personne ne vous en voudra si vous avouez préférer la cuisine classique façon Le Grand Restaurant, à cette mélasse moderne sans fumet, sans gout, à part l’arrière ou l’amer, celui désagréable qui reste un moment en palais après vision. Franchement, on n’a pas idée, au 21ème siècle, d’oser proposer une recette aussi peu ragoûtante. Et la catastrophe annoncée se confirme avant même le début du film, lorsque le logo de la Gaumont apparaît en gros sur l’écran avec en accompagnement, de la grande musique, en l’occurrence le très classique Avé Maria. Les clichés ont la vie dure, comme si dans les cuisines des restaurants étoilés on ne pouvait pas écouter par exemple, les Charlots et leur prodigieuse Paulette la Reine des Paupiettes. Pour le coup, ça donnerait une autre saveur. On sentirait d’emblée l’audace du chef Daniel Cohen. Surprenant Daniel Cohen, acteur et réalisateur aussi à ses heures, qui signe là son 3ème long métrage, le plus mémorable étant la comédie LES DEUX MONDES dans laquelle Benoit Poelvoorde campait deux personnages, un maître de guerre héroïque dans un monde parallèle et un chômeur loser largué par sa femme dans la vie d’aujourd’hui.

Ici, on reprend un peu les mêmes ingrédients, celui du gars insignifiant, dans la dèche qui va devenir un super héros. Ce type possède un réel talent pour l’art culinaire. Il est malheureusement sous-employé par des brasseries bas de gamme et des kebab plutôt que dans des restaurants huppés reconnus dans les guides. Odieux avec la clientèle, ce Mozart du piano de cuisine se fait rembarrer de tous les fast food où il bosse. Et pourtant, ce n’est pas le moment de perdre son boulot car sa compagne est enceinte. Avec un nouvel arrivant dans sa famille, il faut du travail pour régler au plus vite ce problème de découvert à la banque. Vous voyez le tableau. Je ne vais pas vous le peindre. D’autant que le peintre du film, c’est lui. C’est d’ailleurs sur son échafaudage, alors qu’il redonne un petit coup de blanc à des encadrement de fenêtre extérieurs d’un EMS qu’il se fait remarquer par un grand chef dans le pétrin. Le peintre n’a pas résisté à l’appel des fourneaux, abandonnant son poste de travail pour mitonner de bons petits plats aux résidents de l’EMS. Avec sa brigade, il a régalé les pensionnaires, dont l’un d’eux se trouve être le père d’un master chef! Evidemment, le toqué va recruter le géni qui va alors pouvoir enfin exprimer tout son talent. La route du succès sera ceci dit parsemée d’embuches, la faute au directeur financier du grand restaurant, obnubilé par la nouvelle cuisine et bien décidé à virer son chef trop traditionnel, et par la même, son nouveau second si brillant.

Mine de rien, je viens de vous livrer la recette du concentré de navet par Daniel Cohen. L’astuce du maître, pour ne pas la rater, a consisté à incorporer deux très mauvais acteurs vedettes, Michael Youn et Jean Réno. En ajoutant à mi cuisson un mêchant un peu piquant Julien Boisselier, requin de la finance qui n’entend rien à la cuisine mais ne jure que par la modernité et l’argent, il n’a pas réussi à relever un ensemble trop fade. Et ce n’est pas en aromatisant avec l’excellent Serge Larivière, acteur belge redoutable, remarquable qu’il est parvenu à rehausser ce bouillon cube à base de crise sentimentale et de rapport père fille difficile. Le verdict est sans appel: COMME UN CHEF est une comédie inefficace. On lorgne sans le dire sur Le Grand Restaurant et autre métrage gastronomique defunesque. Mais à son époque, quand Charles Duchemin s’opposait à Tricatel le roi de la bouffe industrielle, on trouvait l’Aile ou la Cuisse génial parce que le film de Claude Zidi racontait quelque chose, dénonçait sous couvert d’une comédie bidonnante porté par deux cador du rire, Defunès et Coluche, le nouveau règne de la mal bouffe industrielle.

Aujourd’hui, COMME UN CHEF ne dénonce rien, ne raconte rien, ne montre rien de l’univers pourtant impitoyable de la cuisine. En coulisse, la bataille pour conserver une étoile, quand on a la malchance d’être repéré par le Michelin est autrement plus âpre, rude et dévastatrice que ce qui est à peine suggérer dans ce film digne de la série télé française de référence en terme de nullité, UNE FAMILLE FORMIDABLE. Mon conseil : versez le tout dans un Tupperware. Mettez au congélateur, et surtout, ne servez jamais ce plat.
A L'AVEUGLE
La comédie involontaire
de l'année

Ce pourrait être un magnifique polar coréen ou thaïlandais, mais c’est un très mauvais thriller politique français. Sur une idée pour une fois un peu originale de Luc Besson, Xavier Palud signe le premier film sorti de la nouvelle usine participative du manitou de EuropaCorp. Le concept est intéressant. Il permet aux internautes via le site www.we-are-producteurs.com de s’impliquer dans toutes les étapes de la construction d’un film. Bien sur, en investissant de l’argent, vous avez plus de poids dans les prises de décisions que si vous ne misez aucun centimes. Ceci dit, à voir la longueur du générique de fin, au moins 10000 internautes ont apporté leur contribution, pécuniaire ou non, pour que ce film voit le jour. Le problème, c’est qu’à vouloir prendre en considération les avis du public dans toutes les étapes de la création, on se retrouve à produire un film qui ne plaira qu’aux 10000 intéressés et malheureusement pas au reste de la planète. Qui a un peu de jugeote n’aurait par exemple jamais choisi Jacques Gamblin pour jouer le rôle du flic torturé, solitaire hirsute, bourru, tué par le poids de la culpabilité lié à la mort de sa femme dans un accident de la route, un type à la voix aussi grave que sa dépendance au tabac. Ce mec se laisse aller, trimballe son spleen à 200 à l’heure au volant de sa puissante voiture… il rêve de mourir pour rejoindre sa défunte. Et mène du coup, il mène ses enquêtes comme il le peut. Le contre emplois de Gamblin est des plus foireux.

C’est avec la même dose de bon sens que le réalisateur Xavier Palud a été retenu pour porter ce projet à l’écran, une première réalisation en solo pour celui qui a commencé sa carrière comme deuxième assistant sur un indien dans la ville, qui a été décorateur sur La Veuve de St pierre de Patrice Leconte et a fini par se faire remarquer avec son compère David Moreau en coréalisant l’horrifique Ils. Boudé par le public mais accueilli chaudement par la profession, notamment Tom Cruise, sa boite

La nuit. La pluie. Des talons aiguilles. Une belle pépé sort d’une belle bagnole. Son chauffeur garde du corps l’accompagne chez elle. Elle est peureuse et lui demande de faire le tour de son appartement, par précaution. Les lieux sont sécurisés. Le type peut repartir et la nana se faire étrangler, puis découper en 15 morceaux, un vrai puzzle! Très vite, la police scientifique arrive sur les lieux et tout aussi rapidement, le policier en charge de l’affaire devine que le coupable potentiel est l’accordeur de piano aveugle. Encore faut-il pouvoir le prouver. Pas facile d’autant que quelques jours après, lors d’une soirée contre les mines anti personnel, Sergei Constantin le misanthrope de la soirée part en fumée, volatilisé au volant de la voiture qu’il vient d’acquérir. Aucun lien avec la femme découpée en morceaux à part le sens de la mise en scène. Finalement le film tourne au face à face, à la partie de poker entre le suspect aveugle et le policier clairvoyant, convaincu de sa culpabilité. Mais derrière ces deux meurtres se cachent en fait une opération de nettoyage commandité par le plus haut niveau de l’état, des généraux mouillés dans un trafique d’arme.

A L’Aveugle, il faut vraiment être atteint de cécité pour ne pas voir que ce film frise souvent le ridicule. Truffé de clichés, Gamblin joue au justicier alors que sa jeune collègue qui n’a pas régler son complexe d’Oedipe fini par succomber au charme de cet homme mur. Du coté du criminel Lambert Wilson, il est mue par un sens du devoir sans bornes, un vrai militaire qui se bat pour la France et qui, par devoir envers ses camarades trahira ces supérieurs. Ici, les personnage sont stéréotypés et l’histoire enrobé dans une réalisation digne de RIS ou autre séries Tv policière bas de gamme. Le pire est à voir à la fin lors du duel avec gros plan sur les visages façon western. A L’AVEUGLE, c’est la comédie involontaire de l’année !
LES INFIDELES
Après NY I Love You,
Paris je t'aime,
Voici
Te quiero la Quéquetta!

Voilà un film qui déboule plutôt au mauvais moment pour Jean Dujardin. Vous le savez, à moins de sortir d’un long comas, depuis que les frères Weinstein ont entamé leur opération de lobbying aux Etats Unis pour propulser The Artist au sommet, le frenchie est en apesanteur! Sa cote de popularité outre atlantique a pris l’ascenseur, et pas pour l’échafaud! Fort de sa nouvelle notoriété galopante, sans doute que les ligues catho et autres associations de féministes de tous poils ne vont pas tarder de monter au créneaux, stoppant l’ascension du play-boy en plein vol avant même qu’il n’atteigne les sommets de la gloire. La cause d’une possible rébellion de la gente féminine: Les Infidèles et les affiches du film qui laissent présager le pire, en l’occurrence une pantalonnade misogyne, galéjade irrespectueuse envers les femme et objet indigne pour le 7ème art. Aux States, ce genre de chose peut vous coûter un Oscar. Alors Dujardin minimise, assure qu’il s’agit d’une plaisanterie de carabin et que le film n’est pas à l’image de ces affiches, peut-être un poil douteuse. Pourtant, la très prude agence d’affichage JC Decaux n’a pas attendu cette explication pour retirer toutes les affiches des rues de la capitale. Une connerie sans nom, l’œuvre de l’Autorité de Régulation Professionnel de la Publicité qui a jugé que de voir Dujardin tenir les jambes écartées d’une femme avec l’inscription au dessus de lui : je rentre en réunion, était dégradant pour l’image de la femme. Idem pour celle ou l’on voit Gilles Lellouche, un téléphone portable à l’oreille, une femme plongée dans son entre jambe alors que le slogan dit: ça va couper je rentre dans un tunnel.
 |
 |
Les puritains ont donc eut raison de l’humour grivois véhiculé par ses affiches, et qui, comme le souligne Dujardin, n’illustrent pas la réelle teneur du métage… euh pardon, du métrage. Du côté de chez Mars, le distributeur du film, on se frotte les mains même si on affirme (et on veut bien les croire) que ce n’est pas un coup marketing délibéré. N’empêche que cette polémiquette aura permis de titiller les curieux qui du coup, guettent et attendent le 29 février, jour de sortie des Infidèles en salle. Et bien je prends dès maintenant les paris que les âmes prudes et les esprits tordus seront dans tous les cas déçus. En effet, si les amateurs de graveleux n’en auront pas pour leur argent, les coincés du sexe n’auront pas non plus de quoi tirer à boulet rouge sur le film. Car Les Infidèles est un projet autrement plus intelligent que ce qu’il ne laisse paraître.

Bien sur que quelques scènes sulfureuses rythment le métrage, notamment les interludes signés Alexandre Courtès. Par exemple, la saynète ou Manu Payet est surpris en flag d’acte sado mazo par ses enfants dans le garage de sa maison, celle ou Guillaume Cannet est aussi pris de court par le retour de sa femme trop soudain alors qu’il vient de congédier sa maîtresse ou encore celle ou un type à l’hôpital a le sexe coincé dans le conduit anal de sa partenaire feront bondir plus d’un esprit chaste, mais le comique des situations l’emportera sans doute. D’autant qu’entre deux courts métrages de ce mauvais goût là, les autres sketches s’attachent plutôt à décortiquer les rapports hommes femmes. Parce qu’on ne l’a pas encore dit, Les Infidèles est effectivement un film à sketch avec pour unique point commun les acteurs Jean Dujardin et Gilles Lellouche qui changent de personnage d’une histoire à l’autre. Les différents segments sont réalisés par Jean Dujardin, Gille Lellouche, Michel Hazanavicius, Fred Cavayé, Eric Lartigau, Emmanuelle Bercot). Evidemment, vu la teneur du sujet, Les Infidèles, ce n’est pas Paris je t’Aime ou New York I Love You! Mais plutôt Te quiero la quéquetta!, avec ceci dit, une réelle et sincère volonté d’offrir au spectateur un décryptage en règles des rapports délicats et conflictuels entre les deux sexes, le tout raconté du point de vu de sereal niqueurs, de déviants, ou de gens tout à fait normaux. Finalement, le résultat est plus dramatique que comique. Parce que les rapports hommes femmes sont bien souvent plus dramatiques que comiques.

Fred Cavayé est le premier à lâcher la purée avec une scène d’engueulade. Une femme reproche à son mari des messages sur son natel qu’elle ne peut pas lire. Son copain, alibi sur patte qui a réponse à tout, l’excède également. Elle flanque les deux types à la porte. Mais ces deux abrutis ne trouvent rien de mieux que d’aller se bourrer la gueule et de continuer à converser sur le sens de leur vie, sur cette boulimie sexuelle tout en baisant avec deux blondes pêchée en soirée. Ces deux bas du front se remettent à peine en question. Selon eux, l’homme est programmé pour copuler. Il lui est impossible de rester fidèles. De tout façon, seuls les castors peuvent être fidèle, et pour cause, ils ont la queue plate! A la limite, pour ne pas se faire gauler quand on cocufie sa femme, conclue l’un d’eux, il y a un truc implacable :ne pas la tromper! Fin du premier segment sur cette pensée sage. Dans la suite, Dujardin et Lellouche campe deux autres personnages dans un séminaire ou l’handicapé de la boite est le seule à baiser tout ce qui remue pendant que le valide s’avère être un véritable handicapé des relations humaines. Tout le monde se fout de la gueule de ce type pathétique, un branleur qui essaie toutes les combines pour se lever une femme. En vain. Même les hôtesses de joie au téléphone sont aux abonnées absentes. Plus loin, toujours aussi lamentable, on n’échappe pas au segment avec l’homme mur atteint du démon de midi qui oublie son age et sa relation de couple dans les bras d’une jeune, trop jeune étudiante.

Finalement, les hommes en prennent plein leur grade, plus que les femmes. Voilà ce que montre ce film. Il dit aussi que dans tous les cas, que l’on soit un trader qui baise la Grèce le jour et sa stagiaire la nuit ou que l’on soit un déviant qui rêve d’ouvrir une pizza échangiste, on peut tous un jour finir aux infidèles anonymes à confesser ses travers. Même les couples à priori stables ne sont pas à l’abris de l’adultère. Rester plus de 10 ans avec un seul partenaire, ce n’est pas possible. La confiance, la complicité, l’honnêteté, c’est de la blague, des valeurs justes bonnes à exploser une relation stable. Voilà qui a le mérite de susciter la réflexion et pour enfoncer le clou, Dujardin et Lellouche ouvrent une autre piste, laissant augurer que les plus gros baiseurs ne seraient finalement rien d’autre que des homos refoulés. La théorie, aussi saugrenue soit-elle, est intéressante et mérite d’être creusée. Elle l’est dans Les Infidèles, un film à sketch savoureux, délicieux, comme un acte sexuel, avec des préliminaires réjouissants, quelques coups d’accélérateurs sympathiques, des petit passage à vide pour reprendre son souffle de temps en temps, mais surtout des dialogues somptueux. Exemple avec un type qui frappe à la porte d’une nana. Elle ouvre. Il demande : « Ça t'embête si je rentre deux secondes dans ta chatte…. Euh dans ta chambre ! ». et bien non, ça ne m’embête pas du tout de vous incitez à entrer dans une salle de cinéma qui projettera Les Infidèles dès le 29 février, un savant dosage de situations comiques et dramatiques, à ne surtout pas bouder.
extremlly Loud,
Incredibly Close
Extrêmement mou, incroyablement long, comme une fiente!
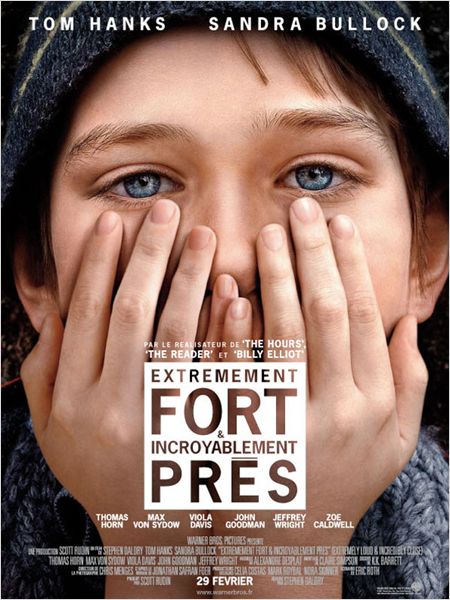
Si le cinéma américain a coutume de suivre pas à pas son histoire guerrière, se souvenir d’Apocalypse Now, la chute du faucon noir, les rois du déserts ou démineur pour ne citer que ceux là, le 11 septembre lui, a à ce jour connu moins de succès que d’autres chapitre comme le Vietnam, l’Afghanistan, l’Irak, ou le retour des GI Joe traumatisés dans leur pays. En effet, si l’on excepte Vol 93 de Paul Greengrass et World Trade Center de Oliver Stone, éventuellement A Cœur Ouvert de Mike Binder, peu de cinéastes se sont aventuré sur ce territoire casse gueule. Sans doute parce que justement, une telle entreprise est aujourd’hui encore trop risquée. Et pourtant, après une décennie, on pourrait se dire que l’on a désormais suffisamment de recul pour empoigner le sujet à bras le corps. Et bien non ! Avec, EXTREMLY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE, Stephen Daldry n’a pas su éviter le piège du tire larme sur le traumatisme du 11 septembre.

Le film s’ouvre sur un homme qui vole, ou plutôt tombe en chute libre au ralenti. On ne distingue qu’une main, une jambe, jamais la tête et encore moins le corps dans son entier. Changement de plan. Sur une musiquette tristounette au piano, la caméra se fige sur un enfant, dans sa chambre qui affiche une moue. Il nous fait part de ses pensées en voix off : « On devrait construire des gratte ciel sous terre pour les morts comme ça ils vivraient juste au dessous des vivants. Il y aurait des ascenseurs. Ce serait tellement plus pratique ». Etrange pensée, presque normale pour un enfant qui a perdu son père et est incapable de faire son deuil. Il faut dire qu’ils entretenaient une relation fusionnelle. Ensemble, ils avaient coutume de jouer aux expéditions de reconnaissance. Ces chasses au trésor était le seul moyen que ce papa avait trouvé pour aider son fils à affronter sa peur du monde, à lutter contre ses phobies. Atteint du syndrome d’Asperger, le gamin extrêmement intelligent, pouvait ainsi aller au devant des gens, leur parler tout en essayant de résoudre des énigmes. Préparant ses expéditions minutieusement à l’aide de cartes, le môme faisait chaque jour des progrès grâce à l’investissement de son papa, jusqu’à ce que deux avions s’encastrent dans les Tours jumelles. Mais depuis le décès de ce père prévenant et attentionné, le gamin n’a plus de motivation. Pire, il accumule une haine grandissante, allant jusqu’à reprocher à sa mère d’être encore en vie. N’empêche que l’espoir va renaitre le jour ou il va trouver dans les affaires de son défunt papa une clé avec une indication : Black. Et voilà comment, il organise en secret de sa maman une dernière expédition de reconnaissance. Il s’obsède à percer le mystère de cette clé. Que peut-elle bien ouvrir ? Et que signifie ce mot, Black? Sans doute est-ce le nom du propriétaire de la clé. Il part donc a la chasse aux indices. Mais son enquête piétine. Allant de rencontre en rencontre, prenant systématiquement des clichés des Black qu’il croise, il continue à faire ce que son père voulait qu’il fasse, affronter la vie et les gens, faire fi de ses peurs et de ses démons. Et si finalement cette clé n’ouvrait rien d’autre que la boite à souvenir? Et si elle lui permettait juste de conserver bien présent dans un coin de sa tête, la mémoire de son père disparu en ce 11 septembre 2011 dans l’une des deux tours du World Trade Center ?

Extremly Loud est un drame dans la plus pure tradition, sans demi mesure ou tout le dispositif consiste à arracher une coulée de larme au spectateur ému par ce gamin qui se débat dans sa recherche. Il veut une explication logique là ou mil n’y en a pas. Il n’est qu’un pauvre petit bonhomme bouffé par le poids de la culpabilité car absent au moment ou son père avait le plus besoin de lui, un pauvre petit bonhomme solitaire qui trouvera un nouvel ami à qui parler en la personne d’un grand père muet, un pauvre petit bonhomme qui finira par se réconcilier avec sa mère brisée par le poids de son chagrin. Les conversations immortalisées sur le répondeur téléphonique de la maison et enregistrées quelques minutes avant que les tours ne s’effondrent feront dresser quelques poils. Mais c’est bien tout. Au final, cette histoire de clé, de recherche entêtée, n’est qu’un prétexte pour raconter une Amérique aujourd’hui encore bouleversée, une Amérique ou tout le monde a été touchée par le 11 septembre, ou tout le monde a perdu ce jour là quelqu’un ou quelque chose. Malgré son sujet, Extremly Loud and Incredibly close est un film extrêmement mou et incroyablement loin de The Reader ou The Hours, les deux précédentes réalisations de Stephen Daldry. En toute honnêteté, si vous souhaitez appréhender le syndrome d’Asperger dans toute sa splendeur, je vous conseille plutôt de voir ou revoir Mary and Max autrement plus brillant et passionnant, un animé en volume de Adam Elliot (aucun lien de parenté avec le Billy du premier long métrage de Stephen Daldry).
CHRONICLE
un Blair Heroes Project ...

La rencontre entre le documenteur Blair witch project et la série télé Héroes, voilà comment introduire le plus directement possible Chronicle, le premier long métrage d’un jeune mec de 26 ans pétri de talent: Josh Trank. Dans ce drame de super héros, tout commence à la manière de Blair Witch, sauf qu’on n’est pas dans une forêt la nuit. Un ado ne quitte jamais sa caméra. Il filme sa vie, toute sa vie. Il ne sait pas si cela peut avoir de l’intérêt, mais qu’importe. Il enregistre des images au kilomètre, sa mère malade, son pote qui l’accompagne au lycée en bagnole, son lycée, le terrain de foot, les apprentis pom-pom girl, une raclée qu’il se prend dans les couloirs par les caïds du coin, une autre correction qu’il se prend à la maison par son père. Donc, il filme tout, y compris, une party à laquelle lui et ses deux amis sont invités. Mais ce soir là, quelque chose va se passer dans un champ voisin. Un trou intrigue ses potes. Ni une, nu deux, les 3 lascars un peu bourrés se jettent à l’intérieur et partent en expédition dans ce conduit caverneux. Au bout de leur chemin, ils découvrent une source de lumière étrange. Et puis, il y a ce bruit aussi, assourdissant. Qu’ont-ils découvert ? On ne le saura jamais, d’autant que le scénariste a la bonne idée de jouer la carte de l’ellipse. On retrouve les 3 amis le lendemain matin. Ils sont en pleine forme. Ils n’ont pas changé, à un détail près, ils ont désormais des pouvoirs. Ils sont par exemple capable d’arrêter une balle en plein vol ou encore de déplacer des objets sans les toucher. D'où ça vient? Sans doute du contact qu’ils ont eut la veille avec cette lumière dans ce trou.

Si la question de connaître l’origine des ces pouvoirs ne les tarabuste pas trop longtemps, c’est surtout celle de savoir qu’en faire qui va titiller nos amis. Et oui, elle est surtout là la vraie question. Pour commencer, on peut s’amuser à flanquer la trouille aux clients du magasin de jouet du coin: un nounours qui quitte son rayon, vole tout seul, et reste figé devant un gamin c’est drôle. Un caddie remplie qui se dirige seul aussi dans les rayons, c’est marrant. Alors que les blagues de potache vont bon train, un premier pépin survient, de quoi obliger les 3 ados à s’imposer des règles et des limites à ne pas franchir. Et c’est là que la comédie glisse gentiment vers le drame. Insidieusement, sans prévenir, on sent que l’un des 3 ados pourraient vriller.

Disons que cette histoire de mettre des limites conduira forcément nos amis sur la voie du bien ou sur celle du mal. Après tout, il est tellement tentant pour un être mal aimé depuis toujours d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour alimenter une vengeance contre le monde entier. Pas facile de ne pas se laisser bouffer en effet par une haine jusqu’alors enfouie. Quand d’un seul coup on a le sentiment d’être immortel, ou tout du moins que l’on est habité par cette impression de puissance indestructible, la tentation est grande de se prendre pour le maître du monde.

Chronicle, c’est la bonne surprise de février, un film de super héros bon enfant et qui devient de plus en plus sombre et obscure après qu’ils aient trouvé la lumière. Si l’histoire on ne plus basique met un peu trop de temps à démarrer, le film vous réservera tout de même son lot de sensation avec par exemple cette scène de baston entre le bien et le mal juste phénoménale avec des autobus qui plannent dans les airs. Pour l’anecdote, Josh Trank a fait le pari d’utiliser au maximum les effets spéciaux en direct sur le tournage. Ce descendant, digne héritier de Méliès aurait pu faire voler dans les airs des véhicules lors du combat final en post production par ordinateur. Et bien non ! ce petit mec ne manque pas d’air comprimé, si je puis dire. En utilisant du gaz, en plaçant des caméras au bon endroit, il a enregistré des véhicules qui volaient pour de vrai à 9 mètre de haut! Le résultat est évidemment beaucoup plus percutant que s’il avait uniquement eut recours à l’informatique.
Et ce n’est pas tout. Pour donner l’illusion que les 3 gamins volent réellement (c’est l’un des supers pouvoir qu’ils doivent apprendre à maîtriser, voler en évitant de se prendre des avions long courrier dans la tronche, parce qu’il y a de la circulation au dessus de nos têtes !), et bien le superviseurs des effets visuels a créer une installation qui reproduit la liberté de mouvement du saut en chute libre. Il s’agit d’une machinerie qui permet aux comédien d’effectuer des vrilles et autres mouvements comme si ils étaient réellement en chute libre. Le réalisme de ces scènes est là encore hallucinant, à l’image de ce petit film qui ne paye pas de mine et a déjà rapporté pas mal de fric à la Fox. Juste le premier WE d’exploitation aux USA, on en était à 22 millions de dollars. Pour un long métrage qui en a coûté 10. c’est plutôt bien. En plus, ces super héros inconnus ont fait la nique à Harry Potter, ou plutôt à l’acteur Daniel Radcliffe, puisque le film d'horreur La Dame en Noir avec Radcliffe a décroché la deuxième place du box-office US en récoltant 21 millions de dollars de recettes ce même WE. Depuis, Chronicle poursuit son petit bonhomme de chemin. M’est avis que la Fox devrait lancé un Chronicle2 prochainement, d’autant que Josh Trank a eut la bonne idée de proposer une fin ouverte, un atout. en cas de succès.
ALBERT NOBBS
Damage!
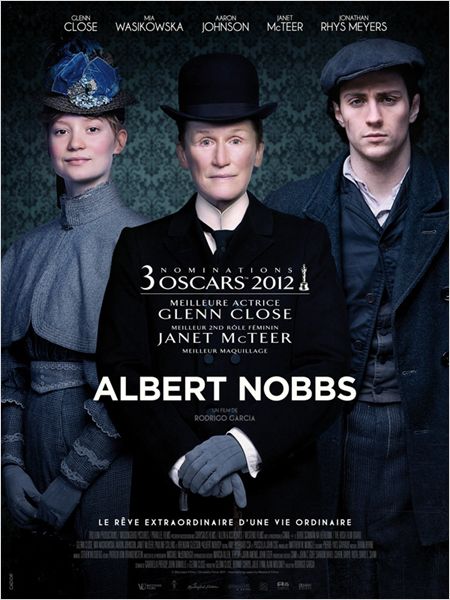
Rodrigo Garcia, réalisateur capable du pire comme du pire, vient de signer un nouveau raté. C'est vrai, si l’on excepte Ce Que Je Sais d’Elle d’Un Simple Regard, sélectionné à Cannes en 2000, récompensé à Sundance, un film qui racontait 5 histoires de femme à Los Angelès avec entre autre un segment ou Glen Close y jouait un toubib à la vie morne et vide, on ne peut pas franchement s’extasier devant le CV du garçon. Pour son long métrage suivant en 2005, Nine Lives, les enchères sont montées. Il a doublé la mise, mettant en image le portrait de 9 femmes modernes en 9 plans séquences avec toujours Glen Close. Avec Les Passagers, un salmigondis fantastico-mystico navrant, il s’est pris pour Night Shyamalan revisitant son 6ème sens avec nettement moins de maestria. Ses affaires ne se sont pas réellement arrangées l’année suivante avec la sortie de Mother and Child. Là, il y a eu déflation puisque Rodrigo Garcia n’a plus eût droit qu’à 3 portraits de femmes face à la maternité. Pourtant, Rodrigo Garcia n’est pas complètement un manche. Le type qui est derrière la Caravane De l’Etrange, Six Feet Under ou la saison 5 des Sopranos mérite un peu de respect. C’est donc avec respect que l’on accueille son nouveau long, Albert Nobbs, Et c’est toujours avec autant de respect que l’on vous invite à passer votre chemin, malgré la présence au générique de sa grande copine Glen Close.

Pour tout dire, ce film ressemble à un caprice d’actrice. Glen Close a déjà joué au théâtre Albert Nobbs. Il s’agissait d’une version épurée de la nouvelle intitulée La Vie Singulière d’Albert Nobbs, un récit de l’irlandais George Moore. C’était en 1982. Depuis, raconte-t-elle, ce personnage, ce rôle n’a cessé de la hanter. Alors, elle s’est mise à écrire une première version d’un scénario. Et puis, elle a investi une somme rondelette dans ce projet de film. Et puis en 2000, elle a trouvé un réalisateur. Et puis, le chantier a été interrompu par manque de liquidités. Et puis, une décennie après, elle a réussi à convaincre une productrice de bien vouloir sortir son chéquier. « C’est le rôle de ma vie. Je dois le faire avant de mourir », lui a-t-elle dit. De quoi se poser bien des questions. Et si après tout, Glen Close était un homme? Pas d’inquiétude, je vous rassure! Déjà que sous les prothèses d’Albert Nobbs, on n’y croit pas une seconde à son personnage, alors sans silicone, il y a encore moins de risque.

Pour celles et ceux, largués, qui ne sauraient pas de quoi il en retourne, je vous rappelle que l’histoire de Albert Nobbs n’est autre que celle d’une femme qui dissimule son identité sexuelle sous les traits d’un homme. On est dans l’Irlande du 19ème siècle, pays en proie déjà à une crise économique sans nom. Pour s’en sortir, et dégotter un travail de major d’homme, cette femme se grime en mec. Pendant une trentaine d’année, la supercherie ira bon train. On ne découvrira son secret que sur son lit de mort. Si, sur le papier, l’histoire peut faire triquer, sur la toile, il en est tout autre. On bande mou! Pourtant, avec un tel point de départ, le scénario de Glen Close, offrait quelques possibilités comme pourquoi pas, une incartade possible dans la comédie. En vain. L’histoire manque sérieusement d’humour pour faire passer une pilule sans saveur. Dès les premières minutes, on ne voit que le visage de cire, figé, de l’actrice. On ne voit que ça. On en passerait presque à côté de cette scène d’ouverture, ou une boniche parmi tant d’autres, dans une maison luxueuse, se bouche le nez alors qu’elle sort d’une pièce, un pot de chambre à la main. En même temps que le service du matin se met en place, on assiste au défilé des serveurs qui accueillent des convives dans une salle à manger. Très vite, on remarque que le préféré des clients est Albert Nobbs. Attentionné, délicat, discret, un peu coincé, toujours à l’affût, les clients l’adorent et le lui rendent bien. Albert collectionne les pour-liches qu’il planque sous le plancher de sa chambre de bonne. Un jour, c’est sûr, Albert aura suffisamment d’argent pour s’acheter la boutique de ses rêves, un bureau de tabac dans lequel on savourera des pâtisseries en même temps que l’on tirera quelques bouffées sur des cigarettes roulées main.

Bref, tout se passe à merveille pour Nobbs jusqu’à ce qu’il doive faire un peu de place dans sa chambre et dans son lit à un peintre venu rafraîchir l’établissement. Il se trouve que ce peintre partage le même secret qu’Albert, mais pour d’autre raisons. Et c’est là que Glen Close s’égare. Au lieu de creuser, de s’enfoncer dans cette brèche, de tirer l’histoire dans cette voie, celle d’une femme homosexuelle obligée de se cacher sous les traits d’un homme pour vivre pleinement son homosexualité, elle se contente de rester sur Nobbs et son rêve de boutique, son envie de vie normale, son désir de séduire une femme plus jeune pour assoire encore d’avantage son mensonge. Ajouter à cela, un personnage d’imposteur, qui ne fait que diluer le vrai propos du film, un jeune margoulin roublard qui a besoin d’argent pour se payer un voyage en Amérique, et qui a remarqué que Nobbs était blindé, et nous voilà devant un raté total. C’est d’autant plus dommage que lorsque Nobbs et sa nouvelle copine peintre enfilent pour la première fois une robe et vont se balader sur une plage, on dirait 2 travelos en goguette! il y avait donc autre chose à développer sur ce sujet, autre chose de moins nunuche, moins austère, moins dramatique, plus fouillé que cette bête histoire d’une pauvre fille bâtarde orpheline, violée à 14 ans et qui depuis se grime en homme pour survivre. Il y avait un film plus couillu à faire. Damage!
IRON LADY
Un biopic
sur le femme de Iron Man...

...Pas vraiment! Je déconne, même si Iron Lady est tout de même une super héroïne avec un seul super pouvoir, celui de faire chier les gauchistes! Iron Lady, c’est la dame de fer, celle qui a tenu à redresser l’Angleterre coûte que coûte et qui n’en avait rien à secouer des syndicats, des gens dans la rue, des manifestations, celle qui par fierté s’en est allé guerroyer aux Malouines. Bref, la dame de Fer dit Margaret Thatcher a les honneurs du cinéma et c’est Meryl Streep qui incarne cette femme. Pour l’anecdote, Meryl Streep vient d’être récompensé d’un Bafta, équivalent des quartz, des césars et autres oscars, mais en Angleterre, Bafta de la meilleure actrice, coiffant ainsi Bérénice Béjo qui était aussi nominée dans la catégorie meilleure actrice pour The Artist. Notez que The Artist a obtenu 7 statuettes sur les 11 distribuées! Dujardin a même niqué Cloney ce qui est peut-être un signe pour une reconnaissance future par les cousins américains! Fin de la parenthèse.

Retour à cette dame de fer, un film qui débute sur une séquence dans un commerce tenu par un pakistanais. Une vieille femme fait ses commissions. Elle achète un berlingot de lait et est surprise par le prix, si cher. Un peu perdue, elle s’en retourne chez elle ou on l’accueille sèchement. Il ne fallait pas sortir sans prévenir, lui dit-on, sous entendant qu’il pourrait lui arriver quelque chose. Et c’est vrai qu’on remarque bien que cette mamie est lucide mais jusqu’à un certain point. Elle est surtout frappée d’hallucination. Le fantôme de son défunt mari l’accompagne partout ou elle va. Du coup, elle discute avec lui, ce qui trouble son entourage et conforte l’idée que cette femme déraille. Cette femme, on le comprend bien vite est Margaret Thatcher. On va donc suivre son parcours, dans les grandes lignes grâce à de nombreux flash-back à répétition. Ils sont souvent succinct. Quand son regard s’arrête sur un objet, qu’elle croise une image dans le journal ou sur son poste de télévision, quand on lui parle de quelqu'un ou qu'un événement survient comme l'attentat perpétré il y a peu par Al Quaïda à Londres, elle s’arrête et pense. Elle se replonge dans son passé et le spectateur de suivre ainsi par bribes les grands moment de sa vie.

Son caractère bien trempée lui vient de son père. Il avait coutume de lui répéter de ne jamais suivre le troupeau, de tracer sa voix et de ne jamais renier ses convictions. Et voilà comment cette étudiante modèle qui travaille dans l'épicerie familiale va se hisser progressivement dans les arcanes du pouvoir après avoir été bien mariée. C’est obligatoire à cette époque. Elle est élue député en 1959. C’est là qu’elle pénètre de plein pied dans un monde d’homme. De plein pied, l’expression est bien choisi puisque son entrée au parlement est filmée à hauteur de talon aiguille. Ça tranche avec les mocassins de ces messieurs. La vue de haut n’est pas mal non plus, une robe bleue isolée au milieu des costumes gris, ça se remarque. Malgré que les hommes la snobent et la prenne de haut, Margaret ne se démonte jamais. Au contraire, grâce à sa pugnacité et à des prises de positions qu’elle défend avec fermeté, elle montre au fil des années, qu’elle a plus de couille que tous les hommes réunis de son parti, une qualité essentielle pour entrer au gouvernement comme ministre de l’éducation. On est alors en 1974. L’Angleterre est en crise, mais Margaret s’en fout. Elle poursuit son ascension jusqu’à atteindre le sommet, le poste de premier ministre le 4 mai 1979, devenant ainsi la première femme de l’histoire à se hisser si haut, autant dire, la récompense ultime pour cette femme qui a sacrifié sa vie de famille pour ses idées, pour son pays et pour le désir de le changer.

Margaret Thatcher, un tyran incarné par une remarquable Meryl Streep. Elle se glisse dans la robe de la dame de fer avec maestria. On ne voit plus l’actrice mais la lady qu’elle incarne, une femme déterminée, tyrannique, on l’a dit. On le voit bien dans la mise en scène de certains conseils des ministres ou elle prend plaisir à humilier les hommes qui l’entourent. Elle les rabaissent plus bas que terre. Mais ses crises d'autorités, sa rigidité, son entêtement, son caractère de cochon auront raison d'elle. Progressivement, ses soutiens la lâchent car elle va trop loin. Mais elle s’en fiche. Elle le dit d’ailleurs : « Trancher dans le vif n'est pas facile mais les générations futures me remercieront », « … Ou t'oublieront », lui souffle son mari. Son mari avait tord. Personne n’a oublié la dame de fer et surtout pas une frange de la gente féminine britannique. Dans le film, on assiste à une scène ou une jeune fille rencontre Margaret Thatcher vieillissante et lui déclare qu’elle est un exemple pour toutes les femmes. Au lieu d’acquiescer, la dame de fer répond gentiment : « Avant on avait l'ambition de faire quelque chose. Aujourd'hui on a celle d'être quelqu'un ». Et c’est tellement vrai, une phrase qui résume à elle seule notre époque.

Iron Lady, un film réussi sur une femme qui fait le ménage dans son appartement et dans sa tête pour se débarrasser de ses fantômes, une fantaisie de gauche selon les enfants Thatcher qui n’ont que très moyennement apprécié ce film de Phyllida Lloyd (réalisatrice de Mamma Mia !) ou les nombreuses archives se mêlent délicieusement aux images de fiction.
BIG MIRACLE
Small movie!

C’est avec un enthousiasme mitigé que l’on annonce la sortie au cinéma de Big Miracle de Ken Kwapis. Et pour cause, quand on parcourt en diagonal le pedigree de l’animal Kwapis, il y a de quoi rester sur la réserve. Réalisateur de séries télé plus ou moins réussies, on retiendra dans le haut du panier: …. Et dans le dessous de ce même panier, on piochera pêle-mêle un remake tristounet de la série anglaise hilarante The Office sans Ricky Gervais, la saison 6 de Urgences, les 5 premières de Malcolm. Coté grand écran, Ken Kwapis s’est illustré en signant quelques pierres angulaires du cinéma US: 4 Filles et Un Jean’s, Ce Que Pensent Les Hommes ou encore Permis De Mariage, sans doute le pire film avec Robin Williams (qui endossait la soutane pour donner sa bénédiction à un jeune couple fiancée). On notera encore L’éducatrice et le Tyran qui malgré son titre évocateur n’a rien d’un film de boule puisqu’il s’agit d’une vulgaire comédie romantique mettant en scène un James Bond au chômage Timothy Dalton et une nounou d’enfer Fran Drescher reconvertie en esthéticienne. En fait, le vrai fait d’arme de Ken Kwapis, LE film que l’on retiendra de cette prodigieuse prolifique carrière entamée au milieu des années 80 est sans aucun doute cette comédie animalière pour enfant plutôt réussie, Dunston, panique au palace. Un gars, un singe et un bon titre qui résume parfaitement l’intrigue de cette comédie enfantine...

Tout ça pour dire que lorsque Ken Kwapis se pointe en 2012 avec un long métrage titré Big Miracle, il ne faut pas vous attendre à un miracle! Au contraire puisqu’il s’est contenter de mettre en image un fait divers très cartésien qui secoua l’Amérique en 1988. Cette année là, dans un petit bled perdu en Alaska, un couple de baleines et leur baleineau blessé ne trouvent rien de mieux que de se laisser piéger par les glaces. Les inuit du coins, une militante écolo, un industriel, l’armée vont se mobiliser sous le regard complice des caméras des journalistes pour sauver Willy… pardon, pour sauvez The Whales!, des baleines promises à une mort certaine. Tous les jours, des millions d’américains resteront rivés devant leur petit écran pour suivre ce feuilleton émouvant. Finalement, alors que la glace n’est pas réellement brisée entre les blocs de l’Est et de l’Ouest, Reagan demandera malgré tout de l’aide de Gorbatchev pour venir à bout du calvaire des cétacés. En pleine guerre froide, un brise-glace russe sera autorisé à croiser dans les eaux américaines et même à faire une brèche sur la côte. En fait, le vrai Big Miracle est là, plus que dans l’histoire du sauvetage des ces géants des mers, dans le réchauffement des rapports diplomatiques américano-russe grâce à l’intervention maligne de la nature.

Pourquoi ? Pourquoi Big Miracle sort au cinéma et pas directement dans le circuit Dvd ou Vod? Qu’une telle nunucherie inonde les salles américaines, passe encore. Vu l’engouement de l’autre coté de l’atlantique en 1988 pour ce fait divers, on peut envisager qu’il y aura un public potentiel pour acheter une place de cinéma et regarder ce film classiquement insipide! Mais en Europe, là ou on s’en tamponne complètement des baleines, là ou cette histoire a tout juste eut droit à un entrefilet dans la presse écrite, on se demande ! Si encore le film possédait un réel cachet! Même pas. Le scénario suit la chronologie des évènements. Les personnages sont des clichés sur pattes. La militante écolo de Greenpeace est forcément intrépide et fonceuse, en opposition totale avec la journaliste urbaine précieuse et arrogante de la télé nationale. Et pourquoi ce ne serait pas le contraire pour une fois ? Bien sur qu’entre les 2 femmes, le cœur du journaliste local, qui a lancé l’histoire, balance. Bien sur qu’il choisira la mauvaise fille avant de se raviser à la fin. Entre temps, les inuit, qui crèvent la dalle sur leur terre glacée, se laisseront attendrir : « Il ne faut pas chasser les baleines car nous allons passer pour des barbares aux yeux du monde », disent-ils. « Et si l’Amérique nous tourne le dos, ce sont les devises us qui disparaîtront pour de bon alors, asseyons-nous sur la tradition et découpons la banquise à la tronçonneuse plutôt que les baleines !» C’est sûr, le dilemme est de taille pour cette communauté. S’ils deviennent des barbare, fini les walkman et les k7 magnétiques de Guns and Roses pour les enfants! Et pourtant, avec 3 baleines de cette taille, on n’en nourri des enfants inuit qui crèvent de faim. Rassurez-vous, ce divertissement ne fait qu’effleurer le sujet. On n’est pas là pour plomber l’ambiance en signant une œuvre réaliste sur les difficultés économiques des inuit et sur la co-habitation délicate, voir le compromis impossible entre acceptation de la modernité et respect de la tradition. Non, dans Big Miracle, on est plutôt du style à faire des parallèles bidons entre le malheur de la maman baleine qui éduque son enfant blessé et le pépé inuit à la surface qui tente d’inculquer des valeurs saines à son petit fils. Il essaie de lui apprendre l’importance de rester à l’écoute de la nature et de la respecter, une leçon dont le môme se tamponne puisqu’il préfère écouter son walkman… A la fin, quand il n’aura plus de piles, peut-être qu’il écoutera les baleines! Je vous passe le couplet sur le riche industriel exploitant de pétrole qui prend fait et cause pour les poissons alors qu’on sait pertinemment que la seule pêche qui l’intéresse, c’est celle au billet vert.

Big Miracle, un drame aquatique déguisé en comédie romantique avec Drew Barrymore qui s’enfonce dans les méandres des productions foireuses au fur et à mesure que sa carrière avance. Depuis 2003 et sa prestation dans Confession d’Un Homme Dangereux de Georges Clooney, l’actrice n’a plus rien fait d’essentiel. Notez qu’avant 2003 aussi! A regarder de plus prêt sa filmographie, si l’on excepte Donnie Darko (qu’elle a en plus produit), Tout Le Monde Dit I Love You de Woody Allen et E.T. ou elle jouait la sœurette de Elliot, on ne peut pas franchement dire que Drew Barrymore ait fait des miracles...
DOS AU MUR
Allez, saute!
Man on a ledge de Asger Leth, un type obscur, étrange qui a collaboré avec Lars Von Trier sur le film 5 OBSTRUCTIONS et qui a eu de la peine à s’en remettre. C’était en 2004. entre temps, il a co signé un doc sur Haiti Ghosts Of Cité Soleil en 2006 et puis plus rien jusqu’à aujourd’hui et cette fiction Dos au Mur, Man On a Ledge en VO avec Sam Worthington, Jamie Bell, Ed Harris, Elizabeth Banks dont le vrai fait d’arme jusqu’à présent a été de jouer la colocataire partenaire baise de Seth Rogen dans Zack et Miri font un porno! Evidemment, ne vous attendez pas à reluquer des scènes salaces dans Dos au Mur. En fait, tout démarre à la réception de l’hôtel Roosevelt, plutôt luxueux. Un homme prend une chambre. Trop tôt pour le champagne; quoique, Il savoure malgré tout une choupettes de bienvenu en même temps qu’il déguste un dernier repas. Ce type prend son temps. Il prend surtout un maximum de précaution pour effacer ses empruntes digitales avant d’ouvrir la fenêtre de la chambre qu’il a loué. Il respire un grand coup puis monte sur la corniche de l’immeuble. Il attend… pas très longtemps ! On est à New York. Souvent, le quidam sur son bout de trottoir qui en a marre de regarder le bout de ses pompes, lève le nez au ciel pour contempler la hauteur des buildings. Très vite, l’un d’eux remarque le gars et allerte tout le monde en criant: « Regardez, un homme sur la corniche, la haut ! » A peine a-t-on le temps de se demander pourquoi ce mec en est arrivé là que le monteur nous impose un flashback. Merci à lui !

On est désormais quelques semaines plus tôt dans la prison de Sing Sing. Ce type est un flic qui purge une peine pour le vol d’un diamant. Il se dit innocent. Après une évasion spectaculaire, on comprend mieux sa nouvelle position inconfortable. Il est désormais prêt à mourir pour laver son honneur. C’est ainsi qu’il requiert la présence sur sa corniche du détective Mercer, une bien belle blondinette, négociatrice hors pair, malgré un récent échec retentissant qui lui vaut depuis les railleries de ses collègues. Qu’importe ! Puisque ce type la veut, elle viendra à son chevet, ou plutôt à sa fenêtre et tentera de le dissuader de sauter. Elle gagnera du temps pour connaître ses motivations et pourquoi pas, finir par l’aider à prouver ce qu’il avance.

Bien sur vous vous demandez certainement comment est-ce qu’avec un argument aussi mince on peut tenir un spectateur en haleine pendant plus de 90 minutes ? C’est vrai quoi: 1 homme, 1 femme, 1 corniche, des badauds qui s’agglutinent en bas de l’immeuble, un périmètre de sécurité, des pompiers, un matelas gonflables, un flashback, des flics qui pataugent, ne comprennent pas qui est ce type, ce qu’il cherche, ce qu’il veut… Et pourtant, ça tient la route, et même plutôt bien! Tout ça grâce à l’inventivité des scénaristes qui ont su maquiller, derrière ce qui s’apparente à un thriller pour prouver l’innocence d’un honnête citoyen, un autre film… En dire plus serait criminel! Pour ne pas gâcher votre plaisir, c’est tout juste si on s’autorise à parsemer quelques détails de ci de là. Il Faut bien mesurer ce que l’on raconte par exemple sur le frère du suicidaire! Oui, il a un frangin et une belle sœur aussi. Ces deux bras cassés de la cambriole, culottés, pas très habiles, se chamaillent régulièrement. Ils ont pour mission de… de…. Dd rien du tout…. Ils sont là dans le décors pour amener quelques respirations, dirons-nous, histoire d’échapper à cette corniche. Bien sur, ce n’es pas vrai ! S’ils sont présents dans ce scénario, c’est qu’il y a une très bonne raison. Mais on doit se taire pour ne pas…. Vous savez, le plaisir, tout ça… bref, vous les briser!

Alors que dire ? Parler peut-être de ce milliardaire mégalo escroc, celui qui a manipulé, ou pas, le suicidaire. Sa fortune pourrait bien partir en fumée, et sa notoriété avec, si le suicidaire, son frère et sa belle sœur arrivent à leurs fins. La fin justement, ça, on peut l’affirmer, c’est la faute de goût par excellence. Sacrifier une si bonne idée sur l’autel du happy end! Quelle chiotte! On ne déflore rien en soulignant qu’il y aura une belle fin. De toute façon, avec les productions américaines, c’est souvent comme ça. A Hollywood, tant que le public test voudra des belles fins, on aura des belles fins nazes! Qu’est-ce que vous voulez, ça rassure le spectateur lambda de voir que le chic type s’en sort, et que le méchant finit derrière les verrous. Contrairement à la vraie vie, le spectateur veut que le gentil obtienne gain de cause. Alors on lui donne ce qu’il réclame. Dommage, car pour atteindre cet objectif, on doit de manière artificielle créer une faille dans un scénario brillant et jusque là, implacable, inattaquable. Un des protagonistes cache un objet dans la poche de son veston alors qu’il était très bien dans son coffre fort… Houps… Gaffe à ne pas tomber dans les travers du film et à couper ce texte au bon endroit, soit 15 mots avant la fin pour ne rien vous dévoiler cette bad Happy-end !
ZARAFA
Un road movie historique!
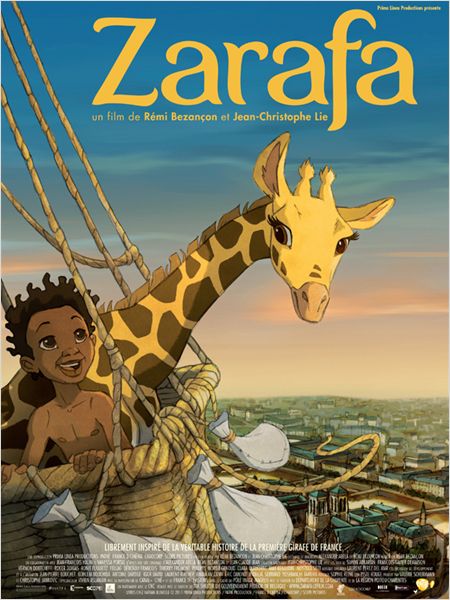
Sorti cette semaine en salle, un animé 2D classique de Rémi Besançon et Jean Christophe Lie intitulé Zarafa. Remi Besançon est connu pour MA VIE EN L’AIR avec Vincent Elbaz qui flippe des avions, LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE avec Gamblin et Zabou ou la vie tumultueuse d’une famille en 5 dates clés. Plus récemment Louise Bourgoin tombait en cloque dans UN HEUREUX EVENEMENT… Rémi Bezançon dit s’être imaginé pouvoir faire tout ce qu’il ne pouvait matérialisé en prise de vue réelle. Voilà pourquoi on le retrouve aux commandes de Zarafa avec Jean Christophe Lie. Lui, il est connu pour un court métrage remarquable, fabuleux, l’homme à la Gordini qui se passe dans les années 70 dans une dictature orange. Tout le monde est obligé de vivre sans slip, sans pantalon avec juste des hauts oranges. Seulement un couple se rebelle et décide de vivre en bleu. Ils seront aidés dans leur combat par l’homme masqué à la R8 Gordini bleue. L’HOMME A LA GORDINI, c’est pas le triomphe des Schtroumpf, tout juste un court métrage qu’on peut se voir sur le web… avec la musique sublime très seventies de DJ MOULE.
Mais revenons à Zarafa avec les voix de Simon Abkarian, Fellag ou encore François Xavier Deamison. Zarafa s’appuie sur une histoire vraie, Tout commence dans cet animé au pied d’un baobab, dans un village africain. Un vieux griot raconte aux enfants l’aventure de Zarafa, un girafon qui fut offert au roi de France, Charles X par le Pacha d’Egypte, un présent pour quémander le soutien de l’armée française afin de bouter les turcs hors d’Egypte, dit-on dans le film. Il faut le savoir, Zarafa serait né en 1825 d'après les calculs de l'époque. La bébé girafe débarqua à Marseille le 14 novembre 1826 et fut conduit à Paris à pied par Geoffrroy Saint-Hillaire, directeur du Jardin des plantes. Trois vaches dont elle buvait le lait, une escorte de gendarmes à cheval, et un chariot à bagages accompagnèrent Zarafa. Arrivée le 30 juin, elle fut pendant 3 ans une des principales attractions de la capitale.

Evidemment, Rémi Besançon a pris des libertés avec cette histoire. Il a fallu insuffler du romanesque, de l’action, des rebondissements, penser à un scénario avec un ballon, un gamin, une gamine, un gros monsieur sympa, des animaux, des beaux décors, des bons et des méchants, une belle pirate Bouboulina et un beau bédouin fort et rusé, un vilain esclavagiste et un gentil marchant margoulin … bref il a fallu tirer sur des ficèles faciles pour donner à voir aux enfants, un leçon d’histoire avec tout de même quelques anachronisme. A un moment, on parle, il est vrai, de donner du lait en poudre au girafon, plutôt que de transporter une vache. Or, le lait en poudre a été inventé par un américain Gail Borden, en mai 1848 ou en janvier 1851… Il y a divergences sur la dates selon les sources. Peu importe, une chose est sure : en 1827, on ne connaissait pas le lait en poudre. Vous me direz que je pinaille, mais il est important d’être précis quand on s’adresse aux enfants, non ? Et j’ajouterais même que cette approximation m’a conduit à poursuivre mon investigation. Le point de départ de ce voyage extra-ordinaire jusqu’à Paris est la bataille d’Alexandrie. Les égyptiens sont assiégés par les turcs et sont sur le point de capituler et d’abandonner leur ville. Voilà ce qui est dit et montré dans le film. Excusez du peu mais ça n’a rien à voir avec l’histoire! La vrai, la voici : en 1798, les troupes françaises dirigées par Napoléon envahissent l’Egypte alors propreté des Ottomans. Soutenus par les Britanniques, les Ottomans envoient une armée pour reconquérir le pays. Les Français se prennent une raclée connu sous le nom de la branlée d’Aboukir, ou la bataille d’Aboukir, c’est égale. Ce qui compte, c’est que Napoléon perd l'Égypte. Les anglais, qui ne veulent pas coloniser ce pays pour garder de bonnes relations avec l’Empire Ottoman, se retirent. C’est alors que Mohamed Ali, pas le boxeur, mais le numéro deux de l'armée ottomane, met à terre ses concurrents et au terme d’une guerre civile est reconnu par le sultan ottoman Sélim III comme gouverneur d’Egypte en 1805. Il y a donc une approximation de 20 ans, 20 ans d’écart avec celle résumée grossièrement dans Zarafa. Ça n’a l’air de rien, mais sans ces clés de compréhension, on se demande bien pourquoi les égyptiens réclament l’aide de la France, et plus encore pourquoi ces amis français refusent de l’accorder! Parce que le girafon Zarafa est envoyé en cadeau à Charles X pour le convaincre d’envoyer des troupes. Et il refuse, ce qui semble incompréhensible.

Evidemment, il n’est pas question de faire un procès d’intention à Rémi Besançon, mais quand on se targue de réaliser un animé pour enfant qui s’appuie sur l’histoire, le minimum est de la respecter, au moins de la résumer correctement. Quand on installe une girafe, une vache, des bons hommes à bord d’un ballon pour gagner du temps sur le voyage, ça passe, même si St Hillaire n’a jamais piloté de ballon dirigeable de sa vie comme on le voit dans ce film! Quand un marchant escroc vend des tickets pour la prochaine caravane en chameau 1ère classe, chameau classe éco ou chameau classe affaire, là aussi, on adhère: l’anachronisme est drôle, mais pour le lait en poudre et le raccourci historique concernant la bataille d’Alexandrie, là c’en est trop !

Ceci dit, parents comme les enfants ne vont pas s’arrêter là en regardant Zarafa. Il est vrai que les chérubins vont apprendre ce qu’était l’esclavagisme. Ils vont appréhender un peu mieux la notion de liberté. Ils vont constater qu’au Royaume de France, on ne se lavait pas les dents, ils vont se marrer avec cet hippopotame qui pète et envoie des jets de caca à la tête des gens. Ils connaîtront sans doute de grandes émotions lorsque la maman de Zarafa mourra, sauvant du coup le héros de l’histoire, le jeune Maki un intrépide aventurier, prêt à tout pour respecter sa parole. Il a promis à la maman de Zarafa de veiller sur ce girafon et c’est pour cela qu’il s’entête à l’accompagner jusqu’à Paris, pour protéger sa Zarafa au péril de sa vie.

Bref, Zarafa reste un animé recommandable malgré tout avec une petite allusion aux tontons flingueurs plutôt discrète et savoureuse. Ça passe par la bande son. Il y a une partition très courte de banjo qui rappelle les tontons. Vous verrez ou plutôt vous entendre ça dans la scène du port de Marseille.
LA TAUPE:
C'est René!

Thomas Alfredson, le réalisateur suédois du sensationnel Morse, l’anti Twilight, change radicalement de registre, et de budget aussi. Lui qui avait eut du mal à rassembler les 4 millions de dollars pour son prodigieux film de vampire ado a reçu un chèque de 25 millions, s’offrant du coup un casting de luxe pour une histoire tout aussi luxueuse. Pensez donc, pour cette adaptation d’un récit de John Le Carré, ex-espion reconverti dans la littérature d’espionnage à succès, Thomas Alfredson a débauché Gary Oldmam, Colin Firth, Mark Strong, John Hurt et Toby Jones. Rien de moins. Tous sont excellent dans la défroque de ces espions agissant dans le plus grand secret en pleine guerre froide.

On est 1973. le MI6 a un problème. Une taupe s’est nichée au sein de l’agence de renseignement britannique. Qui est cette taupe? Que voilà une énigme aussi difficile à résoudre qu’un rébus de pif gadget ! Evidemment, tout le monde la connaît: c’est René, René la taupe! Fin de l’histoire. Il n’y avait vraiment pas de quoi en faire un film! Passé ce calembour facile, laissez-moi vous dire que démasquer la véritable taupe dans cette intrigue pensée par Le Carré ne sera pas si aisé. Qui dit Le Carré sous entend intrigue complexe à moult ramifications et faces à faces bavards ou l’on piège son interlocuteur pour tenter de démêler qui dit vrai de qui dit faux. Dans cette partie d’échec à haut risque ou chaque coup se pense, se réfléchit, les joueurs avancent leurs pions à pas feutré. Il est indispensable d’avoir quelques coups d’avance pour mettre mat son adversaire. Encore faut-il identifier l’adversaire, le cheval de Troie à la solde du KGB qui a infiltré les services de renseignement de sa majesté la Reine d’Angleterre.

Pour tout dire, la partie débute dans un bureau, celui de Control. A la tête du MI6 anglais, il a convoqué dans le plus grand secret un de ses espion à qui il demande de se rendre à l’Est, en Hongrie, sans couverture. La bas, un informateur, en réalité un gradé de l’armée hongroise désireux d’acheter son passage à l’Ouest lui donnera le nom de la taupe. La rencontre se passe dans une petite rue piétonne, à la terrasse d’un café. En quelques plans, Thomas Alfredson parvient à transmettre au spectateur la parano, la peur, l’angoisse, le trouble qui habite les protagonistes de cette rencontre. Chaque geste est épié du coin de l’œil. Il suffit d’une goutte de sueur qui perle sur le front du serveur, d’une envolée de moineaux, d’une femme qui berce son bébé un peu trop rapidement, pour que le temps s’arrête. Dans cette ruelle, tout paraît suspect. Même l’anodin bruit d’une tasse de café tremblotante sur le plateau d’un barman décuple l’angoisse. Les bruitages ainsi amplifiés placent le spectateur dans l’état psychologique fébrile des espions sur leur garde. C’est alors que ce que l’on présentait arrive. Le serveur, dans un élan de panique, sort en furie du café, dégaine un pistolet et tire une première balle. Il bute la femme au bébé avant d’atteindre mortellement l’agent anglais dans le dos. L’informateur, lui, profite de l’agitation pour disparaître. La mélodie d’Alberto Iglésia sur la bande son, typique avec saxo lent et piano léger, renforce encore d’avantage la savoureuse sensation que l’on va se délecter avec un vrai polar, à l’ancienne.

Après ce fiasco Hongrois, Control trouve à son tour la mort. En haut lieu, le ministre des affaires intérieures s’agite. Il convoque Smiley, un proche de Control mis sur la touche. Comme il n’appartient pas à la ‘famille’, le ministre attend de lui qu’il reprenne secrètement l’enquête entamée par Control. Il est impératif de débusquer le traître qui officie au sein du Cirque et transmet des renseignements capitaux à l’Est. Problèmes, cinq membres de l’équipe dirigeantes dont Smiley lui-même étaient sur la liste des suspect de Control. Commence alors pour Smiley une partie ou il devra jouer serrer avec à ses coté la jeune recrue Peter Guillam. Rapidement mis sur la piste de Polyakov, un énigmatique agent russe basé à Londres, Smiley remonte jusqu’à la sexy Irina grâce à Ricky Tarr, un agent anglais, électron libre en cavale, lâché par le Cirque. Ricky apprend à Smiley que Irina voulait elle-aussi passer à l’Ouest et se disait prête à donner le nom d’un agent double. Plus l’enquête avance, plus l’on s’enfonce dans une histoire nébuleuse ou tout le monde pourrait être le coupable. Smiley est surtout rattrapé par son passé. Cet ombre a un nom : Karla, un autre agent russe aux méthodes expéditives. Sans doute que Karla est derrière cette histoire de taupe. Mais si ça se trouve, les russes ont rusé en manipulant les anglais pour mieux avoir accès aux renseignements américains. Mais si ça se trouve, cette histoire est vraie et il n’y a pas une mais plusieurs taupes! Allez savoir…

Loin des standards des films d’espionnages actuelles, La Taupe est un vrai film d’espion d’antan, un film d’inaction par excellence sans pétarade inutile, sans explosions en série, sans gadget ni haute technologie. Ici, les cabines téléphoniques, les bancs publics dans les parcs, les planques dans les hôtels miteux, les acteurs, le scénario et les décors dans lesquels ils évoluent sont les seuls et vrais effets spéciaux. Au passage, la reconstitution du début des années 70 mais surtout la parano qui s’emparait des espions en pleine guerre froide est fidèlement représentée. Compliqué, nébuleux, il faut s’accrocher pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants, pour bien appréhender tous les rouages d’un scénario complexe. On se retrouve finalement comme un espion, à barboter en eaux troubles avant que tout ne s’éclaire une fois le ou les salaud(s) débusqué(s). La Taupe, un film magistra, malgré une fin décevante.
BACHIR LAZHAR
Emouvant et poignant

Québec, la cours de récréation d’une école primaire de Montréal. Un enfant propose à sa camarade d’aller chercher un berlingot de boisson dans la classe. Malheureusement pour ce petit bonhomme, il va voire quelque chose qu’il n’aurait jamais dû voir. Dans la salle, le corps de sa maîtresse, Martine Lachance se balance au bout d’une corde. L’enseignante s’est pendue. Immédiatement, une cellule psychologique est mise en place pour soutenir les enfants. Dans l’établissement, élèves, professeurs, directrice, tout le monde est abasourdi par la brutalité de la situation. Pourquoi Martine a-t-elle commis cet acte sur son lieu de travail ? Cela doit bien signifier quelque choses. Le choix de se donner la mort dans sa classe n’est pas anodins. Mais plutôt que de se poser la question, le corps enseignants, ainsi que les parents d’élèves font tout pour que la vie à l’école reprenne le plus normalement possible. Désarmés, ils ne comprennent pas le geste de leur collègue et amie. Ils ne comprennent pas ou ils refusent de comprendre? Il y a une nuance de taille et bientôt Bachir Lazhar va la découvrir.

Bachir Lazhar est l’homme providentiel, celui qui se présente spontanément à la directrice après avoir lu la nouvelle dans le journal. Il propose de jouer les remplaçants en attendant que l’administration n’envoie quelqu’un officiellement. Bachir Lazhar dit avoir des références. Il a déjà fait la classe, autrefois, en Algérie. Devant l’urgence de la situation et parce que ça la dépanne, la directrice accepte de confier le poste à ce migrant qui présente bien. Bachir se met rapidement au travail. Sa première mission est de tenter de faire oublier Mlle Lachance aux enfants. Il modifie la disposition des tables mais ça ne suffit pas; de même, un coup de peinture sur les murs ne permet pas aux enfants d’ignorer la place ou elle s’est pendue. Il faudrait déplacer tout le monde mais c’est impossible. Qu’importe, Bachir Lazhar s’active à donner ses cours, à faire la dictée. Même si avec Bachir Bazar (nouveau surnom de l’enseignant), y a pas de devoir, ses méthodes archaïques en matière d’enseignement n’emballent pas plus que ça les enfants. On en vient même à douter que Bachir ait été un jour maître d’école. C’est que ce professeur ne fait pas la différence entre enseigner et éduquer. Il se prend plus pour un père qui transmet des valeurs à ses enfants que pour un professeur qui transmet un savoir à des élèves. De plus, ce modèle d’enseignement ou on ne doit pas avoir de contact avec un enfant, lui échappe complètement: pas de claque même quand c’est mérité, pas d’accolade même quand le besoin de réconfort se fait sentir. La rigidité et la déshumanisation de ce système éducatif dépasse cet algérien. D’autant qu’en Afrique du Nord, beaucoup de choses passe par le geste. Là bas, on est tactile. Pas au Québec. Il ne faut pas, jamais, toucher un enfant. Faisant contre bonne fortune bon coeur, Bachir, cet amoureux du verbe, met un point d’honneur à ce que les enfants s’expriment correctement. Il faut savoir parler, lire et écrire. C’est important pour exprimer par exemple ce que l’on ressent face au décès de Mlle Lachance. Mais là encore Bachir a oublier qu’au Québec, la mort est tabou. On n’en parle pas, jamais, avec les enfants, sauf avec la psychologue. Décidément, ces écarts vont mettre le doute à la directrice . Bachir est-il l’enseignant qu’il prétend être? Qui est ce Monsieur Lazhar, ce Bachir Bazar que les enfants ont fini par adopter ?

MONSIEUR LAZHAR, un film émouvant à plus d’un titre, Certes, si la question du deuil est au centre de l’intrigue, la véritable force du long métrage de Philippe Fallardeau est de pointer surtout les failles dans la société canadienne d’aujourd’hui, à commencer par la rigidité de l’école. Le suicide de l’enseignante n’est finalement qu’un prétexte pour montrer la froideur extrême des méthodes d’éducations québécoises. A l’école, il n’y a plus aucune humanité. Les maîtresses sont des machines à enseigner, des robots dont la mission est de bourré le crâne des enfants. Il n’y a plus de place pour les sentiments. Quand un gamin est au plus mal, qu’il a besoin de parole douces ou de la chaleur d’un ou d’une adulte, cet enfant est condamné à rester sans réconfort. Un enseignant n’a pas le droit de consoler un môme en le serrant dans ses bras sans que l’on pense à mal. Il suffit d’une accolade pour que l’on soupçonne l’adulte de pédophilie. Bien sur qu’il faut être vigilant, mais on a visiblement atteint un extrême intolérable. Et dire que ce modèle a été mis en place par des femmes! C’est là sans doute l’autre point que le cinéaste veut dénoncer dans son film. La société canadienne s’est féminisée plus que n’importe où ailleurs sur la planète. Mais au lieu de construire un monde ou femmes et hommes vivraient en harmonie, d’égale à égale, elles sont tombées dans les mêmes travers que les hommes. Non contente d’avoir émasculer la gente masculine, les femmes ont castré les enfants en les privant de l’essentiel, l’expression tactile des sentiments. A force de voir le mal là où il n’est pas, elles ont fini par créer un autre mal. La preuve en est, le suicide de Mlle Lachance au début du film. Bachir Lazhar en débarquant dans cet école dont il ignore les codes, va ainsi devenir malgré lui le trublion remettant en cause ce système d’éducation, amenant certaines femmes à ouvrir les yeux.

Le film évoque encore une autre thématique, importante, la migration. Qu’est-ce qu’un migrant ? Selon Bachir, un être déraciné dans un pays dont il ignore la culture, un clandestin sans papier obligé de se débrouiller pour survivre. Selon les autorités, un profiteur potentiel qui ne devrait peut-être pas se trouver sur le sol canadien à moins d’avoir une bonne raison pour demander l’asile. Pour une des collègues de Bachir, un homme avec qui on doit manger, boire, parler, partager pour apprendre à se connaître car de la connaissance de la différence née la richesse. En connaissant bien son voisin, on apprend à se connaître soit même. Mais Bachir est un être discret, qui ne se confie pas facilement, un type bourré de paradoxes aussi. Il voudrait que les enfants parlent du deuil, alors que lui, dissimule le sien, ne l’exprime pas, jamais. C’est aussi ça un migrant, quelqu’un de discret, digne mais discret, qui estime ne pas avoir le droit de se plaindre. Fellag incarne Bachir Lazhar. Voilà qui n’est pas étonnant, tant le parcours de Fellag, la star algérienne, a des résonance avec celui de Bachir. L’acteur, auteur, metteur en scène, directeur de théâtre, humoriste, oneman showman a connu l’exil, comme Bachir. A deux reprises, il s’est expatrier d’Algérie. A la fin des années 70, parce que la situation est devenue impossible pour les artistes, il a fuit au Québec, avant de s’installer en France. Et puis, pour monter un spectacle dans les 80, il est retourné en Algérie. Il devait y rester quelques semaines. Il y restera plusieurs années avant de fuir une nouvelle fois, alors qu’une fatwa avait été lancée sur sa tête. A cette époque, dans les années 90, dit-il, « il y avait des fatwa sur tout le monde. Le pays, aux portes de la guerre civile, était devenu invivable ». Fellag a donc quitter une nouvelle fois l’Algérie. Bien sur que dans le film, on parle de ça, du chaos qui a secouer ce pays et de la réconciliation nationale qui a suivi. C’est sans doute pour toutes ces raisons, ces thématiques soulevées, la manière dont tout cela est traité et mis en image que le public à plébiscité Monsieur Lazhar, le 4ème film de Philippe Fallardeau au festival de Locarno 2011. Récemment, les professionnels aussi repéraient ce film puisque Monsieur Lazhar a été retenu pour participer à la course aux Oscars. Remportera-t-il une statuette? Verdict le 26 février.
TAKE SHELTER
un chef d'oeuvre
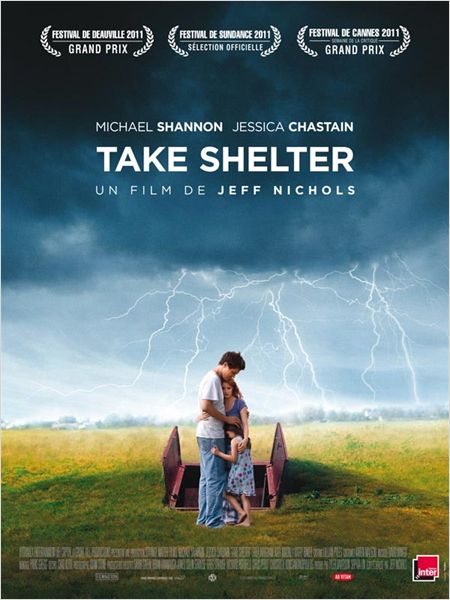
Il y a 4 ans déjà, Jeff Nichols avait surpris son monde avec SHORTGUN STORIES, un film tout en plans fixes sur le thème de la vengeance avec une réelle tension imprimée justement grâce à une certaine immobilité. On disait à l’époque que Jeff Nichols était un américain à suivre. Alors forcément, maintenant que TAKE SHELTER est annoncé, vous allez le suivre et vous ne serez pas déçu! Cette fois, exit la vengeance et vive la peur aigu à cause des tempêtes tropicales. Il faut dire que dans le midwest, quand Dame Nature se déchaine, il y a de quoi se faire de belle frayeurs. Nos ridicules orages de grêles n’ont rien à voire avec les déluges qui s’abattent sur l’île. Dans le cas de Curtis, cette peur va virer au cauchemar, aux crises de panique à répétition

Marié, père d'une adorable petite fille sourde, Curtis travaille sur des chantiers. Dés le début du film on ressent son angoisse lorsqu’il pointe le regard vers un ciel menaçant. Et puis, la nuit aussi. il voit des choses terribles comme des éclaires qui fendent le ciel, des gouttes de pluie brunes, des tornades en formation ou des oiseaux tout droit sortis d'un film d'Hitchcock qui lui foncent dessus. Etranges rêves que ceux de Curtis. Et plus son délire s'accentue, plus ses cauchemars confèrent au fantastique. En plein déluge, des hommes en veulent à sa vie et à celle de sa fille. Régulièrement il se réveille en sursaut, en sueur. Des fois, une flaque de pisse inonde son lit. Plus le récit avance, plus rêve et réalité se confondent, au point parfois que l’on ne fasse plus exactement la différence. Elle est là la force deJeff Nichols. Il nous invite sans prévenir dans la tête d'un mec qui perd pied. Curtis hallucine tout debout en pleine journée Rêve-t-il éveillé ou vit-il ces situations extrêmes? On a un doute et c’est troublant. Son entourage remarque évidemment ce comportement étrange. Ils s’interrogent. Pourquoi a-t-il construit un enclos dans le jardin pour y installer son inoffensif berger allemand? S’ils avaient fait le rêve de Curtis ou il se fait dévorer l’avant bras par le cleps, ils auraient sans doute aussi construit un enclos ! Le rêve semblait tellement réel qu'à son réveil Curtis ressentit la douleur. Sa folie va crescendo et dans un excès tout aussi intense, Curtis va s'endetter pour construire cette fois un abris anti-tempête avec l'eau courante, les toilettes, la lumière, les masques à gaz et les boîtes de conserves en pagaille pour se nourrir. Curtis a-t-il un grain ? C’est possible. Y a des antécédents familiaux. Sa mère l'a abandonné sur le parking d'un supermarché dans la voiture quand il avait 8 ans. On a retrouvé cette femme 8 jours plus tard dans une autre ville en train de manger des ordures dans des poubelles. Depuis elle est internée dans un institut spécialisé. Peut- être que la folie de Curtis est héréditaire! A moins que ces délires n'aient une autre origine...

Take Shelter est un film envoutant. Jeff Nichols le virtuose, de part sa mise en scène et sa mise en image, ses éclairages, de par la précision des cadrages, vous scotche. Il vous prend par le colbaque dès le début et ne vous lâche pas jusqu’à la fin de son métrage. On est happé par cette histoire, par cet homme, par ces actes, par les caprices de la nature qui se déchaine…. L'empathie fonctionne à plein régime avec ce mec car on refuse de croire qu'il est dingue. C’est un film saisissant,d’une rare beauté. On appelle ça de l’art, le 7ème, ou plutôt le deuxième film d’un cinéaste pétri de talent à tel point qu’on lui pardonnera une scène de trop quelques minutes avant le dénouement et qui vient gâcher un peu la fin, une faute de goût vite oubliée tant tout ce qui précède est d'une qualité exceptionnelle. TAKE SHELTER de Jeff Nichols avec Micheal Shanon et Jessica Chastain aperçu dans le film de Terrence Malick, The Tree Of Life ou là aussi, la nature a son importance. .
RECONCILIATION: MANDELA'S MIRACLE
l'Apartheid pour les nuls
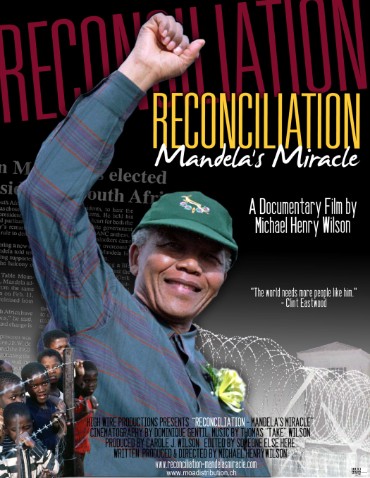
11 février 1990, 16h15 heure de Johannesburg, Nelson Mandela sort de prison après 27 ans d’incarcération.
1er février 2012 Réconciliation Mandela’s Miracle sort au cinéma, un documentaire de Michael Henry Wilson qui retrace dans les grandes lignes les différentes étapes de l’apartheid. Le documentariste s’arrête surtout sur ce qui s’est passé entre ce 11 février 1990 et les années de réconciliation nationales qui ont suivi. Le film se présente comme une formidable leçon d’histoire découpé en chapitres. On débute par L'apartheid pour les nuls et l'arrestation des leader. S’en suit une partie intitulé D'oppresseur à partenaire avant la plus passionnante, celle titrée Reconstruire une nation .

On commence donc par rappeler qu’en 1964, Mandela le chef historique de l’ANC est condamné à la prison à vie pour trahison, participation à des actes terroristes alors qu’il dirige la lutte contre le régime de l’apartheid. Depuis cet incarcération, il devient le symbole du combat pour la liberté des Noirs en Afrique du Sud. Après 27 ans de prison, 9377 jours de privation de liberté, le président Frederik De Klerk lui ouvre les portes de son cagibi et signe l’acte de libération du prisonnier politique le plus célèbre au monde à cette époque. Malgré tout, les massacres continuent. Mandela et De Klerk entament un bras de fer, une négociation rude et âpre. Les afrikaners ne veulent pas entendre parler d’égalité entre noirs et blancs. La situation est explosive et le pays est au bord du gouffre. Pour éviter la guerre civile et le chaos, le président De Klerk est obligé de lâcher du leste. Il abandonne le pouvoir politique à Mandela mais conserve le pouvoir économique. Voilà comment fin avril 1994, Mandela est élu président de la République sud-africaine, juste après avoir obtenu le prix Nobel de la paix avec De Klerk. Immédiatement, il veut s’attaquer à un symbole de l’apartheid pour réunifier son peuple. En choisissant le rugby, un sport de blanc, Mandela prend un pari gonflé. Et ça marche. Pour la première fois, des noirs et des blancs sont au diapason et vibrent en cœur. Un vent d’euphorie souffle sur tout le pays et porte les Springbox jusqu’en final de coupe du monde qu’ils remportent. Juste avant ce match, Mandela envoi un signe clair au sud africain en apparaissant en public, dans le stade, arborant le maillot vert des Springbox et la casquette du supporter, deux symboles du racisme des blanc envers les noirs. Ce geste a fait plus de bien et a eu plus d’impact sur la population que tous les discours prononcés jusqu’alors sur l’unification. Bien sur, ces images, on les a vu dans INVICTUS de Clint Eastwood. L’inspecteur Harry a signé en 2009 ce film avec Morgane Freeman en Mandela et Matt Damon en capitaine des Sprinbox. Clint apparaît logiquement dans le documentaire de Michael Henry Wilson. Normal puisque les deux films ont été tourné en parallèle. En plus, ils sont amis de longue date. Clint a ainsi permis à Wilson de reprendre des images du making of de INVICTUS, une aubaine pour le documentariste. Il lui aurait été Impossible, pour des raison de cout exorbitant, de reprendre des images de la coupe du monde de Rugby sud africaine. Ainsi, Clint Eastwood avoue son admiration pour Mandela. Mais il n’est pas le seul a parler de ce grand homme. Le truculent Desmond Tutu y va aussi de ses réflexions. Le discret De Klerk a également accepté de jouer le jeu, s’attardant sur les qualité indéniables de négociateur pugnace qu’était Mandela. Il ne lâchait rien. A noter que Michael Henry Wilson évite le piège de nous montrer un Mandela vieillissant. Absent du film, il est tout de même présent par le biais d’archives. De toute façon, atteint d’alzheimer, sur le déclin du haut de ses 94 ans, il aurait été bien incapable de raconter quoique ce soit. Autant reprendre des archives nettement plus parlantes. A propos des archives, elles sont nombreuses.

En plus de ces entretiens, on découvre en effet tout un florilège d’images rares. C’est l’une des curiosité de l’apartheid. Partout ou il se passait des choses, des attentats, des accrochages, des manifestations réprimées dans des bancs de sang, la télévision était présente. Michael Henry Wilson a du faire le tri devant les kilomètres de bobines auxquels il a eut accès. Ceci dit, le film vaut surtout pour sa dernière partie, celle ou l’on s’attarde enfin sur la réconciliation. En effet, faire la fête après avoir gagné une coupe du monde de rugby est une chose, mais cela ne résout pas les problèmes. Passé la liesse, il faut se mettre au travail. Des procès ont eut lieu juste après cette victoire. Mandela a mis en place un comité de réconciliation pour aider les familles à faire leur deuil. Bourreaux et victimes se font face dans ces procès dont certaines images émouvantes sont reprises dans le film. Toutefois, seuls les sous fifres ont été jugé, pas les têtes pensantes de l’apartheid. Jamais les dirigeants n’ont eux à s’expliquer devant ces comités. Pire, après plus de 15 ans de tentative de réconciliation, le constat est amer. En Afrique du Sud, les noirs crèvent toujours autant de faim. Quant au partage des richesses, il n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas prêt de l’être.
CORPO CELESTE:
Gros prout céleste !
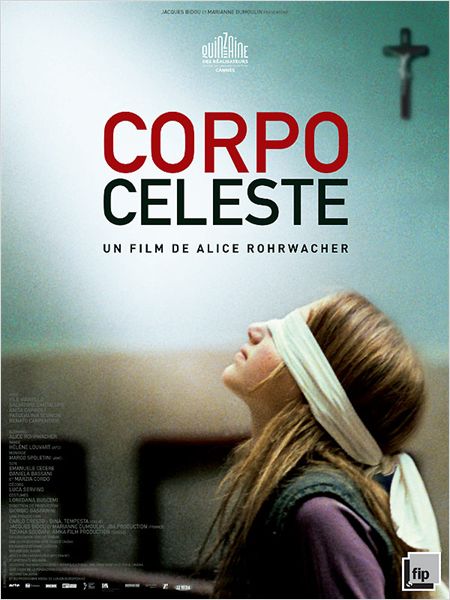
CORPO CÉLESTE sortira demain en salle, Corpo Céleste que l’on peut rebaptiser sans autre: Gros prout céleste, tant la place de ce film est dans la cuvette des toilettes, avec la Vérité si Je mens… Ben oui, y a des semaines comme ça ou on se dit que la cinéphilie a du plomb dans l’aile… Dans Corpo Céleste, tout commence la nuit. Camera épaule, le cadreur suit un groupe de gens. ils reprennent en cœur un chant de messe. On est visiblement en plein milieu d’une procession nocturne… Le lendemain, au même endroit, on installe une estrade. Une poignée de personnes se tient devant un curée qui demande à son assistance de faire le silence en attendant qu’un éminent personnage n’arrive. On se dit que le film va réellement démarrer ici. Et puis non, une voiture arrive, un type descend, bénit la foule et hop, plan suivant

On est dans un cours de catéchisme. Avec des élèves nulles et une bigotte désespérée qui leur fait la leçon. Elle a des méthodes bien à elle, un peu étranges. Là, on se dit que le film va enfin démarrer. Il peut devenir intéressant, mais non, finalement, pas de gag, pas d’altercation, rien! On assiste, comme Marta, l’une des élèves un peu dubitative, à un cours de bondieuserie hyper chiant… On est anesthésié, comme les élèves en attendant avec impatience le plan suivant… Le voilà, il arrive. Marta rentre à la maison. Elle colle sa mère, lui bouffe toute son énergie ce qui provoque un conflit avec sa sœur. On se dit que le film va enfin démarrer, Il peut devenir intéressant, mais non… Dommage car il y a un petit suspens car Maria du haut de ses 13 ans découvre les soutif. Elle a piqué un soutien gorge à sa sœur et se cache pour l’enfiler. Elle risque bien d’être démasquer par sa grande sœur... on en tremble car la sœur de Maria, Rosetta n’est pas commode. Je vous rassure, cette Rosetta n’a aucun lien de parenté avec la Rosetta des frères Dardennes… Il ne faut pas exagérer. Alice Rohrwacher n’a rien à voire avec les deux belges et leur cinéma social. Et c’est sans doute là ou le bas blesse. Le cinéaste passe complètement à coté de son film, du vrai sujet… Voila pourquoi son film ne démarre jamais !

Il y avait pourtant matière avec un personnage pas net, à savoir le curé. On aurait pu raconter les liens obscures entre le curé et la mafia, un curée carriériste qui rêve d’être muté dans une grande ville, un curé qui ne sait rien de la bible, un curé qui est plus préoccupé par l’élection du candidat qu’il supporte aux élections municipales que par Dieu, un curé tellement admiré par la bigotte qu’il pourrait y avoir une histoire de cu… de curé qui résiste à la tentation parce que la bigotte est quand même un peu laide… Mais non… on survole vaguement ces thématiques. Alice Rohrwacher suit une autre voix, celle de cette gamine dans son quotidien, une môme qui bouffe des plats surgelés, n’aime pas le poisson, fait des papouilles à sa maman, va au caté, s’engueule avec sa sœur, contemple le terrain vague depuis la fenêtre de sa chambre et se pose des questions quant aux 3 garçons qui ramassent des objets dans ce terrain… Il y a bien un moment ou elle prend une paire de claque par madame bigote… C’est le tournant du film, un tournant à 1 degré, puisqu’après cette gifle, on repart sur le même tempo avec l’assassinat de 6 chatons… C’est horrible et la recherche d’un crucifix dans un village abandonné...

CORPO CELESTE, un film qui n’aura pas ma bénédiction, un film même pas consternant… C’est ce qu’il y a de pire… ben non, c’est juste un film inutile, qui ne sert à rien, ni à divertir, ni à informer, ni à émouvoir. D’aucun apprécieront peut-être ce coté naturaliste dans la manière de filmer, une approche brut de décoffrage, parfois proche du documentaire pour montrer la réalité de cette gamine, mais comme au bout de 10 minutes, son quotidien à Marta, on s’en fout, ben y a finalement rien à sauver. Enfin bref, si ce résumé vous a ennuyé… rassurez-vous, ce n’est rien en comparaison du film CORPO CELESTE qui sortira demain en salle!
LA VERITE SI JE MENS III:
La vérité si
je m'en tamponne!

Pas d’ambiguité possible, cette entreprise a été frappée du syndrome Bronzés 3! Quand on repense aux propos que Gilbert Melki avait tenu dans des interviews, il y a 3 ou 4 ans, promettant que l’équipe se reformerait uniquement sur la base d’un bon scénario et qu’on voit le résultat aujourd’hui, on est dépité. On ne peut même plus faire confiance à Melki, acteur pourtant intègre, toujours très bon. Notez que c’est peut-être celui qui s’en tire le mieux dans ce coup ou plutôt ce gros cacou…commercial. En toute honnêteté, on ne rit pas une seule fois. Il n’y a pas une situation comique, pas une ligne de dialogue drôle, pas une idée de mise en scène, pas de directions d’acteur… rien, c’est le désert absolu! Seul le générique d’ouverture vaut le détour. Payer 18 balles pour 3 minutes de bonheur, ça fait cher, mais tout de même, avec ces couleurs kitchs, on est dans un film de Bollywood. Ça danse, ça chante. C’est sublime… passer ce générique, bon courage pour supporter des mecs qui récitent des kilomètres de dialogues insipides, sans saveur, sans odeur. Même le bêtisier lorsque le film sortira dans 3 semaines en dvd, ne sera pas drôle… D’ailleurs, dès la première scène, on renifle l’arnaque. On prononce 4 fois en 4 phrase, la vérité, la vérité si je mens… je sais que c’est la vérité que je suis venu voir, c’est bon. Ça va! Je sais que c’est pas Coco avec Gad Elmaleh… Quoique… très vite, on se demande… On est dans une bamboula organisé par le flambeur José Garcia qui veut en mettre plein la vue à l’assemblée. Il a un coté coco sur ce coup là. Enfin bref, il veut en mettre plein les mirettes à la famille et il s’avère qu’il est sur la paille. Son traiteur est sur le point de le lâcher. Un chèque sans provision plus loin, tout s’arrange ! Tout s’arrange, sauf pour les dialogues ou l’on surprend une dame dire à une autre :
- Ou allez vous en voyage ?
- aux échelles, répond l’autre…
Dans cette même fiesta, une femme parle à une autre et demande :
-C'est qui le jardinier de Versailles ?
-C'est LE NOTRE
-Quelle mytho celle la…
Ouais !!!!! Enfin un sourire après 20 minutes de film, mais ça ne va pas durer. Et non, tout de suite derrière, on voit José Garcia qui prend Danny Brillant pour Julio Iglesias, qui se débarrasse d’un gâteau au chocolat en donnant une petite tape dans le dos à un ami discrètement.C’est du vu, revu et même pas corrigé. On se demande ce que le roi de la mise en pli Frank Provost vient foutre là. Autant pour le toubib de France5, Michel Cimez qui joue son rôle, oui, mais Frank Provost…. Je veux pas couper les cheveux en 4, mais c’est étrange.

Donc, toutes les 15 minutes, on regarde la montre en se disant : mais j’ai toujours pas rit… On culpabiliserait presque! Pour patienter, on pense à ce que l'on va manger ce soir, à la machine à laver qu’il faudrait faire tourner demain, auxs factures impayées, au gamin qu’il faudra récupérer chez la nourirce, à ce que ça va couter… On en viendrait même à regretter le temps ou il y avait des entractes au cinéma pour pouvoir se barrer et rentrer plus tôt à la maison. Le constat d’échec est évident. C’est vrai que pendant une comédie, si on n’arrive pas à oublier nos problèmes, c’est que c’est foiré ! Si vous aimez cramer votre fric n’importe comment, allez voir cette daube. Sinon, gardez vos sous pour Take Shelter
SHERLOCK HOLMES
Elémentaire
mon cher Ritchie!
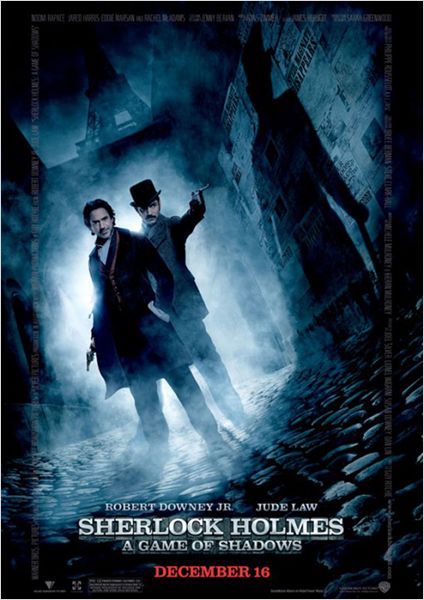
Guy Ritchie n’est jamais aussi bon, aussi bien inspiré que quand il réalise une aventure de Holmes. Ce constat s’était déjà imposé en 2010 lorsque le grand public accueillît avec enthousiasme le 1er volet d’une franchise s’annonçant lucrative. Holmes avait rapporté 516 millions de dollars à travers le monde. L’enthousiasme se lisait donc sur les visages des producteurs et des spectateurs surtout, ravis par le duo Robert Donney junior – Jude Law dans la défroque des célèbres Shelock Holmes et docteur Watson. Guy Ritchie avait su, tout en conservant l’esprit original des romans de Conan Doyle, apporter cette pointe de modernité dans la réalisation, dans l’enrobage. Et bien figurez-vous que l’enthousiasme n’a pas faibli. C’est toujours avec bienveillance que l’on accueille ce deuxième numéro, et pour cause, pusique que la formule n’a pas changé ! On prend les mêmes ingrédients, les mêmes vedette et on recommence, sauf que cette fois, l’aventure est sous titré en toute logique: jeux d’ombre, tant il est vrai que l’ombre de James Bond plane au dessus de Sherlock Holmes! Et pour cause, le détective privé loufoque, à l’œil aiguisé à qui rien n’échappe, rappelle par certains égards l’agent secret au service de Sa Majesté. Équipé de son seul et unique gadget Watson, Holmes va devoir éviter l'effondrement de l'occident, rien de moins, une mission à la James! La menace est bien réelle et Holmes devra se débattre dans cette partie d’échec musclée, avancer à pas feutré pour démasquer l’impitoyable professeur Moriarty, excellent Jarred Harris, et l’affronter en un duel final aussi physique que cérébral.

Pour tout dire, dans cette nouvelle aventure, exit la magie noir et le tueur en série Lord Blackwood et vive le véritable géni du mal, le professeur Moriarty. On est en 1891, des attentats à la bombe à Strasbourg et à Vienne, attribués à des anarchistes ou à des nationalistes, font monter la tension entre la France et l'Allemagne. En Inde, un magnat du coton est ruiné par un scandale. En Chine, un trafiquant d'opium décède d'une overdose. Aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient de mourir lui aussi. Tous ces événements n'ont aucun lien entre eux sauf pour Sherlock Holmes, qui a accumulé un faisceaux d’indices. Ses recherches l’ont conduit à suivre la troublante et désarmante Miss Adler, qui finira empoisonnée. Le mystère s’épaissit pour Watson, pas tant pour Holmes qui sait déjà qu’il doit se rancarder auprès d’une voyante, Madame Simza, pour y voir plus clair. C’est au cours de l’enterrement de vie de garçon de Watson que la rencontre aura lieu. Et oui, Watson, au grand regret de Holmes se marie. Terminé leur complicité pense-t-il, mais ça n’empêchera pas les deux amis de se beurrer la tronche la veille du grand jour avant de prendre le premier train en partance pour Paris. C’est ici que mène la piste Simza, dans un camp de gitan, à Montreuil...

Avec son scénario limite incompréhensible, pour cause de rebondissements trop nombreux, ces nombreux pays visités, cet humour so british et ses scènes d’action démesurés, ses combats au corps à corps au ralenti et en accéléré, ces explosions en cascade, ces balles perdues, ces grosses bertha, ces petites femmes bien belles, son méchant mégalomane et son héros peu ordinaire, ce JEUX D’OMBRE a plus d’un atout dans sa manche pour affoler le box office. Le film est bien parti pour exploser les recette du premier volume! Les spectateurs apprécient Robert Donney Junior. Il faut dire qu’il s’en donne à cœur joie en incarnant Holmes, ce héros peu ordinaire qui arbore une barbe de trois jours, avoue un net penchant pour l'alcool et un goût prononcé pour la bagarre. Il est étrange ce Holmes, Pour vivre dans un appartement débordant de plantes tropicales au milieu desquelles cohabitent une chèvre et un serpent, il faut être torud. Ce célibataire endurci à la misogynie parfaitement assumée mais aux penchants homosexuel non assumé (on peut se poser bien des questions quant à sa relation et son indéfectible amitié envers Watson) a également un petit faible pour les déguisements. Il adore se grimer en femme! Etrange, non? N’empêche que Holmes est un chasseur hors norme partie à la pêche à la truite. Schubert n’a qu’à bien se tenir. Don Giovanni aussi. Oui, de l’opéra, Garnier ou non, de la grande musique, il y en a dans cette nouvelle partition réjouissante écrite et réalisée par Guy Ritchie, SHERLOCK HOLMES, JEUX D’OMBRE, un pure divertissement ou l’on n’a pas le temps de souffler, et encore moins celui de s’ennuyer, 2 heures de pure aventure.
CAFE DE FLORE
Attention, addition salée

C’est curieux comme la réalité a des résonances parfois avec la fiction. Regardez Vanessa Paradis qui risque de perdre son Jhonny Deep de compagnon pour cause de jalousie excessive. Je suis pas le roi du potin, mais je me suis laissé dire qu’elle avait fait une scène parce que Johnny voulait à tout prix jouer dans le prochain Tim Burton avec Eva Green. Et Vanessa a pété un plomb… enfin bref, Tout ça pour dire que la jalousie, et précisément le personnage campé par Vanessa Paradis bouffé par la jalousie est au cœur du film CAFE DE FLORE de jean Marc Vallée. Evidemment, on connaît la brasserie au moins de nom. Qui a déjà foulé le bitume du boulevard St Germain à Paris, au cœur du quartier de St Germain des Pré a forcément assis son cul sur une chaise en paille du célèbre café de Flore, le Rdv des artistes, devenus avec le temps, celui des bobos parisiens m’as-tu vu et des touristes asiatiques trop content d’immortaliser sur leur appareil photo la devanture et de repartir avec une tasse vendu hors de prix dans la boutique qui juxtapose l’établissement. Même si cet endroit possède une âme, Café de Flore, le film n’est dont pas un biopic sur ce lieu. On ne suivra pas la vie infernale d’un dessous de tasse .

Que je vous dise que Café de Flore renvois plutôt à une chanson de Matthew Herbert. Il a composé un thème musical unique lien apparent entre deux histoires, deux destins, ceux racontés dans ce film de Jean Marc Vallée. C’est vrai qu’il faut attendre la toute dernière partie du métrage pour comprendre enfin le véritable lien entre ces deux films. Avant que tout ne s’éclaire, on est paumé, ballotté, perdu, trimballé entre deux époques, deux vies, deux pays, deux familles, deux films… oui, on va et vient dans le temps en permanence et on ne comprend rien. Notez que ce flou, ce manque de rationalité dans le montage devient très vite bien agréable. On cherche. On est actif. On envisage toutes sorte de possibilité. Il doit bien y avoir un personnage, un décors, un lieu, un lien entre Paris en 1969 et Montréal en 2011. Jean Marc Vallée qui s’ingénie à ne donner aucune clé de compréhension, nous sait désemparé. Ça lui plait certainement beaucoup de nous voir patauger. Et c’est vrai que c’est plaisant de se laisser porter par ces deux histoires jusqu’à ce qu’enfin...

Donc dans CAFE DE FLORE, on passe donc les ¾ du temps à aller et venir entre deux époques. On est tout d’abord en 2011. Un homme, charmant, dans la force de l’âge a tout pour être heureux, nous dit une voix off : une belle femme, deux beaux enfants, une belle bicoque, une belle piscine, un beau jardin, du fric, de la célébrité. C’est une sorte de David Guetta en goguette. Notre ami est sur le point de s’envoler pour une destination inconnue. Dans cette aéroport, il fait ses adieux à sa blonde, alors qu’une brunette se morfond dans son lit, seule. Les deux filles semblent tirer un peu la gueule à leur papa. La scène devient flou. Alors qu’il s’éloigne au ralenti, Jean Marc Vallée nous invite à un voyage qui sera tout sauf limpide, une aventure confuse, chahutée, tourmentée. Derrière ce fondu au flou, on se télé-porte en 1969 à Paris. Une jeune femme met au monde un bébé autiste. Elle se sépare de son mari et se dit prête à tous les sacrifices pour élever son enfant dans la dignité, l’éduquer, l’aimer et lui donner toutes les armes nécessaires pour qu’il puisse mener une vie la plus normale possible, comme tous les autres enfants de son âge. C’est son rêve. Elle s’y accroche. Elle sait aussi qu’en l’obligeant à lire, à écrire, en lui racontant des histoires, elle pourra prolonger son espérance de vie, une espérance qui ne dépasse généralement pas les 25 ans pour les autistes. Elle apporte son amour inconditionnel a cet enfant qui fait une fixette sur le 33T intitulé Music To Remember Her – Roman Candle Café de Flore. Il adore cette musique. Sans arrêt il demande à sa maman de faire tourner cette galette sur son pick up. Si ces deux là sont extrêmement complices, tout va basculer lorsque du haut de ses 7 ans, l’enfant tombe amoureux de Véronique une petite fille un peu retardé comme lui. Sa mère vit très mal la situation. D’une jalousie maladive, elle se sent dépossédée de son enfant et commence à péter les plombs au fur et à mesure que son fils lui échappe, ou plutôt que l’amour de son fils ne lui est plus uniquement destinée.

Pendant ce temps là en 2011, notre DJ à succès se débrouille comme il peut pour changer de vie. Il vient de plaquer sa femme, la mère de ses enfants. Et pourtant, ils se sont rencontrés à l’adolescence et se sont promis un amour éternel. Finalement, ils n’étaient pas les âmes sœurs qu’ils pensaient être. Abandonnée par son mari, cette femme ne parvient pas à se remettre de cette séparation. Mélancolique, en proie à des crises de somnambulisme, elle fait souvent un rêve étrange et pénétrant, celui d’un enfant, un monstre qui vient la hanter, un rêve dont elle ne saisi pas exactement les contours. Pourquoi ce cauchemar récurent ? Plongée dans un profond spleen, elle essaye de faire comme si, de vivre sans son mari qui lui a préféré cette jeunette, blonde et sublime. La plus grande de ses filles lui en veut terriblement. Elle refuse d'admettre sa crise avec c’te guidoune, comprenez cette salope de blondasse, cette pute qui a brisé la cellule familiale et l’entente joyeuse qui régnait. Le père a également de la peine à accepter que son fils foute son ménage en l’air. Lui-aussi lui reproche ses actes.

CAFE DE FLORE, un film emprunt d’une certaine poésie. Un peu trop long, il en déroutera plus d’un, notamment ceux et celles qui ne croient pas en l’irrationnel. Reste qu’en dehors de ça, il aborde un thème rarement vu au cinéma, l'autisme et la gestion de ces enfants dit attardé dans les années 60. Sans cette mère courage qui donne tout son amour à son fils, le gamin n’aurait aucune chance. Mais le film parle aussi d’amour, ce sentiment si fort, si puissant, si violent qu’il peut conduire à commettre un acte extrême lorsque l’on se sent déposséder de cet amour. Il y est question enfin de pardon, de compréhension et d’acceptation. La femme bafouée, trahie doit savoir s’effacer devant les forces de l’amour, lorsque la véritable âme sœur vous kidnappe celui que l’on croyait être le seul, l’unique amour de sa vie. Dire encore que Vanessa Paradis, vieillie et légèrement enlaidie pour le rôle s’est beaucoup investi et ça se voit. Sa prestation de mère courage est brillante. Dire enfin que la bande son du film finira d’emballer celles et ceux qui ont envie de découvrir un film qui sort un peu des sentiers battus.
BOTTLED LIFE
Pour étancher
votre soif de savoir

BOTTLED LIFE commence comme une démo sur la chaîne de télé HD SUISSE. Vous savez, avec ce genre d’images somptueuses devant lesquelles on reste scotché, chez les revendeur d’écrans de télévision ! C’est beau la montagne, ces sommets, cette neige, cette verdure, ces cascades, cette eau pure qui coule sur les roches, cette brume, ces vues aérienne qui réconcilient immédiatement avec Dame nature, des fois que l’on soit un peu en froid avec elle. Et puis. directement derrière cette beauté et ces images apaisantes, Urs Schnell nous plante un première épée dans le dos ! Oubliez la douceur et vive la rudesse des propos de Peter Brabeck, grand manitou de Nestlé, entreprise multinationale qui dégage des bénéfices hallucinant grâce au commerce de l’eau. Et c’est là que les esprits chagrins commencent à s’interloquer, à se demander comment peut-on juxtaposer ces deux mots dans une même phrase : commerce et eau. L’eau n’est-elle pas une ressource fondamentale à laquelle chaque homme doit avoir accès librement et gratuitement? L’eau peut-elle être un gage de profit pour une société privée? A-t-on le droit de pomper une nappe phréatique et de vendre ensuite l’eau pompée? A qui appartient cette ressource? A qui appartiennent les nappes phréatiques? Voilà les questions centrales et fondamentales que se posent Urs Schnell dans son documentaire.

Le film tout passionnant soit-il n’en demeure pas moins une attaque à charge contre Nestlé, même si l’auteur s’en défend. Il faut dire que le service de communication de la multinationale n’a jamais répondu aux demandes de précisions et d’entretien que Urs Schnell a déposé. Pire que cela, on lui a signifié qu’il faisait le mauvais film au mauvais moment et que toutes les portes de Nestlé, de ces entreprises à travers le monde entier lui seraient fermées. L’entêté Urs Schnell n’a eut que faire de cet avertissement et il s’est lancé malgré tout avec un journaliste Res Gehriger dans son enquête. De toute façon, BOTTLED LIFE, Nestlé s’en fout. Mieux vaut rester silencieux que de répondre aux attaques. Aux moins, on n’alimente pas le débat et donc toute tentative de polémique est ainsi broyée dan l’œuf. Et la stratégie marche plutôt bien parce qu’en regardant le film, même si il évite le militantisme de base, même si on sent une démarche citoyenne honnête de la part du réalisateur et du journaliste, en tant que spectateur, la frustration grandi au fil du film et on reste sur sa soif.

Oui, Urs Schnell décrypte les manières de faire, parfois limite crapuleuses du géant silencieux, ce rapace comme le présente Maude Barlow dans le film, Maude Barlow une ex ponte de l’ONU chargée des questions de l’eau. La technique est bien rôdée, dit-elle. Nestlé traque les sources d’eau, installe ses puits et quand il n’y a plus rien à extraire, s’en va. Pour exploiter ces filons d’eau pure au nez et é la barbe des habitants, on rince les collectivités locales. On aide un école par ci, une association de pompier par là. On construit des routes. On exploite la moindre faille juridique qui permet à quiconque aux USA d’exploiter le sous sol. C’est le cas dans le Maine, un état rural ou les sources de profit pour Nestlé sont nombreuses. Ceux ci dit, les américains lambda commencent à se regrouper. Ils protestent et certaines voix se font entendre. Dans le film, on voit que ce combat de longue haleine commence à porter ces fruits. Les citoyens obtiennent gain de cause. Ils reprochent à Nestlé de commercer une eau potable, normalement accessible à tous en ouvrant son robinet. Ceci dit, Urs Schnell dans BOTTLED LIFE va encore plus loin. Une fois son enquête achevée sur les terres de l’Oncle Sam, il se rend au Pakistan ou au Nigéria pour raconter la success story incroyable de Pure Life, l’eau en bouteille la plus vendue au monde. En fait, Nestlé s’installe toujours dans des zones ultra polluées ou le réseau d’eau courante est en décrépitude. Ils arrivent, installent leurs pompe, pillent la nappe phréatique, rajoutent quelques sels minéraux et autres substances dans la flotte, la conditionnent en bouteille plastique, font un peu de marketing et hop, imposent leur solution pour lutter contre l’eau polluée, en vendant de l’eau potable en bouteille dont parfois le prix du litre est plus élevé que celui de l’essence! Au Pakistan, posséder une bouteille de Pure Life est devenu un signe extérieur de richesse. On se balade dans la rue avec sa bouteille comme on exhiberait une Rolex! Au Nigéria, on s’en fout de la Pure Life car on ne peut tout simplement pas de quoi se payer cette eau luxueuse.

Urs Schnell dénonce aussi la communication mensongère de Nestlé sur son site internet et prend pour exemple ce camp de réfugier en Ethiopie. Sur le site de la firme, Peter Brabeck clame que Nestlé se soucie de sa responsabilité sociale. En installant des puits et favorisant l’accès à l’eau potable à des populations défavorisé. Une fois sur place, dans le camps de réfugier, Urs Schnell se rend compte que le puit est à l’abandon depuis 2004 et que seul l’ordre de St Lazar, avec ses maigres moyens, maintient le dispositif en état de fonctionnement. Le commerce de l’eau, un sujet d’indignation comme un autre, un commerce juteux en tout cas pour Nestlé. C’est ce que montre BOTTLED LIFE, ce documentaire de Urs Schnell qui dénonce les agissements de Nestlé en ce domaine en attendant qu’un jour peut-être, une firme ne décide de commercialiser l’air que l’on respire ! Vous verrez, ça viendra.
SUMMER GAMES
Jeux de mains,
jeux de vilains!
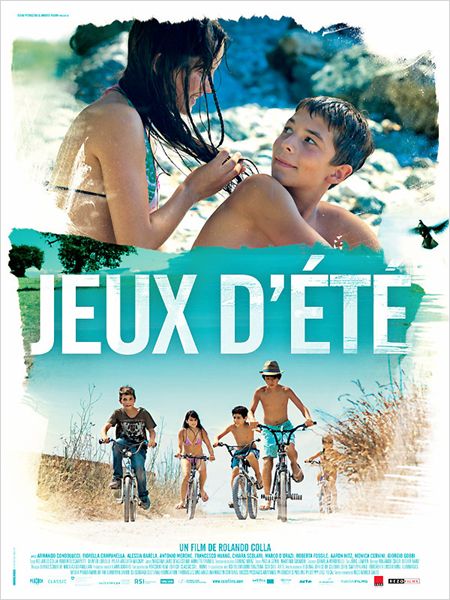
Soyons honnête et franc, un film dans lequel on entend un intermède musical qui reprend les partitions de la bo du film de Gilliam BRAZIL ne peut pas être foncièrement mauvais, même si cette musique est jouée par un orchestre de bal à papa dans un camping de Toscane! Bravo à Rolando Colla, le réalisateur de SUMMER GAMES d’avoir eut la délicate attention de glisser ces quelques secondes de bonheur dans un film ou il nous rejoue plutôt une mélodie du malheur. Pour SUMMER GAMES, son 4ème long métrage, le zurichois d’origine italienne Rolando Colla a donc planter sa caméra et son équipe dans un camping. Attention, ce n’est pas le 4 étoile de Franc Dubosc, plutôt un 0 étoile pointée avec vue sur les latrines et chiotte dans la mer. D’entrée de jeu, on sent que ces vacances estivales ne seront pas de celle qui se déroulent tranquillement. Il y aura de la tension et peu de répit dans cette famille au bords du gouffre. La faute à un père violent avec sa femme et ses enfants, une violence qui déteint sur son fils, le plus grand, Nic. Du haut de ses 13-14 ans, Nic s’embrouille avec d’autres gamins, dès le premier jour sur la plage. Parmi ce groupe, une jeune fille de l’âge de Nic qui recherche son père disparu. Elle ne l’a jamais connu et songe sérieusement à le rencontrer. D’autant qu’elle a retrouvé sa trace.

SUMMER GAMES raconte donc, depuis le point de vu de Nic, ces quelques jours passées à jouer dans un champ de maïs au jeu du tueur, sorte de chasse à l’homme entre mômes qui se conclue toujours par une arrestation et l’exécution d’un châtiment. Entre deux parties, les parents de Nic tentent de se rabibocher. Mais le mari, blessé dans sa fierté car sa femme a eut une augmentation sans lui dire et gagne plus de fric que lui, va continuer à la frapper malgré lui… Cette violence envers cette femme s’exprimera aussi envers son fils Nic. Une soirée karaoké ne suffira pas à ce papa submergé par la culpabilité, bouffé de l’intérieur, conscient qu’il est un fumier, à se faire pardonner…

SUMMER GAMES, un drame en partie autobiographique pour Rolando Colla, un film avec tout de même bien des défauts, sans doute pour cela qu’il n’a pas été retenu dans la course aux Oscar. SUMMER GAMES était le représentant suisse et le film a été écarté, à cause de quelques défaut, sans doute notamment, le manque de réalisme dans les scènes ou s’exprime la violence. L’acteur qui incarne le père est sans cesse sur la réserve. On voit bien que ce sont des claques de cinéma. Et puis surtout, avec un père pareil, il y avait matière à parricide. En guise de cela, on doit se contenter d’une fin ou on rase le champ de mais dans lequel les gamins jouaient ! les vacances sont finies, le film aussi…
ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE:
Un éléphant à la retraite, ça ne trompe plus énormément

Aujourd’hui, finaliser un projet de film original qui vous tient à cœur est devenu une mission impossible. Soit vous êtes un tâcheron au service d’une industrie de consommation qui vous dicte votre travail et vous vous engagez à réaliser des œuvres insipides dont vous n’avez que faire, soit vous êtes condamné au silence par une industrie qui ne veut prendre aucun risque, et surtout pas celui de financer des films polémique ou pire, des films au succès incertain. Les temps sont dures pour les auteurs. Si Laurent Bouhnik avec son Q en sait quelque chose, Yves Boisset, le cinéaste français le plus censuré aussi. A ce propos, je vous recommande la lecture de son bouquin LA VIE EST UN CHOIX paru chez Plon et qui regorge d’anecdotes savoureuse. En plus de 30 ans de carrière, l'auteur de films remarquables comme Le Juge Fayard, Le Prix du Danger, Radio Corbeau ou encore Dupont Lajoie n’a jamais connu la paix: censure, menaces, attentats, pressions diverses ... il a tout connu. Ca a commencé en 1970 avec Un condé. Le film a été interdit totalement pendant plus de six mois, jusqu’à ce qu’il coupe 12 minutes et retourne entièrement une scène d’interrogatoire de police particulièrement musclé. Sur le Juge Fayard, dit le Shérif, retraçant l'assassinat du juge Renaud, on l’a obligé à coller des bip à chaque fois que le terme SAC était employé, le SAC, une organisation paramilitaire secrète à la solde de De Gaulle et chargé de nettoyer la France de la vermine coco. Le plus rigolo, c’est que dans les salles de cinéma, à chaque bip, les gens gueulaient SAC ! Mais ça n'a pas empêché les emmerdements. Un soir, raconte-t-il, « des mecs me sont tombés dessus en bas de chez moi et m'ont cassé le nez. Ma bagnole a été défoncée à coups de masse, toutes les vitres explosées, sauf celle du conducteur, sur laquelle ils avaient marqué "bip-bip". Plus tard, il y a eu la commission d'enquête parlementaire, on m'a demandé de venir témoigner sur ce que je savais du SAC. On vient me chercher avec deux bagnoles blindées bourrées de flics, on m'amène toutes sirènes hurlantes à l'Assemblée Nationale, on me fait entrer pas les souterrains, encadrés par des types avec fusil à pompe. Pendant une heure et demie, on me pousse au crime, on veut me faire dire des choses que j'ignore. Et, à la fin, on me dit : Merci, monsieur, vous avez été très courageux. Et on me lâche dans la rue et je suis rentré en métro chez moi ». Yves Boisset un cinéaste politique qui a donc expérimenté la loi des emmerdements maximum depuis les années 70 et qui aujourd’hui ne trouve plsu de pognon pour faire ses films. Oui, parce que aujourd’hui, la censure est devenue moins frontale, plus insidieuse, plus mesquine mais tout aussi efficace. Elle est d’ordre économique. Boisset a plein de films en tête qui resteront de l’ordre du fantasme. Qui financera en France son film sur la France Afrique ? Aucun des 4 grands groupes ne prendra ce risque car tous les politiques de gauche comme de droite sont mouillés.

Dans une moindre mesure, Stéphane Robelin a lui aussi dû composer avec la censure économique. Stéphane Robelin sort cette semaine son second long métrage intitulé Et Si On Vivait Tous Ensemble, un film qu’il ne voulait pas forcément faire. Mais il a besoin de travailler, de bouffer, alors il l’a fait. En 2004, Stéphane Robelin sort de l’ombre avec Real Movie, un long métrage complètement barré tourné en Dv, hors du système. Ce premier essai convainquant raconte comment un étudiant en cinéma réapparaît subitement dans la vie de son copain d’enfance, caméra au poing, s’incruste chez lui et le manipule pour en faire le héros de son film. Ce succès d’estime plus que public n’a pas suffit a convaincre les financiers pour son second long métrage. Il a donc du revoir sa copie, choisir un sujet de société qui ne lui tenait pas plus que ça à cœur, mais dont il imaginait qu’on le financerait facilement.

Détrompez-vous, la vieillesse, la maladie, les histoire de viagra et de zizi panpan chez les séniors, c’est pas ce qui fait triper les producteurs et els banquiers ! Et même si vous insistez pour traiter le sujet sur le mode de la comédie douce amer. Tabou oblige, le financement de ce long métrage n’est pas allé de soi. Le tournage a même connu un premier faux départ en 2007. Après une interruption d’un an, Stéphane Robelin a pu reprendre son projet grâce à des capitaux allemands, mais il a fallu germaniser le casting. Du coup, l’acteur Daniel Brhul a rejoint le film, ce qui a modifié deux ou trois petites choses. Donc oui, la censure est aujourd’hui économique . elle modifie considérablement la production, l’offre cinématographique et quand les films se font, leur contenu. A cause d’elle, les spectateurs que nous sommes sont obligés de nous farcir des œuvres réalisées en toute retenue, dont on sent bien qu’elles pourraient aller tellement plus loin, mais elles n’y vont pas. C’est le cas ici avec ce film de Stéphane Robelin, ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE, un long métrage qui met en scène Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Claude Rich, Guy Bedos, Pierre Richard et le jeune Daniel Brhul… Casting de luxe pour film mineur, mais film tout de même. Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le coeur s’emballe et quand le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se rebellent et décident de vivre tous ensemble pour éviter la maison de retraite. Le projet paraît complètement dingue, mais même si la promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commence : celle de la communauté... à 75 ans !

Et si on vivait tous ensemble ? un film en mode mineur sur une angoisse majeure, bien naturelle, très humaine, qui s’amplifie avec le temps: la peur de la solitude lorsque la dernière heure approche. Chacun l’a gère à sa manière. Il y a Pierre Richard qui ne gère rien du tout à cause de la perte de mémoire; il y a Claude Rich qui, désireux de repousser les limites de l'âge, ne veut pas perdre une miette des quelques années qui leur reste en essayant de maintenir une vie sexuelle active. Il y a encore Jane Fonda celle qui face à la maladie, préfère faire semblant, se taire et préparer son enterrement sans en parler à son mari, choisissant de vivre ses derniers moments comme elle l'entend… Bref, malgré des personnages bien croqués et quelques scènes assez poilantes, malgré le plaisir de revoir cette tripotée de légende du cinéma, il manque ce petit grain de folie, un supplément d’âme dans ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE pour en faire un film marquant un peu comme si finalement, Un éléphant à la retraite, ça ne pouvait plus tromper énormément…
HORS SATAN
Bon Dieu de film!
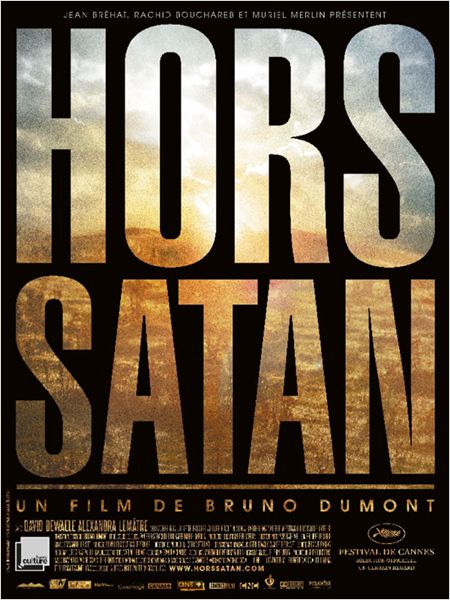
Pour aujourd’hui, j’ai du costaud, le nouveau film de Bruno Dumont, un auteur qui a su s’imposer, imposer sa griffe, sa patte, sa manière de concevoir le cinéma en 15 ans et 6 films, pas plus….Bruno Dumont est un descendant direct de Maurice Pialat, le genre qui pratique un cinéma sans gras. Dumont Pialat même combat avec cette recherche permanente de ce cinéma sec, le plus épuré possible pour raconter avec le plus de justesse possible, la nature humaine. Dumont ne travaille en principe jamais avec des acteurs professionnels. Ca ne l’intéresse pas puisque les pro sont dans la fabrication et que lui, il recherche la pureté, la vérité. Il a en plus des méthodes de tournages bien à lui: Il ne fout rien du tout sur le plateau, il attend. Il guette l’accident. Pour lui, le cinéma, c’est tout sauf d’essayer de traduire ce qu’il a écrit. De toute façon, c’est vite vu, il n’écrit rien, ou alors trois fois rien! Simplement, il place ses acteurs dans des situation précises et il attend que quelque chose arrive. Du coup, devant un film de Dumont, le spectateur peut avoir l’impression qu’il ne passe rien, et pourtant, il s’en raconte des chose dans ces successions de plan ou on croit qu’il ne passe rien. Pas d’erreur, les films de Bruno Dumont appartiennent immanquablement à un registre de longs métrages dit radicaux, le genre de film qui font fuir 95% des spectateurs. De toute façon, là encore Bruno Dumont s’en fout. Pour preuve cet extrait d’interview accordée à un journaliste de Kinok.com au moment de la sortie en salle de 29 palms. C’était en 2003 je crois… je cite Dumont : « Le problème avec le cinéma, c'est le spectateur. Jusqu'où peut-il aller ? Qu'est-ce qu'il peut entendre ? Qu'est-ce qu'il peut comprendre ? Dans les salles de cinéma, il y a plein de connards, il y a plein de nazes ! Le public. j'en n'ai rien à foutre ! Pour moi, le public est un individu. L'individu m'intéresse. Mais le gros tas de gens assis dans un cinéma, je m'en fous. La quantité de spectateurs qui rentrent dans la salle, j'en n'ai rien à foutre. Par contre, la qualité du rapport avec le spectateur-individu et le film, ça, ça me passionne vraiment. Je respecte l'individu, mais le public j'en n'ai rien à foutre. Le public, c'est la tyrannie d'aujourd'hui, une vraie calamité. La seule résistance possible, c'est de faire des films radicaux pour des individus. Quand je vois certains jeunes de 16-17 ans, qui parlent, je ne comprends même pas ce qu'ils disent. C'est ça le problème. C'est dramatique. C'est pour ça qu'on voit des films aussi cons. On voit des films cons parce qu'il y a des cons. C'est très simple à comprendre. Et c'est pas élitiste de dire ça de ma part. Je pense que le problème du cinéma aujourd'hui est un problème politique, de civilisation. Si on continue à passer des conneries à la télé, on aura des cons, c'est clair. C'est pour ça que dans les années 70, vous aviez des cinéphiles. Le spectateur de cinéma d'aujourd'hui n'est pas un spectateur, c'est un consommateur. Il consomme les films avec les cartes machin, il rentre dans une salle et si le film ne lui plaît pas, il sort tout de suite. Donc, ça va être de plus en plus difficile de faire du cinéma si on ne fait pas la révolution ». Fin de citation de Bruno Dumont. Voilà le genre de propos qui permet de réellement situer ce personnage sur l’échiquier du cinéma français, Dumont, c’est un cheval fou, en tout cas, ce n’est pas un pion… Reste que son nouveau film HORS SATAN sera donc programmé dans une salle de cinéma avec des spectateurs, enfin du moins, on l’espère… Reste à savoir ce que vous réserve cette nouvelle expérience cinématographique intiutlée HORS SATAN ? Telle est la question qui vous tarabuste après cette introduction...

Et bien déjà ne vous laissez pas abuser par le titre car Bruno Dumont n’en a rien à cirer des délires mystiques. Dieu, le Diable, sa queue et toutes ces conneries ne trouvent aucune grâce a ses yeux ! Alors pourquoi ce titre? Parce qu'il fallait bien en trouver un qui soit accrocheur et accessoirement parce qu'il sera question du bien et du mal dans ce nouveau long métrage ou Bruno Dumont se penche au chevet d'un type énigmatique, dans une région de bord de mer, avec ces dunes et ces grandes étendues de verdure. La nature, et les corps qui évoluent au milieu de cette nature, voila ce qui passionne le cinéaste. Pour le coup le film part sur les chapeaux de roue, à 2 à l’heure . Un type en godillots, jean’s, blouson et pull-over marche à travers champ ou au bord d'une route. Cette entame dure bien dans les 10 minutes, 10 minutes sans un dialogue, 10 minutes à contempler ce mec de dos, de face ou de profil. On le suit ainsi jusqu'à ce qu'il retrouve une jeune fille en pleure devant une ferme. « J'en peux plus », dit-elle en essuyant ses larmes. « Et bien tu sais ce qu'il reste à faire », répond-il. Oui, il faut se taper 10 minutes de film sur le même mode où les deux partent à la recherche d'un fusil planqué dans un phare. Avant d’atteindre leur destination, alors que les 2 êtres perdus dans un plan ultra ultra large semblent immobiles au milieu des dunes, on ne peut que rester baba devant la profondeur de champ de cette image qui s’éternise. Et c’est pile au moment où l’œil s’arrête sur un tout petit détail, un phare qu’on distingue à peine au loin, que Bruno Dumont donne un coup de sécateur et impose juste derrière ce plan, un nouveau plan fixe où les deux personnages marchent devant le phare! Une fois leur fusil en main, le couple rebrousse chemin, retourne à la ferme et bute le père de la demoiselle. Il y avait certainement de l'inceste, voire du viol dans l'air, une constante dans le cinéma de Bruno Dumont. Y a toujours au moins un viol dans ses films. La mère attristée par ce crime ne condamne pas sa fille. Au contraire, elle s'excuse pour tout le mal que ce salopard lui a fait. Il a mérité son châtiment. Le film pourrait se terminer là. Pas question. Il y a encore de la pellicule à imprimer, des kilomètres et des kilomètres pour voir ces personnages marcher, prier et un peu chahuter. La fille aimerait tellement s'offrir à son chevalier servant mais il refuse catégoriquement ses avances. On comprendra plus tard qu'il vaut mieux pour elle ne pas s'accoupler avec cette bête curieuse au sperme mortel.

HORS SATAN, un film avec encore une scène d’exorcisme, le meurtre de Bambi et le tabassage d’un garde forestier, tout ça filmé uniquement en plans fixes, des plans qui s'étirent jusqu'à l'indigestion. Quand on ne voit pas les personnages mettre des plombes à rentrer et sortir du champ de la caméra, on a droit à des gros plans sur des visages qui n’en finissent plus, le temps que les comédiens miment toutes sortes d'émotions comme la peur, la panique, la joie, la surprise... HORS SATAN, du Bruno Dumont dans toute sa splendeur, de la branlette intellectuelle diront certain… oui, c’est vrai, mais ça peut avoir du bon de se tirer sur la nouille… .enfin bref, la Bonne nouvelle c'est que HORS SATAN dure 1h50 alors qu'à l'origine, le film devait compter une heure de plus!
DEEP END:
un film qui ressort 40 ans après sa première exploitation en salle
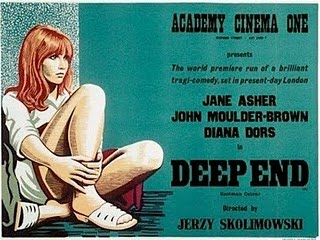
Le mal être des ado, voilà un sujet mainte fois rabâché au cinéma. Le plus brillant ambassadeur de cette thématique, Gus Van Sant, a su croquer cette problématique comme personne. Mais avant lui, il y a eut un polonais qui s’y est essayé, un certain Jerzy Skolimovski. En 72, il réalise dans l’urgence DEEP END. Le film, considéré par les critiques et les cinéphiles avertis comme un chef d’œuvre est resté très longtemps introuvable. Hormis quelques copies pirates en dvd de très mauvaises qualité, il n’y avait aucun moyen de découvrir DEEP END jusqu’à ce qu’une entreprise de colorisation soit lancée. Et voici que DEEP END bénéficie 40 ans après sa première sortie en salle d’une ressortie. Evidemment, la première question qui vient à l’esprit est de savoir si ce film a bien vieilli. Et bien oui. Il possède une telle fraicheur qu’on a l’impression qu’il a été tourné l’an dernier. Y a un vent de liberté qui souffle la dedans, c’est incroyable.

Que je vous dise que DEEP END se situe à Londres, même si il a été tourné en grande parti à Munich. Mike sort du collège. Du haut de ses 15 ans, ce candide naïf, timide, introverti trouve un petit boulot dans un bain public. Là, il fait la connaissance de Susan, sa nouvelle collègue, une fille plus âgée que lui. Ils doivent nettoyer les cabines privées et s’occuper aussi des clients et des clientes. Susan aime bien chahuter un peu avec Mike. Elle l’allume, le titille, lui demande de s’occuper de certaines cliente qui confondent bain public et bar à gigolo. Susan arrondit aussi ses fins de mois en proposant ses services sexuelles à quelques messieurs qui ne demandent pas mieux que de croquer avec délice dans la chaire fraiche de la donzelle. Il faut dire que la rouquine est diablement sexy, à tel point que tous les hommes qui croisent son chemin en pince pour elle. Susan est aussi charmeuse que charmante. Rapidement, le jeune Mike succombe lui-aussi. Amoureux à son tour, Mike devient de plus en plus encombrant pour Susan.

DEEP END, un film qui explore le désir amoureux chez l’adolescent, plus que le besoin de concrétiser ce désir par l’acte sexuel à proprement parler. Il décrit parfaitement cette période tumultueuse qui bouleverse l’adolescent puceau avant son premier rapport sexuel. Le film décortique de manière magistrale à quel point un fantasme trop violent peut devenir obsessionnel et dangereux pour l’humain. Dans son final, DEEP END fait ressortir une idée forte, celle que le désir est plus intense avant sa concrétisation, l’idée que l’amour physique est sans issue. Au delà du fond, le ton du film participe à sa réussite. On alterne entre le cocasse et la tragédie. Comme dans la vraie vie, il y a un coté imprévisible. On ne peut jamais savoir ou le scénario va embarquer le jeune Mike. Parviendra-t-il a repousser les avances de la grosse dame fan de football de la cabine 3. Echappera-t-il à cette dingue du drible et du tir en pleine lucarne. La scène est prodigieuse. L’ado se retrouve malgré lui obligé de renifler sous les jupons de cette femme mure déculottée qui utilise la tête chevelu du gamin comme un godemiché . Elle le téléguide sans qu’il ne puisse s’extraire !

Tout aussi troublant, la scène du cinéma porno. Mike suit Susan en cachette. Elle se rend avec son copain à une séance. Du coup, on regarde le film que les spectateurs du film regardent avec délectation, en l’occurrence, un film de boule éducatif ou des femmes expliquent que la frigidité n'existe pas, que tout est affaire de caresse et de doigté pour susciter le désir, un discours bercé par la musique de la Chevauchée des Walkyries en même temps que certaines passent à l’action ! Mike qui découvrent ces images se sent pousser des ailes et alors qu’il est installé dans le rang de fauteuil derrière Susan, commence à la peloter. Il prend une paire de baffe avant de se faire virer du cinéma.

Plus loin, la déambulation de Mike dans le quartier hot de Soho n’est pas mal non plus. Evidemment, les bars échangistes lui sont interdits d’accès parce qu’il est mineur. Il est donc bouffé de l’intérieur à la simple idée de savoir que Susan a pénétré dans un de ces lieu de perdition… Alors il attend sur le trottoir, impatient, en bouffant des hot dogs. Il subtilise la pvc en carton représentant une femme en bikini devant un bar coquin, convaincu que cet objet représente susan, alors que non. Le rabatteur propriétaire de cette pvc le poursuit et dans sa fuite, Mike entre par mégarde dans la chambre d’une prostituée dont la jambe gauche est plâtré sur toute la longueur. Il est obligé de négocier sa sortie. Tout ça est extrêmement drôle et en même temps, pour le personnage, profondément pathétique. Il devient prisonnier de son désir et surtout prisonnier d’une jalousie grandissante. A ce stade, on suppute que cette histoire se terminera peut-être très mal pour Mike et Susan.

DEEP END, un film qui est resté avec le temps envoutant. Sur la forme, la caméra est d’une liberté absolue. On tourne autour des personnages. On plonge dans l’eau de la piscine avec eux et on est envouté par les couleurs criardes, très pop, envouté aussi par sex à pile formidable de Jane Asher, alias Susan. Elle est l’atout de DEEP END… sa beauté, son charisme ne peuvent pas laisser insensible… idem pour la maladresse de Mike alias Jhon Moulder Brown. Le plus incroyable, c’est que le film repose sur ces 2 comédiens qui n’ont pas répété avant le tournage par manque de temps. De toute façon, le scénario n’était pas fini. C’est de là peut-être que provient la fraicheur. Et puis, si il n’y avait pas eut cette alchimie naturelle, DEEP END tombait à l’eau. Jerzy Skolimovski raconte que tout ou presque a été improvisé, y compris les dialogues. Il ne fallait pas se poser de question, tourner, foncer, se laisser guider par l’instinct, compter sur la chance comme pour l’une des scènes centrales du film. A un moment donné, Susan perd un diamant au pied d’un arbre dans la neige. Le problème, c’est que le jour ou on doit tourner cette scène, y a pas de neige. Les oiseaux gazouille. Il fait beau. C’est le printemps, et d’un seul coup, juste avant que l’on ne délimite un périmètre et qu’on recouvre le sol de neige carbonique, le ciel s’assombrit et les premiers flocons tombent. Et c’est parti. On tourne toute la journée sans interruption, parce que c’est une neige de printemps qui fond assez vite, mais tout de même, c’est de la vraie neige. Pour le film, on se croirait en hivers comme c’est écrit dans le scénario. On appelle ça la magie, la grâce, j’en sais rien. On appelle ça DEEP END, une des pierre angulaire du cinéma sur cette théma de l’adolescence torturée par l’amour, un film de Jerzy Skolimovski qui n’a pas vieilli avec Jane Asher, John Moulder Brown. Ça ressort demain en salle, 40 ans après une première exploitation commerciale.
J.EDGAR
Un film de tafiole!
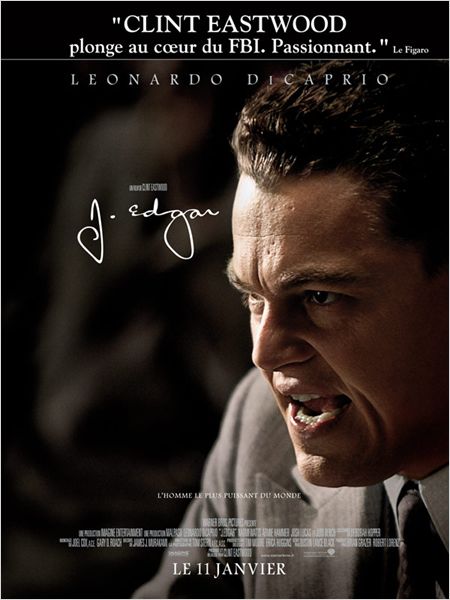
Ce 32ème film, Clint Eastwood, l’a consacré à un homosexuel refoulé ! Vous ne rêvez pas. C’est une première pour ce vieux Clint. Lui qui a toujours esquivé le sujet l’empoigne enfin. Evidemment, son nouveau film n’a rien à voir avec Harvey Milk! Il ne faut pas exagérer non plus. Pas de pelle en gros plan entre deux hommes. Tout juste un timide baiser en fin de métrage, et encore. J. EDGAR retrace donc la vie d’une tafiole selon sa mère, en réalité un type autoritaire, en manque de reconnaissance, obscure manipulateur, parano de première, chasseur de coco, traqueur de gangster, animal politique hors norme, craint de tous et de toutes. Son nom J Edgar Hoover. Il fut le patron du FBI qu’il créa en 1924 et dirigea d’une main de fer jusqu’en 1972. Ce mystérieux personnage, indéchiffrable bonhomme a titillé l’inspecteur Harry au point qu’il tente de décrypter l’énigme Hoover le temps d’un biopic, mais pas un biopic comme les autres ou l’on se contenterait d’aligner les faits d’armes de Hoover… Non un biopic ou finalement la psychologie de ce tordu prend le dessus. Le film bavard, classique dans sa mise ne scène, pour ne pas dire mollasson par instant n’en demeure pas moins passionnant car il montre à quel point ce type, imbu de sa personne, convaincu du pouvoir qu’il avait entre les mains, a pu ainsi rester en place pendant 48 ans au service de l’Etat.

Organisé mais complètement bordélique, le montage de J EDGAR le film est à l’image du personnage Hoover. En jouant la carte des flash back, multipliant les aller retours entre 1972 date de sa mort, et dans l’ordre., 1919, 1925, 1934, 1963, Eastwood et son scénaristes seront certainement les seuls à s’y retrouver, laissant le spectateur peu au fait de l’histoire des states, sur le bord de la route 66. On pourrait presque finir par confondre l’arrestation de Mitraillette Kelly avec celle de l’assassin allemand de l’enfant de Lindberg, se demander si l’assassinat de Kénédy a eut lieu avant ou après l’investiture de Nixon, le seul président américain pouvant enfin se réjouir de la mort de Hoover. Et pour cause, Hoover avait des dossiers sur tout le monde. Il a surveillé, fait épier tout les parlementaires américains, du plus insignifiant au plus haut sommet de l’Etat. Et Clint Eastwood d’installer le trouble dans la tête du spectateur.

Et si Hoover n’était rien d’autre qu’un affabulateur. Alors qu’il dicte ses mémoires, son alter égo Clyde Tolson, son second, son amoureux secret (hoover avait des penchants homo qu’il tentait de dissimuler), Clyde lui balance ses 4 vérités et lui signifie à quel point il a trahi la vérité dans ses écrits. Il n’a jamais arrêté qui que ce soit comme il le prétend. Il a certes diriger des opérations, mais toujours depuis son bureau ou son téléphone, jamais sur le terrain. Il s’est approprié quelques captures comme celle de Dillinger alors que non, ce n’était pas lui. N’empêche que ce que l’on ne peut pas lui retirer, c’est d’avoir inventer les méthodes d’investigations de la police scientifique. Hoover est également à la base de la création de la banque centrale des empruntes digitales. Il a mené cette révolution dans la lutte contre le crime. Il s’est surtout enorgueilli d’un classement des dossiers personnels complètement kafkaïen labyrinthique, incompréhensible. Certains étaient rangés sous la case Obscène, d’autres sous Personnels et Confidentiel ou encore à la rubrique Ne Pas Classer. Aller savoir ce qu’il y avait la dedans, peut-être rien, du flan, Si ça se trouve, son pouvoir pendant 5 décennies s’est appuyé sur du vent. On ne le saura jamais.

Ces fameux dossiers secrets ont été détruit quelques heures après son décès par sa secrétaire personnelle Helen Gandy. Voilà ce qui est génial avec ce type. Voilà pourquoi Clint Eastwood ne pouvait pas passer à coté de ce personnage. D’un mot pour conclure sur la prestation de Di Caprio, plutôt convaincant. Ceci dit, lorsqu’il arbore son masque en latex, on dirait plus Nicholson que Di Caprio. Quant à Naomi Watts, les rides en plastique lui vont à merveille !
SLEEPING BEAUTY
Une tisane et au lit!
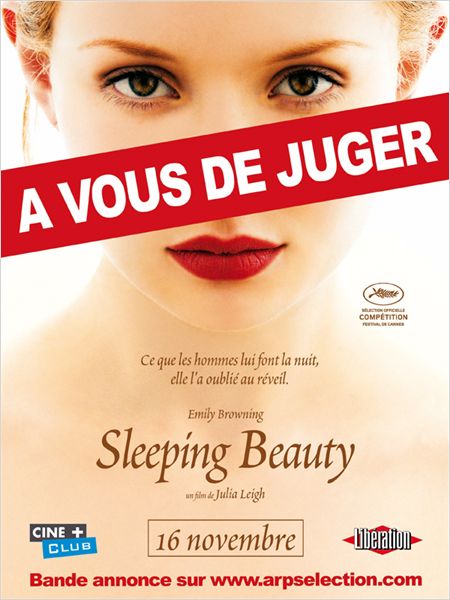
Sleeping Beauty revisite à sa manière le compte de la belle au bois dormant. Tout es là, le sentier, le manteau à capuche, l’étrange maison de campagne, la chambre du sommeil, la sorcière qui endort les jeunes filles et les princes pas charmants! SLEEPING BEAUTY traduit littéralement, la beauté qui dort est un film ronflant. A dire vrai, la Beauté du film, Emily Browning, est le seul argument convaincant pour nous éviter de sombrer devant ce film soutenu par Jane Campion.

Jugez plutôt, une jeune étudiante, Lucy, avec son cortège de problèmes financiers, qui ne crache pas sur un rail de coke, qui remplace le lait de ses céréales par de la vodka, qui aime le sexe, cette jeune fille hébergée chez sa sœur et qui, parce qu’elle ne paye pas sa part de loyer risque de se faire virer, cette jeune fille joue les cobayes pour la science. La scène d’ouverture, suffisamment intrigante, énigmatique laisse présager d’un film bourré de surprises. En fait, un type en blouse blanche dans son laboratoire prépare un tuyau de plastic. Il l’enfile par la bouche de Lucy, traverse tout l’œsophage et lui injecte de l’air par ce tuyau. C’est gonflé cette scène, mais on ne saura jamais à quoi sert cette expérience. Les plans suivants plus conventionnel, servent juste à exposer le quotidien pas trépidante de Lucy, partagé entre ses cours, ses deux boulots, ses expériences médicales, son copain junk et son beau frère avec qui elle ne s’entend pas. Un jour, Lucy répond à une annonce dans le journal de l’université. On recherche des serveuses pour des soirées spéciales. Elle devient une soubrettes à la cuisse porte jarretelle. Tous seins à l’air, elle devient un objet décoratifs au service de vieux messieurs libidineux qui aiment se remplir l’estomac en se rinçant l’oeil. Si ce genre de service inoffensif et bien rémunéré plait à Lucy, bientôt, la matrone va lui confier une autre mission : ingurgiter une tisane qui fait dormir pour permettre à ses vieux bande-mou de prendre leur pied comme ils peuvent en faisant la promesse de ne jamais pénétrer la belle au bois dormant. Et voilà qu’on s’attend forcément à ce que le film déraille. En vain ! Julia Leigh ne poursuit pas ce but et multiplie les scènes redondantes ou l’on voit Lucy dormir pendant que des vieux sagoins s’excitent sur son corps. Et l’on peine à comprendre où Julia Leigh veut en venir.

Pourquoi ce film? Pour montrer des vieux bouffés par le désir de se sentir en vie mais incapables physiquement parlant de l’assumer? Pour montrer que la vie d’étudiante est bien délicate et pas facile? Pour parler d’une forme de prostitution? Pour dénoncer la femme objet? Impossible à savoir. « Je voulais faire un film où le public puisse se dire : est-ce que j’ai vraiment vu ça ? » dixit Julia Leigh. Et bien je confirme que c’est exactement ce que vous penserez après avoir assisté à la prochaine séance de SLEEPING BEAUTY, le premier long métrage de Julia Leigh qui avait toute les cartes en mains pour aller beaucoup plus loin.
LE MOULIN ET LA CROIX:
C'est du vent!
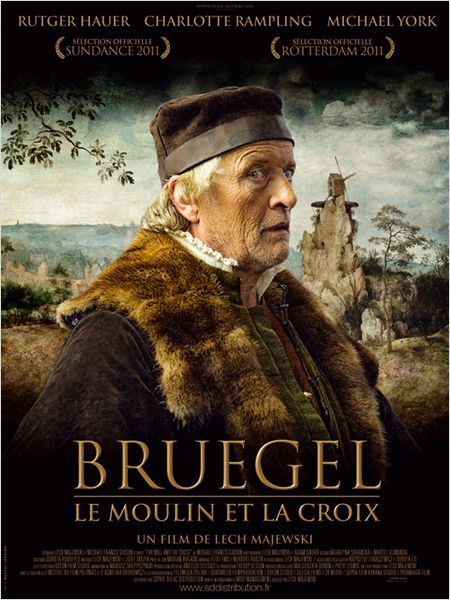
Ce qui est important dans une toile ne doit pas apparaitre au premier regard. C’est un principe cher à tout peintre qui se respect et Brueghel n’échappe évidemment pas à cette règle. Pieter Brueghel, dit l’Ancien, né en 1525 et mort une quarantaine d’année plus tard à Bruxelles est considéré comme l’une des quatre grandes figures de la peinture flamande. Et c’est là que vous me dites : heu… ce Monsieur Brueghel, je ne le connais pas. Jamais entendu parler! Ben justement, d’ou l’intérêt de cette chronique! Elle va vous cultiver un peu et surtout, oserai-je vous rappeler que le cinéma, finalement n’est rien d’autres qu’une successions de tableaux qui bougent. C’est d’autant plus vrai dans ce film intitulé LE MOULIN ET LA CROIX puisque ici, le cinéaste polonais Lech Majewski anime le célèbre tableau LE PORTEMENT DE

Evidemment, comme je le soulignais en préambule, énormément d’éléments n’apparaissent pas au premier regard. C’est vrai qu’au premier regard, on se dit que ce film est chiant! Beau mais chiant. Et puis on fini par se dire que cette impression première était peut-être fausse. Ce film n’est pas chiant, il est mortellement chiant et on a qu’une seule envie au bout du compte, entrer à notre tour dans le tableau pour incarner le personnage du type qui se pend après avoir jeté ses pièce de monnaie de colère. Il est en rage. Il n’en peux plus! Le chanceux obtiendra sa délivrance vers la moitié du métrage, contrairement au spectateur qui devra attendre la 92ème minute pour pousser un Ouf de soulagement. Tout ça est très dommage car l’idée en elle même est aussi séduisante que sensationnelle. On est d’ailleurs assez vite happé par l’expérience proposée. Sur une parcelle de pré, on habille les personnages d'un tableau, et notamment des saints. Le peintre se balade parmi des villageois et opère sa mise en scène, retouche l’étoffe d’une femme par ci, positionne un homme par là. Cette mise en scène est interrompu par une successions de plans fixe avec tout d’abord, dans la forêt un bucheron. Des cavaliers rouges menaçant fendent un épais brouillard avant que l’on ne se retrouve dans le lit d’un couple de jeunes gens qui se réveillent paisiblement dans leur fermette. Dans un autre endroit, deux vieux en font de même.

Sans dialogue, cette entame radicale donne le ton. Ici, seules les images et les bruitages parlent. En fait, le couple de vieux est installé sous terre, au cœur d’un moulin creuser dans la roche. Un mécanisme gigantesque à

On retiendra donc surtout qu’avec ce tableau, Brueghel a réalisé un plaidoyer contre l'avilissement d'un peuple par un autre. En l'occurrence, à cette époque, vers 1564, le roi d'Espagne décide de faire tuer les hérétiques de Flandre et d'Anvers au lieu de considérer que tous les hommes, peu importe leur confession religieuse, peuvent vivre en paix. Voilà ce que dit la toile, enfin surtout la voix off qui est celle du peintre. Et en apprenant ça, LE PORTEMENT DE LA CROIX, de Bruegel s’éclaire différemment. Je vous rappelle qu’on parle là d’un chef d’œuvre. Il faut dire que ce tableau a la particularité de ne mesurer que 1m70 sur 1m24, une surface assez petite pour y faire tenir 500 personnages dont certains mesurent pas plus de